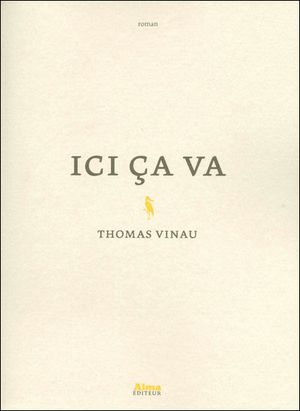La première fois que j’ai vu un portrait de Thomas Vinau, je me suis dit « Ça doit être le genre de types à ne pas manger de gluten sans y être allergique, à prénommer ses mômes Églantine et Gaspard et à être fier de faire la vaisselle pendant que sa compagne répare les freins du vélo. » C’est peut-être vrai ; ça n’a pas d’importance.
Ce que je peux commencer par dire, c’est qu’Ici ça va cumule à peu près l’ensemble des passages obligés liés aux récits de retour à la terre d’un citadin. Le narrateur, qui sort d’une dépression et se définit néanmoins comme inadapté à la vie rurale, et sa compagne (femme ?) Ema, dont on ne sait pas trop ce qu’elle faisait avant, emménagent dans un village, en l’occurrence celui où le narrateur a passé les six ou sept premières années de sa vie. Ça pourrait se poursuivre comme dans les Chiens de paille, mais en fait pas du tout. Ce serait trop pimenté.
Dès les premières lignes et presque jusqu’à la fin, c’est un condensé de niaiserie. Il apprend à passer la débroussailleuse au bord de la rivière. Elle sème des radis, des haricots et des carottes. Il la trouve très belle comme le soleil fait dorer sa peau. Elle adopte un bébé ragondin (!). Il se fait ouvrier viticole aux beaux jours pour le compte d’un paysan. Elle apprend la langue des signes pour pouvoir communiquer avec la fille du paysan. Il reprend goût à la vie en voyant l’aurore poindre à travers la rosée. Elle a peur des araignées. Il la rassure… (Je pourrais continuer ainsi longtemps.) Ils s’aiment. C’est très tendre. D’une tendresse absolument dépourvue de ce qui pourrait ressembler à de l’humour, du recul ou de la dérision. (Je considère ici comme involontaire l’humour d’un passage tel que « Il nous faudrait des poules. Et des enfants aussi », p. 29 en « 10-18 ».)
Pour tout dire, je suis complètement hermétique aux évocations de ce genre : phrases courtes, plaisirs courts, vue courte. Je ne me sens pas agressé, ça ne me révolte pas, c’est simplement qu’elles m’ennuient. Sur cinq lignes et s’il y a quelque chose après, ça peut passer. Mais comme la monotonie est un combat, cent pages sont une épreuve de force. C’est ce qui s’est passé avec Ici ça va, au point que j’ai failli rater les deux moments auxquels se produit quelque chose comme des cahots – il serait exagéré de parler de secousses, et déplacé d’utiliser le mot déraillements – sur le long et lent chemin de fer de l’ennui. (Oui, il m’arrive d’être lyrique…)
Le premier est une scène où le narrateur se fait fabriquer sa propre eau-de-vie par un bouilleur de cru du cru ; évidemment, le premier verre le fait tousser. « J’ai baissé la tête pour déclarer forfait et c’est là que j’ai aperçu le teckel qui accompagnait le bouilleur. Ses yeux blancs, vitreux, et sa langue tremblante qui léchait le sol sous la cuve » (p. 100). Le deuxième est un peu plus fort et un peu mieux préparé, laissant présager de ce qu’aurait donné Ici ça va avec un peu plus d’audace et de densité.