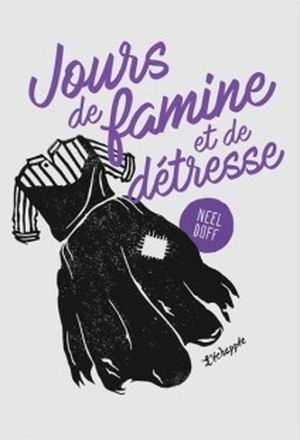Si Neel Doff a aujourd'hui plus ou moins sombré dans l'oubli (du moins pour le grand public), lorsque son roman sortit en 1911, il marqua tant les esprits qu'on fut à deux doigts de lui pardonner d'être une femme et d'être étrangère (belge d'origine néerlandaise) pour lui donner le Goncourt. Si l'on en croit les compte-rendus, et malgré une âpre lutte menée par certains académiciens Goncourt, si on a pu lui pardonner d'être une femme, être belge semblait être bien trop scandaleux pour certains votants. Cela donne une idée des passions déchainées par Jours de famine et de détresse, une oeuvre qui n'a rien perdu de sa force avec l'âge et qui peut d'ailleurs se targuer d'une étonnante modernité aujourd'hui encore.
Les jours de famine et de détresse, ce sont ceux de Keetje (avatar romanesque de Neel Doff, puisque le récit est en grande partie autobiographique) et sa famille, composée de ses deux parents et dix enfants, sous-prolétaires ballottés d'un coin à l'autre des Pays-Bas et de la Belgique en quête de la survie. Comme pour la célèbre oeuvre de Proust, parue deux ans plus tard, tout commence par une réminiscence. Mais contrairement à Proust, ce n'est pas un souvenir plein de nostalgie qui prend la double fictionnelle de Doff, mais une véritable scène d'horreur tout droit sortie de son enfance, où l'un de ses frères se faisait battre par d'autres enfants pour avoir commis le crime d'être pauvre, plongeant la protagoniste dans l'horreur de son passé. De là, Doff, qui s'est extraite de sa classe pour avoir eu la chance d'être belle, se met à nous raconter des fragments de son enfance, scènes d'une simplicité édifiante d'où émane le sentiment d'une impuissance insupportable et d'une prédestination inacceptable. Impuissance face à un système qui ne veut pas d'eux, prédestination d'enfants que des parents n'ont pas eu la présence d'esprit de doter de solutions pour se forger leur propre destin. D'Amsterdam à Bruxelles, la famille de Keetje court après les illusions, chassée d'un appartement à un autre, incapable de payer le moindre créancier, contrainte à s'avilir de plus en plus pour rester unie, au point de finir par recourir au vol et à la prostitution. Une famille qui se fait de plus en plus oppressante pour Keetje, qui aurait préféré voir la famille éclatée et heureuse qu'unie et enfermée dans une misère aussi bien sociale et pécuniaire que psychologique.
Les témoignages littéraires de première main de ces personnes qui ont su quitter la plus noire des conditions pour parvenir à un statut qui leur autorise à présenter avec un certain recul leur passé sont rares, très rares. C'est évidemment une des forces du roman, face à de grands auteurs qui ont décrit la condition ouvrière de loin, sans avoir ressenti dans leur corps, comme Doff, tous les avilissements de cette condition. Il serait cependant réducteur de résumer les Jours de famine et de détresse à un simple témoignage, tant la simplicité de l'écriture de Doff peut prendre aux tripes. Avec un minimum d'artifices, les barrières de la fiction et du temps s'effacent pour laisser place au ressenti brut de cette petite fille, qui a tout subi, et qui a grandi en portant toutes ces cicatrices au fond de soi.
L'injustice est un autre thème essentiel de l'oeuvre, comme dans cette scène où Keetje, contrainte d'aller quémander du pain noir chez des voisins un peu plus aisés, voit huit boulettes cuire pour le repas du soir, et se dit que finalement, un grain enlevé de chaque boulette en ferait une entière pour elle. La conscience de cette barrière infranchissable est omniprésente dans le livre, et blesse profondément.
Un livre injustement méconnu.