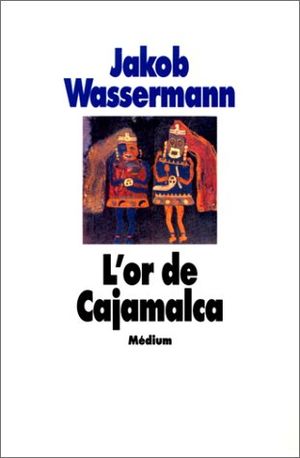L’or de Cajamalca retrace les derniers jours de l’ultime Empereur Inca renversé par les conquistadors espagnols en 1532. Le point de bascule de l’absurde conquête des immenses territoires de l’Amérique du Sud par quelques aventuriers crotteux, poignée de mercenaires qui mirent à bas une dynastie qui se croyait l’égale du soleil. Il existe des témoignages de première main de ces événements, notamment le passionnant Récit de la découverte et de conquête des royaumes du Pérou par le conquistador Pedro Pizarro. Ce dernier est d’ailleurs proche du narrateur imaginé par Jakob Wassermann, Domingo de Soria Luce, chevalier retiré dans un monastère de Lima qui conte ses souvenirs quelques années après les faits.
Par la bouche de ce dernier, mais en réalité depuis l’Allemagne en crise des années 1920, Jakob Wasserman reconstitue avec brio la capture d’Atahualpa par Francisco Pizzaro, le massacre de sa cour royale, la rançon insensée d’une pièce remplie d’or du sol au plafond exigée par les Espagnols puis obtenue, jusqu’au procès factice de l’Inca qui conduira à sa mise à mort. Mais c’est bien le procès des Conquistadors qu’il dresse en creux et à travers eux le notre, celui d’un occident décadent, sans moral, cupide, avide d’or à en tuer.
Jakob Wassermann rédige L’or de Cajamalca dans une période de curiosité pour la civilisation inca, portée par la redécouverte du Machu Picchu quelques années plus tôt et l’essor de l’indigénisme dans la littérature, la peinture, la photographie, et la politique. La vision égalitaire, sans doute idyllique de la société inca de Wasserman n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle décrite en 1928, dans Sept Essais d’interprétation de la réalité péruvienne par José Carlos Mariategui.
Le meurtre d’Atahualpa ne sera bien sûr pas le dernier des crimes commis à l’égard des Amérindiens. A l’époque où Jacob Wasserman rédigeait son ouvrage, les industriels du caoutchouc asservissaient encore des dizaines de milliers d’entre eux pour récolter la précieuse sève vendue ensuite en Europe. Mais le pessimisme de l’auteur se nourrit probablement plus de son vécu de romancier juif allemand, ayant vécu l’horreur de la première guerre mondiale, et témoin impuissant de l’explosion de l’antisémitisme en Europe.
Son livre annonce la critique radicale de la colonisation, relue non plus comme le triomphe de la civilisation européenne mais comme son tombeau, une suite de crimes avilissants qui firent des Européens les barbares qu’ils prétendaient combattre. Il raconte – comme le proposait son contemporain Walter Benjamin – l’histoire du point de vue des vaincus. Un puissant renversement de perspective qui n’a rien perdu de sa charge subversive. Car la question qu’il pose est vertigineuse: et si c’était nous les méchants?