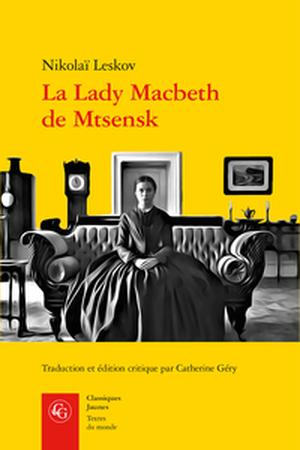Il faut bien le dire, le titre a l’air un peu putassier. Pas parce que Leskov et Shakespeare ne jouent pas dans la même cour, mais parce que Katerina Lvovna n’a pas grand-chose à voir avec lady Macbeth. D’ailleurs, elle ne cherche pas à manipuler son mari : elle le tue. En fait, Katerina Lvovna, ce serait plutôt Macbeth que lady Macbeth. Et quand il s’agit d’effacer les traces de son sang sur le tapis, elle y arrive, elle.
Mais s’il n’y a pas de sorcières ni de malédiction dans le district de Mtsensk (et je t’assure, cher lecteur, qu’en prononçant Mzensk, ça passe mieux), on y trouve la même chose qu’au royaume d’Écosse et que partout ailleurs : le mal. Un mal social : on est plus près de Zola, celui de Thérèse Raquin, que de Shakespeare. Que ce mal se manifeste par les actions – les agissements ? – d’une femme, chez un auteur aussi réactionnaire, ça ne me semble guère étonnant. Entre la bourgeoise qui s’ennuie et la paysanne lubrique, Leskov n’a pas choisi, et fait de Katioucha une bourgeoise lubrique (donc différente d’Emma Bovary) qui s’ennuie. En guise de jardinier : Serioja, qui sent la paille et la sueur. En victimes expiatoires, Zinovi, Boris et Fedia.
Si j’appelle tout ce monde-là par son prénom ou son diminutif, c’est parce qu’il émane du récit une sorte de familiarité, un peu comme quand ta grand-mère te raconte qu’avant la guerre, le René allait souvent voir Jeannette parce que la Suzanne, elle était pas commode. Bien sûr, c’est un peu plus travaillé que ça, et le lecteur doit accomplir sa part de travail pour reconstituer les non-dits : « Ils se sont regardés et dans leurs yeux, il y a eu comme un éclair ; mais ni l’un ni l’autre n’a ajouté un mot » (p. 115 en « Classiques Garnier » jaune, traduction de Catherine Géry).
Ce qui est drôle, c’est que la Lady Macbeth du district de Mtsensk puisse aujourd’hui passer pour une œuvre féministe, alors que ses trois principaux personnages féminins sont une Katerina adultère et trois fois homicide (dont un infanticide), une Sonetka aussi dévergondée qu’égoïste, et « une ménesse. On apprécie fort les femmes comme elle dans les troupes de brigands, les groupes de prisonniers et les communes sociales-démocrates » (p. 133 – les sociaux-démocrates apprécieront).
Une lecture féministe n’a pourtant rien d’un contresens, à condition qu’on prenne ce roman, ou cette nouvelle, ou ce conte (ce skaz, explique la traductrice et préfacière) pour un document sur ce à quoi les conditions d’existence des femmes de l’époque les ont menées – un genre de témoignage qui se veut à charge et qu’on lirait à décharge.
Mais, comme pour Madame Bovary encore, une telle approche serait réductrice. Outre le style – je fais par ailleurs confiance à la traductrice sur ce point –, outre la psychologie sur laquelle je ne m’appesantirai pas dans cette critique, c’est la ligne narrative qui fait l’intérêt de cette Lady Macbeth : un peu comme dans les bonnes tragédies, on sait ce qui va se produire, on sait comment cela se produira, et pourtant on lit jusqu’au bout, ne serait-ce que pour vérifier que le destin ne faillira pas.