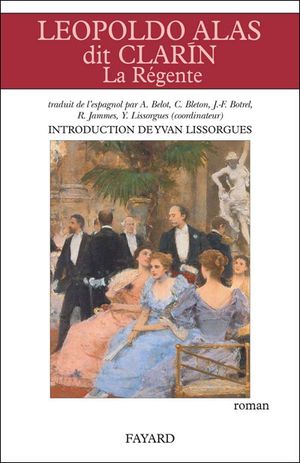Voilà un livre que j’ai lu tout à fait par hasard : je l’ai aperçu en regardant les rayons d’une bouquinerie. Je ne connaissais même pas l’auteur de nom. J’avais trouvé quelque part un autre livre assez étrange, très intriguant, dans cette même édition Fayard, et c’est ce qui m’a fait tilter sur La Régente ― je dois dire que je trouve ces bouquins affreux, mais il s’agit ici d’aller au-delà des apparences ― qui était un autre livre absolument inconnu. C’était L’Ile du second visage d’Albert Vigoleis Thelen. Mais je veux parler ici du livre de Leopoldo Alas, connu sous le nom de Clarín. Il était par ailleurs un journaliste et critique très actif à son époque. On a l’idée en examinant ce livre d’un peu plus près, d’un écrivain très au fait de la littérature contemporaine (surtout française et espagnole) et des idées modernes, et qui souhaite y apporter une réponse originale.
Sur La Déshéritée de Benito Pérez Galdós publié en 1881 (soit quatre ans avant que La Régente soit entièrement publié), Clarín écrit :
Un autre procédé employé par Galdós […] est celui déjà employé par Flaubert et Zola, avec des résultats si impressionnants : remplacer les observations sur la situation d’un personnage, faites fréquemment par l’auteur au moyen de sa propre voix, par l’observation du personnage lui-même et avec son propre style, mais non sous forme de monologue, mais comme si l’auteur était à l’intérieur de celui-ci.
Avec sa Régente, Clarín donne à lire un roman dont la narration multiplie ses formes, descriptive ou ironique, s’immisçant dans les pensées des personnages, dans leurs souvenirs, dans leurs stratégies ou leurs élucubrations. Le roman a quelque-chose de théâtral et même de musical, on aimerait bien voir les monologues être interprétés, et voir quelques-unes de ses scènes se jouer. On dirait que tout Vetusta ― pendant fictif d’Oviedo, où l’intrigue du roman se déroule ― semble faire chorus aux incidents du récit, pour exprimer sa désapprobation. Dans un village, tout se sait, et la Régente (notre personnage) a une certaine notoriété. Par moments la narration nous laisse aussi imaginer la ville imaginaire dans son architecture, dans sa mentalité ambiante ainsi que son atmosphère météorologique : quelques passages où Clarín parle de l’humidité qui plombe les personnages ou les rendent malades, ou bien dans des moments apaisés, la lumière, les arbres et les feuillages de Vivero.
Tout le roman est en quelque sorte le portrait de Vetusta, en contraste avec tous ces efforts de modernité littéraire, cette ville porte bien son nom. Vétuste, figée et dans le passé et l’hypocrisie des traditions. Vetustain n’est pas seulement le nom de ses habitants, mais aussi le qualificatif d’un certain état d’esprit. Les personnages sont tous victimes (ou bourreau), des ragots des uns envers les autres, des médisances, ou des assiduités érotiques d’intrigantes ou de vicieux, à moins d’en être exclu par disgrâce. Par ailleurs il faut croire et respecter dieu (l'athéisme est "accepté" pourvu qu'il ne fasse pas trop de vagues), mais pas trop, c'est-à-dire ne pas l'adorer. Dans la même logique, on ne laisse pas trop voir qu’on est débauché. Tout ce qui sort de ce bon ton est stigmatisé, a-t-on un mot un français, pour désigner tout cela simplement ?
Rien de plus ridicule à Vetusta que le romantisme. Et l’on appelait romantique tout ce qui n’était ni vulgaire, ni grossier, ni commun, ni routinier. Visita était le pape de ce dogme antiromantique. Regarder la lune pendant plus d’une demi-minute était pur romantisme ; contempler en silence le coucher du soleil… idem ; respirer avec délices l’air embaumé de la campagne à l’heure où soufflait la brise… idem ; parler des étoiles… idem ; saisir une expression d’amour dans un regard, sans qu’il fût besoin de rien dire… idem ; s’apitoyer sur les enfants pauvres… idem ; manger peu… Oh ! C’était le comble du romantisme.
Ana Ozores, la fameuse régente, s’inscrit donc en faux de cette tendance qui la répugne en son for intérieur ― elle est très loin, hélas, de manifester un engagement quelconque ― elle reste attachée à une vie de l’esprit qui se convertit suite aux circonstances et aux influences, en une piété vertueuse voire bigote. C’est que Don Fermín de Pas, un chanoine aussi nommé Le Magistral, avide d’influence sur les autres et habile dans l’expression cherche à la garder dans le giron de l’Eglise puis à la séduire physiquement. Il a pour adversaire un Don Juan plutôt matérialiste ― mais un matérialisme fort peu intellectuel ―, Don Alvaro Mesía. Les deux découvrent qu’ils sont amoureux.
On voit Ana balancer entre une forme de transcendance ― qui n’a rien de naïve, mais qui n’a ni le temps ni la possibilité de se développer de manière autonome ― et une attirance inavouée pour l’amour physique. L’origine de cette irrésolution entre deux penchants qu'Ana n’arrive pas à concilier est en quelque sorte racontée par elle-même, toujours dans un style indirect libre qui fait la spécificité du roman : elle se rappelle d’une escapade ― finalement tout à fait innocente ― avec un garçon. Une culpabilité toujours sous-jacente est née du scandale et des reproches que cela a causé. A la suite de cela, elle se promet une vie dénuée de l’élément masculin, mais on lui impose vite un mari (le personnage au demeurant le plus drôle et le plus touchant du roman, un ornithophile créateur de machines vivant dans le monde de Calderón). Les souvenirs lumineux de ses premières lectures, la manière dont celles-ci résonnaient en elle, a favorisé en contrepoint une ferveur que son libidineux confesseur appelle panthéisme. Avec tous ces éléments, je n’ai pu m’empêcher de repenser à Anne-Marie, le personnage des Deux Etendards. La comparaison n’est pas à l’avantage d’Ana Ozores ― il est vrai qu’on est un demi-siècle plus tôt ― mais avec toutes ces promesses on aimerait la voir moins vulnérable, plus dégourdie.
Pendant ces nuits-là, Ana fit des rêves horribles […] Une nuit, La Régente reconnut dans ce souterrain les catacombes, d’après les descriptions romantiques de Chateaubriand et de Wiseman ; mais au lieu de vierges vêtues de blanches tuniques, elle voyait errer, dans ces galeries humides, étroites et basses, des larves dégoûtantes, décharnées, revêtues de chasubles d’or, de chapes et de manteaux de prêtres qui, au contact, étaient comme des ailes de chauves-souris. Ana courait, courait à perdre haleine sans pouvoir avancer, à la recherche de l’ouverture étroite, préférant y déchirer ses chairs plutôt que de supporter la puanteur et le contact de ces masques repoussants ; mais quand elle parvenait à la sortie, les uns lui demandaient des baisers, les autres de l’or, et elle cachait son visage en distribuant des monnaies d’argent et de cuivre, tandis qu’elle entendait chanter des requiems sardoniques et que son visage était éclaboussé par l’eau sale des goupillon qui s’abreuvaient dans les flaques.
Le livre est épais, oui, mais les pages sont épaisses. On dirait que Fayard cherche à canaliser ses textes fleuves dans de longues lignes et de grandes pages... un monde se referme lorsqu'on a terminé le livre. Mais que l'on se rassure, la bêtise, comme l'a dit l'autre, est infinie.
Livre publié en 1885 ― Traduit de l’espagnol par Yvan Lissorgues, A. Belot, C. Bleton, J.-F. Botrel et R. Jammes. Edité par Fayard (732 pages). Lecture du 18 octobre au 3 novembre 2018