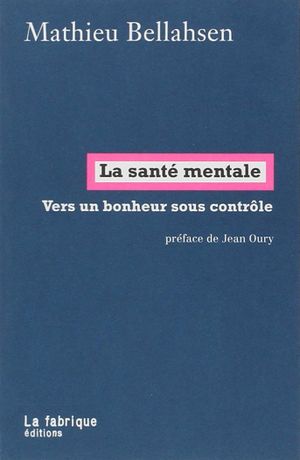Le court livre de Mathieu Bellahsen établit une analyse essentielle : le devenir de la psychiatrie au sein du néolibéralisme. Ce processus se joue autour de la notion de « santé mentale », maître mot des politiques actuelles en matière de psychiatrie. L’ouvrage retrace donc les mutations de la « santé mentale », de sa création jusqu’à son usage actuel.
Hygiénisme versus anti-psychiatrie
La notion de santé mentale prend racine, au début du 20ème siècle, dans les mouvements hygiénistes. Au niveau de la psychiatrie, le psychiatre Édouard Toulouse fonde en 1920 la Ligue d’hygiène et de prophylaxie mentale, dont le but est de prévenir (et donc de réduire) les problématiques psychiatriques. La ligue se fonde en parallèle des ligues contre l’alcoolisme ou des mouvements contre la propagation de la syphilis ou de la tuberculose : il s’agit d’éduquer les individus a être plus rationnel en matière de conduite de vie. La conception de la maladie mentale est prise dans un ensemble biologique et social : il s’agit de préserver la santé mentale des concitoyens en conservant un environnement sain et de bonnes conduites de vie. Ainsi la santé mentale est une notion qui s’applique bien au-delà de la psychiatrie mais concerne le social dans sa globalité.
Après les guerres – et notamment après le traitement inhumain des patients en psychiatrie – la notion de santé mentale sera reprise par les psychiatres désaliénistes (Bonnafé, le groupe de Sèvres etc.) sans la dimension biologique. Étant donné que la santé mentale concerne toute la société, cette notion sera l’opérateur pour faire sortir la folie de l’asile. Cette dernière n’est plus le lieu élu pour l’expression de la maladie mentale et son traitement : c’est la société dans son ensemble qui doit accueillir les aliénés. C’est ainsi que le mouvement de l’anti-psychiatrie, de manière différente selon les pays (Royaume-Uni, France, Italie) utilisera la notion de santé mentale comme étant une manière de parler de la société et de ses logiques de dominations : le fou devient un moment révolutionnaire, porteur d’une critique envers l’ordre capitaliste, et la santé mentale est le degré de « progrès » que l’anti-psychiatrie peut apporter, en travaillant à la disparition de l’asile ou en élaborant une psychiatrie de secteur qui ne produit pas de séparation avec le quotidien des patients ou un enfermement.
Paradigme néolibéral
Au début des années 80, la fameuse rigueur budgétaire fait ses effets dans la psychiatrie. La dimension gestionnaire de l’économie et de l’épargne régule les soins. Il s’agit de rationaliser les dépenses et donc de normer les pratiques thérapeutiques. Les grilles, tel que le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), tendent à produire des parcours-type en fonction des pathologies. La psychiatrie, pensée comme une médecine parmi les autres, devient tributaire d’une logique de soin qui est fondamentalement organiciste, qui suppose que la problématique qu’expérimente un patient en psychiatrie réside dans son cerveau ou dans ses gènes, bref un substrat organique. De plus, il ne s’agit plus de penser au long cours (les traitements longs sont difficiles à prévoir), mais sur des interventions ciblées, « des traitements de crise » ou de simples diagnostics avec prescription. La dimension existentielle se retrouve oblitérée par une gestion fondée sur l’évaluation des politiques de santé. Ce changement de paradigme sera un boulevard pour les universitaires portant des thèses organicistes, pourtant minoritaires au sein de l’université.
Cette mutation s’accompagne d’un discours sur la santé, discours en accord avec la pensée néolibérale. L’OMS, en 1948, donne une définition de la santé :
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, elle ne réside pas seulement dans l’absence de maladies ou d’invalidité
S’introduit ici, la notion de bien-être. Bien entendu, la santé, ce n’est pas seulement que l’absence de pathologie, c’est aussi la capacité de se relever des affections concernant le corps. Or, le bien-être introduit une dimension supplémentaire : c’est un état qui traduit un accord avec l’état du monde, de la société, du corps propre. Cette dimension normative, appliquée au concept de santé mentale donne ceci, quelques années plus tard :
Une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s’adapter aux diverses situation de la vie, faites de frustration et de joies, de moments difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre. Une personne en bonne santé mentale est donc quelqu’un qui se sent suffisamment en confiance pour s’adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer. Cette personne vit son quotidien libre des peurs ou des blessures anciennes qui pourraient contaminer son présent et perturber sa vision du monde. Quelqu’un en bonne santé mentale est capable d’éprouver du plaisir dans ses relations avec les autres. Posséder une bonne santé mentale, c’est parvenir à un état d’équilibre entre tout les aspects de sa vie psychique, psychologique, spirituel, social et économique. Ce n’est pas quelque chose de statique, c’est plutôt quelque chose qui fluctue sur un continuum.
Ce qui transparaît dans cette définition de l’OMS, c’est la condition de la santé mentale : l’adaptation. Le monde, la société ne se change pas, c’est à l’individu de s’adapter malgré les moments difficiles. Toute causalité psychique ou psychosociale est rabattu du côté de l’individu. Ce n’est pas l’état du monde ou de la société qui produit le mal-être de l’individu, mais c’est ce dernier qui manque de ressource pour s’adapter à l’état du monde. La définition de l’OMS suppose un accord avec la pensée et la politique dominante. C’est bien l’un des signes de la pensée néo-libérale : l’individu doit se gérer rationnellement, et la raison commande de s’adapter à la marche du monde.
Ce focus sur l’individu – y compris dans ses difficultés psychiques – n’est pas un délaissement de ce dernier, une manière de le livrer à lui-même. C’est une prise en charge, une gestion de l’individu se réalisant sur un discours l’enjoignant à être « acteur de son parcours de soin ». Le néo-libéralisme secrète l’idée que le changement peut venir de l’individu seul, certes guidé par un expert – ici, le psychiatre – lui offrant un diagnostic et donnant une marche à suivre en rapport avec ce dernier. Conception séduisante aussi, car l’individu n’est plus pris dans un ensemble complexe de déterminismes sociaux ou structuraux, mais devient acteur de sa propre santé (il suffit de « s’adapter ») et par là maître de lui-même. Tout un militantisme de parents d’autistes pour l’inclusion de leurs enfants dans des écoles non-adaptée s’éclaire à la lumière de cet avantage produit par le discours autour de la santé mentale.
La clinique fondée sur l’objectivité
Cette assurance portée sur l’individu et son accompagnement doit se justifier via un discours de l’objectivité, de la psychiatrie « fondée sur les preuves », en bref de la scientificité.
Afin de bien accompagner les individus en souffrance, il faut pouvoir identifier correctement les troubles. Ainsi une conception organiciste et statistique de la maladie se développe. Organiciste dans le sens où l’on suppose que l’origine des troubles se situe soit dans les gènes, soit au niveau des neurones, et que cette origine permet de comprendre l’entièreté du trouble en question. Ainsi les entités nosographiques telles que paranoïa, schizophrénie, autisme, dépression etc. existent concrètement dans le corps. Statistique, dans le sens où si le trouble est dû à un dysfonctionnement du corps, il y a donc une forme d’universalité des symptômes, on est en capacité de retrouver certains manifestations chez tous les dépressifs, schizophrènes etc. Il s’agit donc de produire une dimension pathologique à chaque moment de la vie, moments qui peuvent se cristalliser en pathologie nécessitant une psychothérapie et un traitement médicamenteux. Les classification des maladies mentales tendent à être pensées comme des éléments naturels, s’inscrivant dans la biologie et non pas comme des élaborations conceptuelles visant à comprendre les difficultés existentielle des patients. Cette « naturalisation » permet d’ancrer les pathologies dans une sorte d’intemporalité et de teinter le diagnostic en psychiatrie d’une coloration de certitude.
Si la pathologie est toujours la même, alors il y a un traitement pour chaque trouble. Bien évidemment, la médication se prescrit en fonction des symptômes (si bien que les molécules que prend un patient peut conditionner la perception qu’une équipe médicale de ce dernier), mais l’orientation thérapeutique est déterminée en fonction des troubles. Une thérapie pour les traumatismes, une thérapie pour la bipolarité, une thérapie pour la phobie etc. Le diagnostic est quasiment ce qui ordonne la vérité du patient, et non plus sa parole, pourtant expression de sa singularité au-delà des troubles, des structures. La thérapie est aussi pensée comme une molécule, indépendamment de celui qui la pratique ou de l’organisation institutionnelle du lieu de soin. Ainsi , on pourra toujours vanter les bienfaits de telle méthode thérapeutique en ne s’embarrassant pas des questions d’accueil ou de pouvoir.
La clinique fondée sur les preuves, la psychologie « scientifique » pour se revendiquer comme tel doit objectiver des éléments (diagnostic et traitement) pour les reproduire, en tester l’efficacité, au prix du sacrifice de la singularité et d’une fixation des patients avec une étiquette diagnostique. Ce tour de force s’établit en écho avec une pensée néo-libérale qui pense l’individu avec le même manque de nuance et la même tentative gestionnaire.
Être ensemble
Là où la santé mentale introduit une dimension de capitalisation (il faut être suffisamment sourd au monde pour s’adapter) – capitalisation marquant l’accord avec l’idéologie dominante – la folie, le burn-out, la dépression, l’activité psychique introduit une différence. C’est une rupture avec le quotidien, ce sont des moments où des problèmes existentiels se manifestent. Avant de les traiter, avant de les considérer comme pathologique, il y a toute une dimension d’accueil a maintenir. Là où les classifications organicistes maintiennent la différence au sein des patients, il faudrait plutôt s’orienter sur une conception qui place la différence entre les sujets, et non pas à l’intérieur. La différence est la distance entre moi et autrui, et peut-être que l’enjeu de l’accueil en psychiatrie est de penser un être-ensemble, via la différence. Comment s’inscrire collectivement dans une vie, où nous avons des expériences radicalement différentes ? Au-delà des progrès déjà annoncés des neurosciences – qui ne font que ressusciter les veilles lunes de la psychiatrie biologique – comment prendre en charge collectivement, patients et soignants, notre souffrance et celle du social ? C’est la véritable question qui nous met au travail.