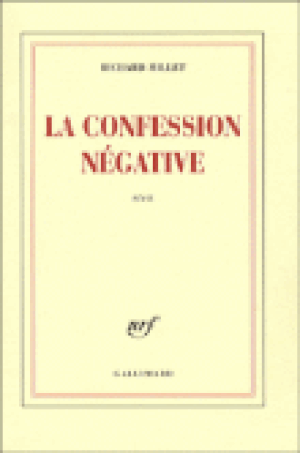Flash-backs et flash-forwards exclus, La Confession négative se déroule sur plus ou moins une année, celle que le narrateur/auteur a passée au Liban, à y combattre les Palestiniens aux côtés des chrétiens. Là où ça devient intéressant, c’est qu’au fond, il ne semble pas vraiment en avoir grand-chose à foutre du conflit en lui-même, de qui a le pouvoir au Liban ou même de la religion chrétienne. S’il a choisi ce camp-ci, c’est en partie par défaut, parce qu’il a grandi comme chrétien dans une culture judéo-chrétienne, et en partie par défiance, en réaction au fait que l’opinion internationale et les médias prennent unilatéralement le parti des Palestiniens. Mais en réalité, s’il s’embarque, dans les années 70, dans un avion en direction du Liban, c’est avant tout parce qu’il veut être écrivain. Pas seulement un mec qui écrit des livres et les fait publier, mais un mec qui écrit de la littérature. Et pour lui, pour accéder à ce genre de statut, pour comprendre des vérités suffisamment transcendantes sur la vie pour en être changé au point d’être capable de tirer de ses expériences une matière suffisamment dense pour en faire de la prose éternelle, il faut avoir connu deux choses : l’amour et la guerre.
Lui n’est qu’un jeune con d’à peine plus de vingt ans qui n’a pas vécu grand-chose et qui, en dehors de sa vocation littéraire, n’est sûr que d’une seule chose : le monde n’est pas fait pour lui. C’est un misanthrope, un inadapté, un incompris, un mec qui n’est pas à sa place dans la réalité, et qui sent confusément qu’une guerre est en soi un lieu surréaliste dans lequel il pourrait bien être en mesure de trouver ce qu’il cherche sans réussir à le nommer vraiment. Une illumination ? Une épiphanie ? Une claque ? Une expérience ? Un peu de tout ça sans doute, et probablement rien de tout ça aussi. C’est que la guerre est une bête étrange, qui se dérobe aux descriptions et change de forme à chacune de ses apparitions. Celle de La Confession négative est surtout faite d’ennui, d’attente, et d’ennemis invisibles et anonymes.
De par son statut d’étranger et l’exotisme intrinsèque que revêt pour lui son séjour (car l’Orient, même au bout d’un an, paraître toujours exotique a quelqu’un qui a passé toute sa vie en Occident), il ressent cette guerre avec un certain sentiment de distanciation et, même lorsqu’il est confronté aux pires horreurs, il ne les vit qu’avec une certaine forme de recul instantané, celui de l’observateur, de l’homme dont la mission dépasse les simples intérêts du moment. C’est sans surprise qu’il se révèle en franc-tireur, à dégommer des silhouettes objectivisées, déshumanisées au possible, le poste de sniper devenant ainsi une réalisation allégorique du rôle de l’écrivain, qui observe le monde de loin, sans y prendre part mais en décidant de quelle manière l’interpréter, et en régnant comme seul maître sur son petit théâtre du réel. C’est également une manière très concrète pour lui d’exprimer sa misanthropie, son dégoût du genre humain au global et son indifférence quant au destin de ceux qui le constituent.
C’est que, pour le narrateur, la misanthropie est constitutive de la littérature, et il lui semble impossible d’aimer à la fois les lettres et les hommes. Plus que tout, il aime la littérature, et La Confession négative regorge, déborde même de références littéraires, à des textes, à des auteurs, parfois à de simples titres, et on sent que l’amour de ceux-ci dépassent l’intérêt qu’il peut porter à quoi que ce soit d’autre ; et cet amour n’est pas que théorique, il est également pratique, concret, il est la matière même du roman, puisqu’il constitue son style : La Confession négative est un livre de lettré, d’amoureux de la langue française, d’esthète du mot rare mais juste et de la phrase ardue mais rigoureuse. C’est pour cela, également, que, comme je l’ai dit en ouverture, La Confession négative impose son rythme. Il est constitué de phrases longues, complexes, proustiennes, pleines de subordonnées et de compléments, d’idées imbriquées les unes dans les autres. C’est d’une densité folle, d’un foisonnement hostile, mais c’est un maquis chirurgical, où l’empilement des couches discursives ne doit rien au hasard.
Et je déteste ça. Je déteste le subjonctif, le registre soutenu, les descriptions sans fins, les phrases de 3 pages et les imbrications de subordonnées relatives. Je déteste aussi les bouquins sur la guerre, n’importe quelle guerre, et je déteste les bouquins qui parlent de la religion ou de la politique et des conflits absurdes qui en découlent. Pourtant, pour la première fois, un auteur dont je n’aimais pas le style m’a convaincu, dans le cadre de son cheminement personnel, de sa pertinence et de son honnêteté. La langue de Millet, qu’il l’utilise pour évoquer sans détours les détails les plus crus, criminels ou scatologiques, de son expérience, ou qu’il l’a mette au service d’elle-même pour clamer son amour de la littérature française, n’est jamais creuse ou fantoche, et relève toujours d’un perfectionnisme humble plus que d’un onanisme tape-à-l’œil. D’ailleurs, tout est pathétique, méprisable ou terriblement ordinaire dans La Confession négative, des frères d’armes aux femmes en passant par le narrateur lui-même – sans doute le moins bien loti du tas, tout, sauf la littérature et le statut d’écrivain, qui sont, au bout du compte, la seule chose qui compte réellement. Tout le reste n’est que moyens, insignifiants face à la grandeur la fin. On pourra toujours parler politique, religion et médias plus tard, si vous voulez, mais la vérité, c’est que La Confession négative ne parle que d’un homme qui est prêt à tout pour entrer en littérature. Rien de plus.