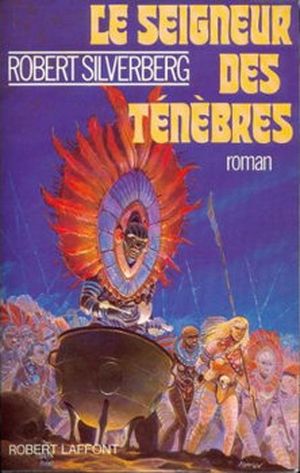« Tu es parti sur la mer, tu as accompli le voyage et te voilà au
rivage ; descends maintenant. »
Issu d’une lignée ancienne de marins, Andrew Battell a toujours connu l’air salin de la Mer du Nord comme seul horizon. Dernier né d’une fratrie de gueux plus attirés par l’aventure que par l’entretien d’un alleu, il a préféré à son tour suivre la voie de ses frères et courir les océans avec les plus illustres corsaires de son temps, les Francis Drake, John Hawkins et autre Froshiber. La tête farcie de promesses de gloire, il embarque en l’an de grâce 1589 avec l’équipage de Abraham Cooke dans l’intention de piller le trésor des galions du Rio de La Plata. Mais, les rêves de château en Espagne ne durent pas longtemps. La réalité se charge vite de le ramener à la raison. Malmenée par des vents contraires, en proie aux avaries et au scorbut, l’expédition finit par atteindre le Brésil dans un bien piètre état. Fait prisonnier par les Indiens, Andrew est livré aux Portugais qui le réduisent en esclavage. Mais tout cela n’est qu’un prélude. Le marin anglais est bientôt déporté vers l’Angola où les circonstances vont le conduire au cœur du continent africain, en terra incognita. Vingt années à côtoyer les Portugais et à endurer les humiliations, l’espoir et un labeur incessant. Deux décades loin de sa terre natale, jusqu’à rencontrer l’indicible auprès de Imbé Calandola, le roi impie des terribles Jaqqas.
Pendant longtemps, Robert Silverberg a voulu écrire un roman historique. Fruit d’une longue gestation, puisant ses racines dans un conte pour enfants et dans la lecture postérieure des récits de voyage des explorateurs du XVIe-XVIIe siècle, Le Seigneur des Ténèbres a bien failli ne jamais voir le jour. La faute à un marché américain très compartimenté, du moins à l’époque de sa parution, où il ne faisait pas bon sortir de sa niche éditoriale pour adopter un autre genre. Le présent objet a fini par paraître, contre la promesse de l’écriture d’une suite au Château de Lord Valentin, le plus grand succès commercial de Robert Silverberg. Un bon calcul puisque Majipoor a permis d’éponger le fiasco de ce voyage au cœur des Ténèbres, unique roman historique de l’auteur américain, si l’on fait abstraction de ses uchronies.
Le Seigneur des Ténèbres acquitte sa dette au roman de Joseph Conrad fort honorablement, même si l’influence de Edgar Rice Burroughs se fait également sentir, notamment dans la description des Jaqqas et de leur roi démoniaque. Dans une langue imagée, truffée d’expressions et de figure de style se voulant authentiques mais pas inintelligibles, ici traduite par Nathalie Zimmermann de manière remarquable, Robert Silverberg donne vie à une Afrique tenant davantage à l’imaginaire des explorateurs européens qu’à une étude ethnologique. Il dresse un tableau accablant de la colonisation, bien éloignée du lyrisme d’un José-Maria de Heredia, où les Portugais et leurs semblables apparaissent guère plus civilisés que les jaqqas, n’hésitant pas à massacrer ou réduire la population noire en esclavage afin d’accroître leur richesse personnelle.
Réduit à jouer le rôle du candide, Andrew Battell idéalise son pays natal pour mieux rejeter le milieu papiste dans lequel il se trouve immergé. Il dresse en effet un portrait guère reluisant des colons portugais, réduits à un ramassis de repris de justice dirigés par une aristocratie frivole et intrigante, la palme de la duplicité revenant à Dona Teresa, une métis dont Andrew s’entiche et qui lui fera payer chèrement son infidélité. C’est paradoxalement au contact des indigènes que l’anglais s’enrichit et, de cette altérité, il ressort grandi, acquérant auprès des sauvages une compréhension du monde détachée de sa naïveté initiale.
Bien loin de se cantonner à un exercice de relativisme sociétal, Le Seigneur des Ténèbres se révèle enfin un formidable roman d’aventures, certes un tantinet longuet au début, mais dont la progression dramatique ne se dément pas, atteignant son point d’orgue durant la confrontation avec les Jaqqas. Imbé Calandola apparaît en effet comme la figure du Mal absolu aux yeux de l’Européen. Un monstre imprévisible surpassant même en cruauté les Portugais. Pour autant, le personnage fascine l’Anglais, au point de le pousser à adopter ses coutumes infâmes, jusqu’à souhaiter voir se réaliser son rêve de destruction régénérateur. Au terme d’un véritable voyage au bout de l’enfer, Andrew aura au moins appris autant sur lui-même que sur ses compagnons, accomplissant des actes qu’il aurait réprouvé en d’autres temps.
Au final, Le Seigneur des Ténèbres se révèle une œuvre majeure de Robert Silverberg, un roman longuement mûri, où se dévoile son goût pour l’aventure et pour des thématiques plus sombres. Bien loin des fadaises de Majipoor, il déploie tout son talent d’écrivain dans un roman à la fois intense et intime. En somme, la marque des grands auteurs.
Source