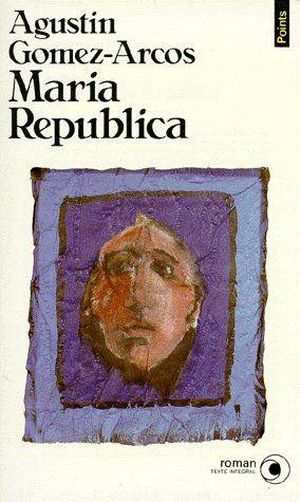"Tout individu est un rebelle,surtout lorsqu’il n’est pas d’accord avec toi et que tu as le pouvoir"
On rencontre Maria Republica, la putain rouge – couleur associée dans l’Espagne franquiste aux républicains – le jour où sa tante la fait rentrer au couvent. Pas n’importe quel couvent. La tante a les moyens, la tante ne veut pas se contenter de "sauver" sa nièce, il faut que cela se sache. Pourquoi va-t-elle au couvent, Maria Republica ? Parce qu’elle n’a pas le choix en cette année où l’on ferme les bordels, laissant à la rue des milliers de femmes comme elle. C’est le couvent ou la rue.
Le couvent de Sa Révérence la Duchesse l’accueille semble-t-il à bras ouverts. Maria Republica est le symbole des ennemis du franquisme. Elle dont les parents républicains ont été fusillés alors qu’elle n’était qu’une enfant, elle qui a préféré se prostituer plutôt que de se soumettre à la loi de sa « sainte » tante qui a prospéré grâce au franquisme, marchant sans remords sur les plus faibles pour s’élever plus haut encore. La "sauver" serait une victoire écrasante sur les opposants.
Le roman dénonce. Le sens des mots est renversé, la tante n’est "sainte" que parce qu’elle sert le pouvoir en place. Le livre de la Règle qui régit le couvent, que Sa Révérence la Duchesse - personnage dégoûtant dans sa décrépitude - a rédigé elle-même est tout bonnement absurde quand il n’est pas contraire au dogme catholique habituel. Cette Règle résume à elle seule le propos du roman, qui nous sert une vision très pessimiste du monde des hommes. Il y a ceux qui ont choisi de défendre à tout prix le pouvoir en place, quitte à commettre l’horreur au nom d’un être supérieur, invoqué quand il arrange et transformé quand il gêne. Et Maria Republica, la putain syphilitique, qui s’est convaincue qu’elle servait la révolution en contaminant les premier avec sa maladie qu’elle refuse de soigner. L’on ne peut aimer les premiers tant leur absurdité est révoltante, l’on ne peut haïr la seconde tant sa détresse nous inspire pitié.
Une fois de plus, Agustin Gomez-Arcos ne nous épargne rien et pourtant, jusque dans l’horreur, ses personnages parfois tellement caricaturaux en deviennent presque poétiques, allégories des méchants de contes de fées. Et il y a ces passages sublimes, comme ce rêve de robe bleue d’une petite fille qui n’avait que ses rêves. Ce rêve pourtant pas si grand volé à une enfant trop pauvre pour avoir ne serait-ce que le droit de le faire. Et la haine de Maria se nourrit encore plus de ces rêves déchus que de ses propres peines, que de l’horreur vécue.
« Tu auras ton bleu, Rosa. Je te le promets, même si je dois l’arracher à la chair des autres, je te donnerai ce bleu qui est à toi, qui te revient de droit, ce bleu qui était la seule chose que la vie devait te donner et que les autres t’ont refusée. Parce que la vie te l’aurait donné, ton bleu, elle n’est pas avare la vie. Ce sont les autres, ceux qui ordonnent notre vie en un espace de temps où nous n’avons le droit de rien avoir, de rien posséder. En sachant que jamais, ni avant ni après cet espace de temps, si réduit, nous n’aurons ni l’occasion, ni la force, ni l’envie de dire : ma vie est à moi, ma vie est mon bleu, ne me l’ôtez pas. Je te donnerai ce bleu […] »
Maria Republica, c’est la force d’une vie brisée contre la machine qui l’a détruite. Maria Republica, c’est celle qui, n’ayant plus rien à perdre, ira jusqu’au bout pour assouvir sa haine. Maria Republica, plus que le portrait d’une femme, c’est le tableau d’un système corrompu contre lequel l’auteur se révolte.