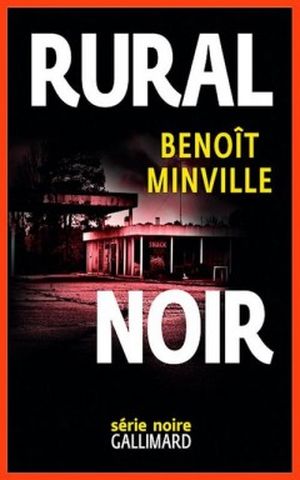Dix ou quinze ans après l’avoir quitté, Romain revient au village qui l’a vu grandir et faire les quatre cents coups avec son petit frère Chris, ex-militaire devenu potier, son meilleur ami Vlad, glandeur devenu trafiquant, et sa meilleure amie Julie, devenue infirmière. (On imagine volontiers que ces quatre-là constituaient à l’époque une moitié de l’ensemble des enfants du village. Mes grands-parents utilisaient le mot conscrit, et leurs parents pays. Bref.) Le retour de l’orphelin pas prodigue, attisant de vieilles braises enfouies, sera suivi – aux sens temporel et causal du mot suivre – d’une explosion de violence, façon réaction en chaîne, sur laquelle il serait indélicat de s’attarder, à moins de vouloir gâcher le principal plaisir que peut procurer Rural noir.
En effet, le bon côté de ce roman, c’est que l’intrigue en est plutôt bien gaulée. D’une part les personnages principaux, à défaut de bénéficier d’une psychologie particulièrement nuancée, restent suffisamment forts pour être crédibles : il faut n’avoir jamais mis les pieds dans certains coins – en l’occurrence le Bazois, mais n’importe quelle campagne suffisamment enclavée fait aussi bien l’affaire – pour s’imaginer que l’auteur exagère en mettant en scène quelques-uns de ces marginaux qu’on appelle rednecks aux États-Unis mais pour lesquels il n’existe en français pas de désignation plus précise que cas social. D’autre part, l’alternance entre passé, évoqué au présent et à la première personne, et présent, évoqué au passé et à la troisième personne, donne du dynamisme à un récit qui sans cela eût risqué d’être bien laborieux et à des révélations qui auraient semblé bien artificielles.
Mais il manque une chose au roman : une écriture. Stylistiquement, Rural noir est un désert rural… Je suis sûr, en ouvrant le livre au hasard, d’y trouver au moins un cliché à n’importe quelle page. On m’objectera que le style n’est pas la qualité qu’on recherche d’abord dans un polar ; d’accord, et c’est pour ça que ce policier-là n’est pas une daube. Ou encore, que la pauvreté de l’écriture fait ici écho à la misère éducative, affective, sociale ou morale de la majorité des personnages ; d’accord, mais cela ne doit pas empêcher de trouver dans le texte quelque chose comme un point de vue, un parti pris, une mise en forme – quel que soit le nom qu’on donne à cela.
Car après tout, l’Été des charognes, par exemple, paru la même année que Rural noir, présente aussi le même milieu social ; mais Simon Johannin, sans produire un chef-d’œuvre, et qu’on le partage ou non, avait au moins le mérite de proposer un regard. Rien de tel ici – et tout sympathique que puisse être Benoît Minville, je n’ai pas lu dans son premier roman pour adultes autre chose que de la littérature extrêmement fade à force d’être neutre.