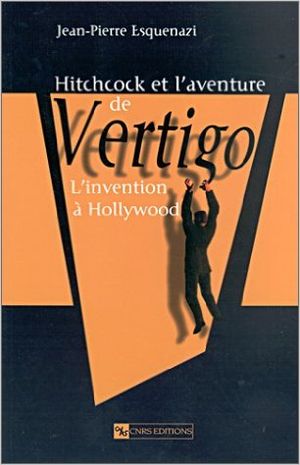Vertigo : un monument, un labyrinthe, un mystère... Comment le comprendre ? Comment l’aborder ? L’ouvrage d’Esquenazi propose de le faire d’une façon peu excitante si l’on s’en réfère à cette manière d’en parler mais ce serait se tromper quant à son intérêt et son importance. C’est avec les armes de la sociologie que l’auteur s’attelle à la tâche et l’on doit reconnaître qu’elles s’avèrent capitales dans les conclusions à tirer de l’aventure de Vertigo. On pourrait même dire qu’il s’agit là du genre d’avancée qui ouvre, un peu comme dans les sports de haute montagne, des voies nouvelles à l’exploration de la question cinéma.
Comprendre Vertigo suppose de prendre plusieurs pas de recul pour vérifier la pertinence du postulat qu’on lui applique, celui d’être un "objet inventif". S’appuyant sur Becker et Bourdieu, Esquenazi s’applique à délimiter très précisément les contours de son travail qui vise à comprendre les rapports entre milieu et innovation dans le contexte singulier du cinéma hollywoodien. L’objet inventif est d’abord un objet parmi les autres (reflétant donc le milieu dont il est issu). Mais il se démarque en ce qu’il "possède le pouvoir de renouveler (…) la signification [de son] contexte ; il est aussi capable de corriger la façon dont, dans ce contexte précis, d’autres objets de l’art seront ensuite produits." Ce modèle (qui s’inspire également de Gombrich) fournit le terme qui résume un peu à lui seul le projet de l’ouvrage, celui de paraphrase. Il ne s’agit pas tant de concevoir avec ce terme l’objet lui-même que le rapport qui le lie à son milieu de référence, la façon dont il reprend et travaille les représentations ou idées qui expriment ce milieu. "La notion de paraphrase rend compte du fait qu’un monde fictionnel n’est pas seulement compris comme un monde imaginaire expressif, mais comme une version possible d’un monde réel (d’un milieu)." La paraphrase prendra tout son intérêt dans le cadre d’une analyse détaillée de Vertigo en révélant les dimensions biographiques, sociologiques, esthétiques à l’œuvre dans le film mais aussi en démontrant qu’elle est partie prenante de la création (comme processus dynamique plutôt que mode de détermination).
C’est d’abord le milieu hollywoodien qui intéresse l’analyse parce qu’il prend la place prépondérante sitôt que l’on cherche à comprendre ce qu’est Vertigo. Vertigo est par essence un film hollywoodien, conforme en tout point aux exigences du système, respectant ses lois et ses idiomes. On connaît ou l’on reconnaît un film hollywoodien à son style et à ses stars. On sait également que ces deux composantes, style ("spectaculaire d’une part, romanesque d’autre part") et star system, participent du système de conventions qui régit tout le cadre. L’industrie hollywoodienne n’est possible que parce que ceux qu’elle emploie (cadres et techniciens) réussissent à s’entendre (même de façon conflictuelle) en vue de délivrer au public ce qu’il demande : des films. Le public constitue la légitimation d’un système de contraintes imposé et accepté par tous les agents de l’industrie (Hitchcock compris), et c’est paradoxalement de ce système que sont sorties les grandes innovations qui ont marqué le cinéma américain (et mondial). Cette première donnée est fondamentale car elle engage déjà une double nature de l’œuvre : à la fois expression des schémas qui la précèdent, des règles qui lui sont imposées, et objet autonome capable d’interpréter ces schémas et ces règles. Côté cour le film possède ses figures (stylistiques) imposées qui induisent des formes identifiables. Côté jardin le film est le résultat du travail convergent ou divergent de plusieurs agents, ce qui constitue une détermination invisible à certains égards mais essentielle à d’autres.
La dynamique particulière du couplage public-industrie se traduit par un style. Ce style procède d’une double détermination : technique (nécessité d’exploitation et de renouvellement) et commerciale (nécessité de proposer des récits captivants). Au spectaculaire des premiers temps la technique et la narrativité adjoignent le romanesque : une combinaison utilisée notamment par David W. Griffith dans les premiers grands films de cinéma, qui renouvelle le statut de l’image cinématographique et le rapport à celle-ci. L’image "n’y est plus l’équivalent d’une scène théâtrale, mais le fragment d’un espace donné comme analogue au nôtre." La mobilité de la caméra et le découpage du récit sont rendus lisibles par la donnée de l’identification : le spectateur "n’est plus l’observateur extérieur d’une attraction, mais l’auxiliaire de l’action, ou même un participant à cette action…" Le couplage apparaît dans le film qui procède d’unités fragmentées recombinées, "l’espace du récit ne devient tel que dans la mesure où le spectateur opère, par induction, les liaisons qui reconstituent un espace plein." Le "style hollywoodien" restera dans le prolongement de Griffith très fidèle à la combinaison spectaculaire-romanesque. Une combinaison déclinée au sein de genres qui deviennent les valeurs indicielles du cinéma hollywoodien. La notion de genre peut être abordée comme la réponse pratique au problème qui sous-tend la conception de l’œuvre dans la version industrielle qu’en fournit Hollywood : "le spectateur doit pouvoir se référer à des produits comparables, tout en aspirant à trouver de l’originalité dans les films nouveaux." Innover oui mais en respectant les schémas organisés en réseaux de conventions et de repères structurants.
Le genre constitue le terrain où s’organise le rapport aux conventions qui n’est jamais entièrement stabilisé. Si les figures (personnages, lieux, situations…) reviennent, la syntaxe de leur utilisation varie constamment. Les croisements sont également possibles (c’est le "mélange des genres" : comédie musicale et western, fantastique et comédie, etc.). Si un film peut avoir plusieurs identités génériques il peut parfois en créer de nouvelles : c’est l’exemple du film noir qui peut être vu comme une reformulation du mélodrame et du film criminel. Ces créations génériques apparaissent aussi comme le reflet des rapports et de leur dynamique au sein de l’industrie (la femme fatale répondant au besoin de créer ou de valoriser des rôles féminins à fort potentiel, donc des stars en puissance qu’il faudra ensuite… gérer). Figure obligée du romanesque, la star personnifie le style hollywoodien jusque dans ses contradictions. "Car ce qu’aime le public, ce n’est pas seulement un type, mais une individualité." La star, particulièrement si elle est une femme, commence par incarner un type social (ingénue, vamp, etc.) puis si les conditions le lui permettent elle crée elle-même un nouveau type (exemples d’Ingrid Bergman et de Bette Davis).
Après cette présentation du milieu hollywoodien vient le portrait d’Hitchcock. Esquenazi se sert des ouvrages de Spotto et Krohn pour dresser le portrait de l’artiste en "homme pluriel" (notion empruntée au sociologue Bertrand Lahire). Hitchcock est d’abord un victorien, issu d’une société profondément conservatrice, attachée jusqu’aux apparences au respect des hiérarchies et des traditions. Hitchcock grandit en solitaire, il s’attachera à le rester, préférant l’organisation du foyer qu’il fonde avec Alma Reville à la vie dissolue des artistes. Mais ce goût de la vie bien rangée est un alibi, "les attitudes et l’apparence de l’homme victorien classique" sont un masque derrière lequel il lui sera possible de cultiver en son for intérieur ses phantasmes et sa soif de transgression. Hitchcock entre dans l’industrie cinématographique à 21 ans comme dessinateur de titres. Il enchaînera tous les postes, de costumier à assistant metteur en scène, ce qui lui permettra d’avoir une vue d’ensemble du travail d’une équipe de cinéma. Hitchcock est un travailleur acharné, il apprend d’abord les styles américains avec le réalisateur George Fitzmaurice puis le style expressionniste à l’occasion d’un séjour professionnel à Berlin. Comme pour bien d’autres réalisateurs à Hollywood, l’expressionnisme aura sur lui une influence déterminante. Il saura en reprendre le principe dans son propre style combinant les points de vue "subjectif" et "objectif" pour exploiter au maximum les possibilités expressives de la narration visuelle. Au victorien et au professionnel s’ajoute le "publiciste" : Hitchcock commence très tôt à "éditorialiser" son travail au travers d’articles où il défend l’importance du metteur en scène et la nécessité de lui confier l’entière responsabilité du film. Il crée en 1930 une petite société vouée à la promotion de ses idées, son nom deviendra une marque qu’il n’aura de cesse d’exploiter (notamment au travers des apparitions où le spectateur est invité à reconnaître la célèbre silhouette dissimulée dans le plan). Ce travail d’autopromotion est au service de l’image qu’Hitchcock donne de lui-même, un "portrait de l’artiste en gentleman hautain et omniscient", maître de son art et de ses émotions.
S’il est vrai que lorsqu’il arrive son "schéma préférentiel" (pour faire simple : faux coupable et MacGuffin) est déjà constitué (cf. Les Trente-neuf Marches pour le film le plus abouti), Hitchcock évolue considérablement au contact d’Hollywood : dans le sens du respect des contraintes imposées par le milieu, des leçons qu’il tire de ses échecs et aussi du sentiment qu’il éprouve de devoir enrichir sa palette. Esquenazi énumère trois transformations qui lui semblent "redevables de l’immersion du cinéaste dans l’ambiance des grands studios : la thématique du pouvoir, l’approfondissement de ses personnages – leur féminisation – et l’émergence de la "blonde hitchcockienne…" La première transformation est redevable de la lutte de pouvoir au sein du sérail hollywoodien. Hitchcock comprend que s’il veut s’imposer il lui faut ajouter une nouvelle personnalité aux précédentes et devenir lui-même producteur. Cette dimension qui pourrait sembler extérieure aux films eux-mêmes est aussi importante que celle de la "féminisation" (c’est-à-dire l’émergence du point de vue féminin et sa prise en compte dans le récit, qui trouve sa source dans la tradition du roman anglais du 19e siècle dans laquelle Hollywood a largement puisé). Hitchcock au contact de Selznick comprend l’importance de la star (notamment féminine) et la nécessité d’exploiter les enjeux psychologiques dont elle est le véhicule. Cette dimension "psychologique" deviendra essentielle au point de constituer l’une des caractéristiques du film "hitchcockien", via les personnages "pathologiques" (masculins – Soupçons, La Corde, L’Ombre d’un doute, L’Inconnu du Nord-Express… – ou féminins – Rebecca, Les Amants du Capricorne, Les Oiseaux, Marnie…) ou mise en musique par le suspense dans des histoires où elle occupe une place centrale (la plupart des films). Quant à la "blonde hitchcockienne" cette expression dissimule le rapport aussi pervers que complexe qu’Hitchcock le victorien nourrit à l’institution hollywoodienne et à la sexualité via les stars féminines qui les représentent toutes deux. La "blonde hitchcockienne" sera en outre (dans les derniers chefs-d’œuvre) une sorte de version de la femme fatale indiquant l’influence du film noir et les transformations opérées sur ce genre.
L’objet de l’étude, le film Vertigo (en français Sueurs Froides) réalisé en 1957, apparaît comme l’œuvre qui condense et problématise toutes les facettes d’Hitchcock l’homme pluriel. La question du pouvoir, celle du rapport aux femmes, l’élaboration formelle, tous ces aspects s’amalgament dans une forme qui constitue à la fois un reflet et une invention. Le contexte dans lequel est créé Vertigo est celui d’une perte de pouvoir : celle d’Hollywood traversé par les crises et devant faire face à la montée en puissance de la télévision, celle plus relative d’Hitchcock qui reste marqué par les échecs de The Trouble with Harry (Mais qui a tué Harry ? 1954) et The Wrong Man (Le Faux Coupable, 1956). Hitchcock est conscient d’occuper une position privilégiée dans l’industrie mais il est aussi conscient de la précarité de cette position qui pourrait bien se modifier s’il n’était plus en mesure de retrouver le succès. A cela s’ajoute un contexte familial tendu (départ de sa fille Patricia qui se marie et s’installe dans une autre région), des soucis de santé (une opération d’urgence), et des déconvenues "sentimentalo-professionnelles" (après Grace Kelly c’est Vera Miles qu’il voulait embaucher pour Vertigo qui lui fait faux bond). La préparation de Vertigo est marquée par des difficultés qui actualisent les "déterminations" préexistantes où l’on retrouve plus ou moins incidemment certains des thèmes ou motifs récurrents des films d’Hitchcock : le héros fragilisé par un handicap qui le rend inapte à l’action (impotence/impuissance), la femme utilisée et/ou dominée (la star sous l’emprise du metteur en scène), la recherche d’émancipation/libération via la traversée des apparences (critique du système et volonté d’affirmation – le réalisateur seul maître d’œuvre).
L’analyse "gombrichienne" de Vertigo est sous-tendue par l’idée d’une reformulation des déterminations (schémas communs ou personnels) dans l’"acte expressif" qui leur donne (ou qui peut leur donner) une nouvelle signification. L’invention apparaît lorsqu’un objet ne se contente pas d’exprimer les schémas d’un milieu donné mais qu’il les "réarrange" en sorte qu’il les charge d’une signification spécifique et personnelle. "Par des reformulations, des aménagements neufs, des juxtapositions inédites ou des appels à d’autres formes idiomatiques, l’acte expressif est susceptible de proposer des innovations discursives." Esquenazi ne relève pas ce point mais il apparaît que l’objet de l’art est travaillé dès le départ par une ambivalence essentielle entre l’ordre du discours et la subversion de cet ordre. L’usage du terme n’est pas neutre car le "discursif" dans le domaine de l’art (histoire et sociologie) renvoie aux débats autour de la reconnaissance de l’œuvre et du statut qu’il convient de lui accorder. L’œuvre d’art est-elle autonome ou dépend-elle du langage (c’est-à-dire des représentations auxquelles elle sert de véhicule) ? Pour aller plus loin que ne le fait Esquenazi dans l’exposé de ses perspectives (et pour anticiper un peu la fin de l’ouvrage) on pourrait dire que l’"invention" dans l’objet expressif déborde le discours : elle est en effet susceptible d’ouvrir à une production discursive qui lui reste subordonnée (plutôt que l’inverse). Le discours ne peut plus l’"arraisonner" (la soumettre jusqu’à la rendre invisible ou insignifiante) car le propre de l’invention tient dans son principe disruptif, sa capacité de montrer la réalité au-delà des modèles et des croyances.
La démarche que suit Esquenazi pour étudier Vertigo consiste à l’aborder scrupuleusement, séquence par séquence mais en se calquant sur sa construction tripartite, en faisant l’inventaire des mondes fictionnels qui lui sont constitutifs, mondes en transformation tout au long du parcours et exprimés en rapport à des idiomes (genre, style, star) que le sociologue utilise à la manière de balises à l’intérieur de sa description. L’intérêt de la méthode est de porter l’analyse dans le détail de la narration en utilisant les balises comme autant de clés permettant de mieux saisir la complexité de la trame qui enchevêtre figures et schémas. Esquenazi énumère dans Vertigo 19 "mondes" (identifiant chacun les différents états que le film traverse et fait partager à son spectateur), 11 "genres" (identifiant un rapport à un genre), 5 "styles" (identifiant une syntaxe et une sémantique visuelle), 10 "stars" (identifiant un emploi et une dimension de la star). L’étude court sur 80 pages et 3 chapitres et permet de délivrer une interprétation de Vertigo dans le détail dont on se rend compte qu’elle laisse finalement beaucoup de liberté quant aux conclusions qu’on peut en tirer (notamment dans l’optique de la "paraphrase").
La paraphrase c’est le "miroir objectif" qui permettra de traduire le récit et la symbolique dont il est porteur dans le langage du monde "réel" (c’est-à-dire social). Vertigo offre 3 niveaux de paraphrase interprétables comme l’énoncé et la critique qu’il formule du paradigme hollywoodien. Premier niveau : paraphrase du film noir. Vertigo entretient un rapport de proximité essentiel avec le film noir. Mais en même temps il le réécrit, ou mieux : il l’analyse. D’abord à travers une dialectique de proximité-distance avec d’autres genres avec lesquels il flirte et qui sont eux-mêmes constitutifs du film noir (policier, réalisme social, mélodrame). La "blonde hitchcockienne" est "une femme fatale "féminisée" (…), plus dense et inquiète que les personnages joués par Rita Hayworth ou Gene Tierney, et moins directement sensuelle." Si le personnage hitchcockien apparaît bien plus complexe, le parallèle entre Kim Novak et Ava Gardner, la femme fatale des Tueurs (The Killers, 1946) fonctionne à plein : "une femme apparaît, image sublime et intouchable, immédiatement prise en charge par le regard d’un personnage masculin. Celui-ci devient le héros du film, qui possédera finalement l’image sublime". On peut ajouter : pour mieux la perdre en conclusion d’une intrigue qui révèle la duplicité du personnage et légitime ainsi la vision "noire" du monde dans laquelle il s’inscrit. Vertigo enchâsse sa propre version de la femme fatale (ainsi que le monde du film noir auquel elle est liée) dans une construction qui la réinterprète : sous l’angle notamment du MacGuffin – l’argument narratif permettant d’exploiter et de se libérer simultanément des conventions. On peut dire que l’une des inventions majeures de Vertigo réside dans la fusion de la femme fatale et du MacGuffin : le MacGuffin est personnifié dans une femme fatale qui n’existe pas par elle-même mais en tant que personnage (représentation) soumis au regard du héros pour l’entraîner dans l’action – la boucle est bouclée. Cette réinterprétation/analyse est d’abord une démonstration : "Le cœur noir de Vertigo répète le texte hollywoodien en en faisant admirer les rouages, et le premier degré de paraphrase du film réside en une répétition savante de secrets de fabrication : la machinerie hollywoodienne y paraît sans défaut, limpide et simple, et l’expressivité hitchcockienne fait la preuve de sa dextérité."
Deuxième niveau de paraphrase : le monde fictionnel de Vertigo apparaît comme un monde double ou plutôt comme un monde qui se dédouble. D’un côté des personnages désenchantés par une vie médiocre ou décevante. De l’autre la passion, le mystère, l’aventure (le pouvoir et la liberté). Les rapports des uns à l’autre qui constituent le récit de Vertigo répliquent ceux que le public du cinéma entretient avec l’usine à rêves. Mais si les uns s’engagent ou se risquent du côté du rêve/spectacle (Scottie, Elster, Judy/Madeleine), d’autres (qui peuvent être les mêmes à un autre endroit du récit) mettent en garde (Midge), résistent (Judy), ou luttent contre l’image pour rétablir le primat de la réalité (Scottie). Le deuxième niveau de paraphrase déploie toute l’ambiguïté du rapport aux images qu’Hollywood produit : des images qui promettent une vie nouvelle mais qui portent en elles, par leur facticité, leur nature illusoire, un pouvoir d’emprise ou de sujétion aux conséquences fatales.
Le troisième niveau de paraphrase : Vertigo révèle un monde de la domination. Elster puis Scottie instrumentent une femme (Judy) pour parvenir à leurs fins (le pouvoir et la liberté pour Elster, l’établissement de la vérité pour Scottie). Au-delà de l’antagonisme des actions et des motivations, c’est leur symétrie qui importe car elle exprime l’habitus d’un milieu et permet de rétablir leur signification cachée. Le troisième niveau de paraphrase donne corps à la critique qui affleure dans la deuxième : "la production hollywoodienne est consacrée à la production d’images féminines, afin d’accroître le pouvoir d’une communauté avide."
L’enseignement à tirer de tout cela c’est que l’invention, dans l’exemple de Vertigo, n’est pas de l’ordre de la rupture. Si la modernité de l’époque cherche à sortir des sentiers battus du classicisme (que ce soit par l’ironie ou la réflexivité chez Wilder, ou la volonté radicale d’indépendance d’un Cassavetes deux ans après), la démarche d’Hitchcock avec Vertigo est plus ambiguë. Le rapport à l’invention y passe par un usage original des conventions, lié à des processus de longue date (la façon dont Hitchcock, homme pluriel, s’affirme face au milieu hollywoodien et au cœur de celui-ci) ainsi qu’aux problèmes posés par un contexte particulier. Elle apparaît dans les termes de l’analyse sociologique d’Esquenazi comme un révélateur : révélateur du milieu par les schémas (conventions) qui le caractérisent et par les rapports que la façon de les employer fait apparaître. Esquenazi relève ainsi : le raccord subjectif (devenu "icône d’un désir masculin de domination"), la femme fatale (devenue "un piège et un prétexte"), la caméra (devenue le "producteur hautain d’illusions"), le mélodrame (devenu le "mirage masquant la séparation absolue des hommes et des femmes").
Reste à mesurer l’intérêt de la paraphrase du côté de l’interprétation : c’est ce que fait Esquenazi en procédant à une revue critique des "interprétations savantes" de Vertigo depuis sa sortie jusqu’à 2001 (date de rédaction de l’ouvrage). On s’aperçoit (Esquenazi nous prévient d’emblée) que la paraphrase qualifie la critique elle-même, c’est-à-dire qu’elle opère la plupart du temps en conformité avec l’un des niveaux paraphrastiques de l’œuvre sans chercher à en comprendre la nature (ce que je qualifierai de réduction "discursive"). Les premiers commentaires sur Vertigo obéissent au premier niveau de paraphrase : Vertigo est un policier/mélo dont l’efficacité est appréciée différemment selon les cas (en raison principalement de sa structure jugée trop complexe – Esquenazi relève cette perle de Jean Dutourd qui regrette que "Kim Novak disparaisse à la moitié du film"). A la fin des années 60 c’est Noël Simsolo qui modèle sa lecture sur le troisième niveau de paraphrase : il s’agit de penser l’efficacité de Vertigo à partir du point de vue de Scottie (en excluant celui de Judy/Madeleine reléguée au rang de "magnifique animal"). Celle d’Eric Rohmer est elle aussi déterminée par le premier niveau (affirmation du film comme manifeste de la valeur maîtrise, le réalisateur "auteur" étant regardé comme un démiurge). Vient le tour des interprétations anglo-saxonnes, plus précises : Sterritt (The Films of Alfred Hitchcock, 1993) met l’accent sur la mise en abyme au sein de Vertigo et fait de Scottie un Pygmalion/metteur en scène devant détruire sa créature pour recouvrer sa puissance perdue (l’interprétation néglige elle aussi le point de vue de Judy). Donald Spoto mise plus sur le biographique. "En tenant compte du personnage féminin, l’auteur peut dépasser l’opposition des deux premiers cercles du film" et se rapprocher de l’analyse structurale faite par Esquenazi (trois niveaux de réalité/paraphrase).
Depuis les années 75 les études accordent plus de place à l’analyse sociale d’Hollywood. Laura Mulvey s’intéresse à Vertigo à travers une lecture de la différenciation sexuelle et de la place qu’accorde aux femmes le cinéma hollywoodien, qui les destine essentiellement à alimenter le "voyeurisme masculin" (interprétation qui constitue la "forme inversée" de celle de Simsolo). Marian Keane reprend l’interprétation en lui adjoignant le point de vue de Scottie et en insistant sur la réflexivité de la structure mise en place par le film, livrant ainsi un commentaire sur les deuxième et troisième niveaux de paraphrase. Ce serait la capacité des acteurs (plus que leurs personnages) qui guiderait Hitchcock pour lui permettre d’"exprimer le caractère implacable du milieu hollywoodien". L’ambiguïté du deuxième niveau est pleinement réaffirmée : "Vertigo n’apparaît plus seulement comme un utilisateur d’Hollywood, mais comme un objet qui se trouve en même temps dedans et dehors, marchand de récit et trafiquant d’illusions." Robin Wood et Tania Modleski se nourrissent également des lectures précédentes pour les nuancer ou les contester (Modleski du côté de Mulvey, Wood plus exhaustif). Ces derniers chercheurs se rapprochent d’Esquenazi dans la mesure où ils sont ceux qui accordent le plus de place aux équivoques et lieux de réflexivité dégagés par le sociologue à travers ses trois niveaux de paraphrase.