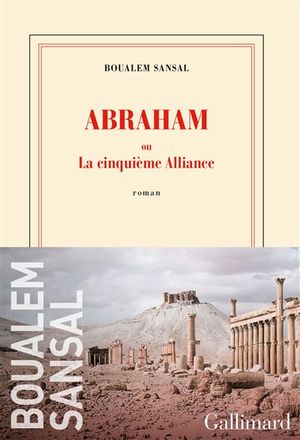A quelque chose, malheur est bon : l'incarcération en Algérie de Boualem Sansal aura au moins eu le mérite de mettre la lumière sur cet écrivain que, pour ma part, je ne connaissais pas. Comme souvent, les avis élogieux paraissant dans la presse m'amènent à choisir l'un de ses opus dans les rayons de la médiathèque. Je choisis Abraham ou la cinquième Alliance, assez intrigué par le sujet.
L'argument : durant la Première guerre mondiale, Abram se voit investi par son père Terah d'une mission divine. Il s'agit d'établir avec Dieu une cinquième alliance, après celles d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed (rappelons que le terme Mahomet est impropre...). Dès le départ, le roman est ainsi placé sous le signe du syncrétisme religieux : Abraham est la source commune aux trois religions monothéistes, Moïse est la figure des Juifs, Jésus celle des chrétiens, Mohammed celle des musulmans. L'idée est donc de boucler le cycle avec une nouvelle alliance œcuménique. D'où le choix d'Abram, appelé à devenir Abraham après son alliance avec Dieu.
Comme dans une reconstitution historique destinée au cinéma, tout a été reproduit comme au départ de l'épopée biblique, s'appuyant sur la Genèse. Chacun a reçu l'un des prénoms de la geste ancestrale : Abram et son épouse Saraï, Loth son neveu, mais aussi des figures moins connues comme Nahor, l'un des frères d'Abram, Seroug, son cousin, Sekkal, Naïm, le prophète Eliezer. La transhumance du clan vers son but, l'ancien pays de Canaan, aujourd'hui Palestine, est émaillées de débats sur la conduite à tenir. Chacun a ses caractéristiques, qui reviennent de conciliabule en conciliabule. Il y a Loth le sceptique, Nahor au contraire plein de foi, Seroug lui aussi convaincu mais également en proie au doute, Naïm et Sekkal les pragmatiques, enfin Eliezer, qui clôt avec pertinence les débats. Terah puis Abram écoutent toujours avec bienveillance, considérant que tout avis a un intérêt. Un choeur ponctue le plus souvent de "hummm hummm !" approbatifs.
Le périple part de Tell al-Muqayyar, nouveau nom d'Ur, passe par Babylone, Hila, Haran, Hébron... A chaque étape, le clan s'installe longuement avec ses troupeaux et prospère, toujours en bonne intelligence avec la population locale, avant de finir par repartir sur un signe de Dieu. Le pèlerinage va durer plus de 30 ans. Régulièrement, le contexte géopolitique est rappelé : d'abord l'inique occupation ottomane qui a précédé la Première guerre mondiale, vite remplacée par la presque aussi détestable occupation coloniale par les Britanniques ou les Français, selon le partage des fameux accords Sikes-Picot. Qui a vu le Lawrence d'Arabie de David Lean
les connaît bien. Puis "l'axe du mal" reconstitué, Allemagne-Italie-Japon, contre la coalition Grande Bretagne-France-Russie-USA, le conflit, comme le précédent, ayant des répercussions sur le Moyen Orient. Boualem Sansal nous rappelle aussi que ce qu'on a mis dans le même sac sous le nom générique d'Arabes regroupait une multitude de peuples. Exemple page 39 :
Terah (...) avait probablement perçu ce que son monde et son temps, marqués par d'incessantes guerres entre les royaumes du nord et du sud, de l'est et de l'ouest de la Mésopotamie, assyrien, amorite, mitannien, hourite, crétois, chaldéen, sumérien, akkadien, cananéen, phénicien, philistin, égyptien, babylonien, judéeen, hittite, grec, mède, etc., etc., avaient d'infiniment oppressant (...)
Divisions auxquelles il ajoute, pour faire bonne mesure, page 173, celles nées des religions : nubiens, moabites, édomites, mariotes, jébuséens, samaritains, arméniens, druzes, sunnites, chiites, zoroastriens, isaméliens, coptes, protestants... n'en jetez plus, le calice est plein !
Tout n'est pas de la responsabilité des Occidentaux : Sansal rappelle que jamais ces peuples ne parvinrent à s'entendre. Une division dont les colonialistes tirèrent profit, imposant leur tracé au cordeau, sans tenir compte de la diversité des ethnies et en oubliant certains, au premier rang desquels les Kurdes.
Le roman se compose essentiellement de trois types de récits :
- celui de l'épopée du clan, guidé d'abord par Terah puis, à sa mort, par son fils Abram ;
- les échanges des principaux chefs de ce clan, cités plus faut ;
- le contexte international, allant de la Première à la Deuxième guerre mondiale, s'achevant avec la création de l'Etat d'Israël.
J'avoue avoir pris peur, constatant que nulle autre péripétie que celle de la Genèse n'allait être contée. Eh bien, étonnamment, c'est à mettre au crédit de Boualem Sansal, le roman n'est jamais ennuyeux. Bien sûr, on le déconseillera aux athées, voire aux agnostiques, qui risquent de mal vivre cette ode à la foi. Le lecteur croyant mais rétif au cléricalisme, comme il y en a beaucoup aussi chez nous, se réjouira de constater l'égal respect avec lequel Abram traite Moïse, Jésus et Mohammed, sans jamais les opposer, les présentant au contraire comme issus d'une histoire commune. Les antagonismes, explique Sansal, ont été largement stimulés aussi bien par les extrémistes de tout poil côté "arabe" que par les Occidentaux, selon la fameuse stratégie consistant à diviser pour mieux régner.
Alors bien sûr, même si globalement j'ai trouvé le discours bienfaisant, j'ai parfois tiqué : lorsque Abram parle de l'arbre de Mamré comme seul vestige du jardin d'Eden par exemple. L'histoire du jardin d'Eden et du péché originel est un mythe, très fécond, une parabole pour dire ce qui fait l'essence de l'homme. Pas un événement historique ! De même, je crois pour ma part que le péché originel ne raconte nullement une "trahison" de Dieu par Adam et Eve, ça c'est le charabia catho destiné à culpabiliser le croyant. Page 240 : "Dieu pardonnera-t-Il un jour la trahison d'Adam et Eve ?" Comment imaginer qu'un être de pur amour puisse se poser la question de pardonner ? Si tant est qu'une telle notion soit adéquate pour parler de la divinité... Errance d'un anthropomorphisme que partagent les trois religions monothéistes. Je préfère de loin le langage employé page 236 :
A ses prophètes, Dieu donne peu à voir, à entendre, à comprendre mais à qui le communiqueraient-ils, pour le commun ce peu est déjà l'infini et l'au-delà réunis dans un point à mille dimensions ? "Mon royaume n'est pas de ce monde", disait Jésus au préfète de Judée, Ponce Pilate, qui lui demandait s'il était bien le roi attendu des Juifs.
Parler du néant est déjà le matérialiser, car on en parlerait comme d'une chose, or il n'est pas une chose, il est le Néant, vide de toutes choses, de toutes significations. Et que dire du Tout ? Prononcer seulement ce mot lui donne une forme, le confine dans un espace et un temps, or le Tout comme le Néant est inconcevable, car après le Tout il y a le Tout au double, au triple, et ainsi jusqu'à l'infini, vocable qui se borne lui-même dès qu'on le prononce ; parler du Tout c'est le ramener à l'une de ses parties, certainement la plus petite, celle que notre cerveau peut contenir. Comment alors parler de Dieu qui est le Néant et le Tout réunis par-delà le Néant et le Tout ?
Ce paradoxe insoluble me parle bien davantage que les histoires de bonhomme barbu courroucé parce qu'on lui a désobéi... Et c'est parce que cette contradiction est insoluble (on pourrait ajouter que parler d'une partie d'un Tout est déjà un contresens) qu'elle est passionnante à creuser. J’en suis convaincu : si Dieu il y a, il est à chercher dans le paradoxe.
Mais le roman de Sansal n'est pas un traité de théologie ni de méditation métaphysique. C'est davantage un conte un peu naïf, celui d'un peuple décidé à faire revivre le passé en le revivifiant, alors que le monde a tant changé. C'est aussi un appel à la concorde, qui rappelle que tous ces courants religieux en guerre les uns contre les autres puisent à la même source.
Quelques critiques tout de même, sur la forme. Si le roman est joliment écrit, on y rencontre de temps en temps des changements de temps mal négociés, chose devenue courante. Exemple page 175 : "Nous avons recueilli des orphelins de guerre qui erraient par les routes, et aux côtés de nos enfants nous leur apprîmes les vertus de la vie nomade (...)". Abandonner le passé composé pour le passé simple est délicat à opérer, c'est ici raté. Idem page 215 par deux fois, dans un sens puis dans l'autre :
Saraï a pris peur, elle a cru que j'étais fou et que ça allait mal tourner pour elle. Elle se couvrit de son voile et se précipita chez Milca (...)
Au troisième jour, je revins à la vie sur terre, tout excité, avec l'impression de rentrer d'un voyage fabuleux. Je me suis débarbouillé, me suis sustenté (...)
Je me dis toujours dans ces cas-là : mais que fait l'éditeur ? C'est quand même Gallimard...
Pour agaçantes que soient ces faiblesses, elles sont une goutte d'eau dans l'océan d'une impression positive. Belle épopée que signe là Boualem Sansal. Qu'on ne laissera pas, espérons-le, moisir dans les geôles algériennes. La foi qu'évoque l'écrivain ne sera pas de trop pour le libérer, tant son cas est instrumentalisé à des fins politiques entre la France et l'Algérie...