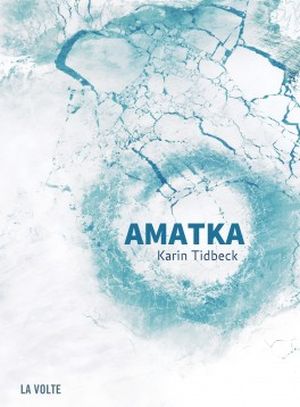Cela faisait longtemps qu’un roman ne m’avait pas laissé sceptique, du moins au premier abord. Amatka est en effet un récit qui ne se livre pas immédiatement, frappé du sceau d’une banalité dont le prosaïsme apparent finit par intriguer. Implantée en terre étrangère, dans une contrée dépouillée de toute aspérité, une toundra glacée traversée par une unique voie ferrée, Amatka est une colonie au quotidien monotone où se répète une routine établie par un comité lointain. Un collectif isolé où la dissidence est proscrite et le libre arbitre traité avec la plus grande sévérité afin de préserver le caractère tangible de la société et de l’environnement. Dans ce monde, l’existence s’apparente à une page blanche où se répète sans cesse la même phrase dictée par la volonté d’une communauté assiégée, en proie à une menace indicible.
Amatka est un roman bizarre, une fable politique nous dit la quatrième de couverture. Sur ce point, on ne peut que suivre l’avis de l’éditeur, subodorant même une certaine parenté avec Les Dépossédés de Ursula Le Guin, du moins pour son paysage désertique et le modèle social décrit, un vague collectif anarcho-communiste. Mais là où l’autrice américaine souligne le caractère ambigu de son utopie, développant son propos dans un décor de science fiction, Karin Tidbeck choisit le cadre de la métaphore, jouant du pouvoir de réification des mots jusque dans son récit.
À Amatka comme dans les autres colonies, on nomme en effet les objets, poussant ce rituel jusqu’à inscrire leur nom au marqueur, de peur de les voir se dissoudre et revenir à leur état initial de pâte molle et grisâtre. À Amatka prévaut une discipline de fer, ne tolérant aucun écart depuis qu’une des cinq colonies a fait dissidence, entraînant un cataclysme dont on garde encore un souvenir effrayé. À Amatka règne le bonheur d’une vie simple et codifiée, au prix de l’immutabilité, de la perpétuation de la médiocrité et d’un contrôle absolu du langage. La règle est simple : une chose ne peut être si elle n’est pas nommée et ce qui est, doit être dit pour exister.
Envoyée à Amatka pour réaliser une enquête sur les besoins et pratiques de ses habitants en matière d’hygiène, Vanya n’est sans doute pas la fonctionnaire idéale pour accomplir cette tâche. Dans sa jeunesse, elle a flirté avec l’interdit et son père a été arrêté en raison de son attitude subversive. Ramenée vers l’orthodoxie, elle a échappé au pire, reniant son géniteur pour pouvoir retrouver sa place au sein du collectif. Mais, Vanya est restée trop curieuse pour son propre bonheur et pour l’équilibre social de la communauté.
Dans un monde figé et glacé, où les certitudes se délitent peu-à-peu en dépit du strict contrôle social, Karen Tidbeck reprend à son compte le concept du pouvoir libérateur et créateur des mots, dénonçant l’emprise de l’État qui cherche à en détourner le sens afin de perpétuer un modèle politique considéré comme indépassable. A l’heure de la communication politique et des éléments de langage, on ne peut pas rester insensible au parcours de Vanya et à sa révolte silencieuse. On ne reste pas davantage réfractaire à l’atmosphère d’un roman où l’autrice parvient à rendre tangible le malaise, tout en nous faisant ressentir l’immobilisme mortifère d’un monde étouffant jusqu’à l’asphyxie.
Grand amateur de dystopie, je ne pouvais laisser de côté ce roman dont diverses éminences de l’Internet avaient dit grand bien. L’effort relatif pour dépasser les cent premières pages, vaincre l’ennui insidieux, a finalement été récompensé. Amatka est un excellent roman, que dis-je, une lecture indispensable dont le propos interpelle, invitant le lecteur à réfléchir sur le pouvoir des mots en politique et, d’une manière plus générale, illustrant par l’exemple le caractère démiurgique de la littérature.
Source