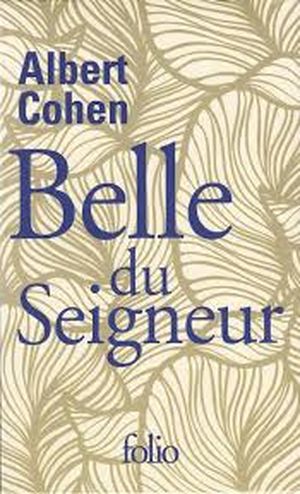Comment ce départ, je veux dire cette fin de roman peut-elle laisser sans voix ?
On quitte ce livre comme un poème, comme un amoureux, comme une musique composée de je t'aime et de je te hais. On ne s'en remet jamais vraiment, je préfère vous prévenir. Lu ce livre dans ma 16ème année, encore bouleversée par l'adolescence et ces cruelles ascensions, gouffres de désir et de fantasmes inassouvis. On ne s'en remet pas, surtout lorsque c'est l'été et que le soleil pointe sur la terrasse, caressant votre corps bronzé et ces bordures, ailes de la jeunesse encore neuve et immobile et que Solal arrive, majestueux, arrogant et chaste de vie, un dieu comme seuls les romans peuvent en créer (mais ne s'inspirent-ils pas de la vie), couché sur le papier. On commence ce roman avec l'idée néfaste qu'il est long, trop long, beaucoup trop long. On aime lire, on est un lecteur, on veut le lire, mais les mille pages, ça peut en décourager plus d'un. "Tant pis pour les lecteurs paresseux, j'en veux d'autres" comme disait (à peu près) André Gide. Je crois que sans me tromper, Cohen pensait la même chose : ce livre demande du temps, de la réflexion, d'être posé malgré tous les efforts du lecteur pour le dévorer à toutes heures du jour (et de la nuit, ô oui la nuit !) et de le reprendre ensuite, après une brève pause. On mange ce livre comme Solal digère son amour avant même de l'avoir commencé : jamais roman n'avait autant servi le contenu de par sa forme. Ces mille pages sont nécessaires pour montrer la mesure et la force du temps sur la passion, même la plus profonde. Un réel lecteur ne s'avouera jamais vaincu face à un pavé, le pavé n'étant qu'obstacle minime face au plaisir de la lecture et ses mots, déséquilibres du moment entre soi et ses mondes enveloppés dans des pages. Mais la passion, mangée par le temps, faiblit inévitablement et c'est une indigestion monstrueuse qui menace le lecteur face à Belle du seigneur. Après les métaphores par dizaines, les pages ENTIERES de "racontages" de divers personnages et même des dérives absurdes de notre ami (génie !) qu'est Solal, on pense à mourir avec eux plutôt que de les perdre. Qui ? Les personnages. On ne peut se résoudre à penser sincèrement que ce livre n'est qu'un livre, plongé dans la masse informe des romans rayon littérature de la fnac (ou autre, j'ose espérer pour vous) et quiconque ayant lu et compris ce roman ne pourrait le nommer sur le même ton qu'un autre roman lu après ou avant. Ce n'est pas un roman. Cohen nous susurre des mots à l'oreille, comme écrit pour nous, pour nous "frères humains" de la race humaine, humainement faible et désorientés face à la beauté et la cruauté de cette même vie que nous partageons tous et si humainement humains face au sublime qu'est l'amour pour les quelques chanceux qui ont le sort de connaître cela un jour. Ce livre nous laisse coi, sans voix, incompris plus que jamais car désormais compris par quelqu'un : Cohen, Solal, les deux, peu importe ? ceux-ci appartiennent aux chimères. On ne peut se résoudre à le fermer ce putain de livre, on ne peut que résister à l'envie de lui crier : et je fais quoi maintenant ? Maintenant que tu m'a séduite, conquise, aimée, embrassée, malmenée, déchirée, possédée, tuée ? Que puis-je faire maintenant, toi seul qui me comprends , "ô toi que j'eusse aimé" ? Comment revenir à la vie après avoir lu Belle du seigneur ? Ce livre nous laisse sans ressources, seul(e) parmi les autres sans attraits, déterminé(e) à oublier les visages surannés de Solal et Ariane à toutes les stations de métro bondées. On ne peut s'y résoudre, vraiment. Cohen ne nous donne pas le mode d'emploi pour la vie après ça. Alors on le relit en se donnant des périodes obligatoires d'attente entre deux lectures pour mieux en jouïr, comme Ariane relisant les lettres de Solal jusqu'à les sucer à la moelle. On apprend des citations par cœur, on se les récite, on écrit des poèmes sur eux, sur leur départ, sur combien on les déteste de nous laisser comme ça, maladroit avec la vie, combien on les aime, combien il est aisé de perdre la tête, perdue dans le métro bondé, entourée de Solal(s) qui n'en on n'y l'étoffe ni le charme. On a beau en vivre, des histoires, elles ne sont que peaux mortes.
On écrit les mots de Cohen partout, sur du papier d'abord, du bois, des livres écornés, des notes de bureaux, des bancs dans les parcs et puis quand le support mort ne suffit plus, on passe à la chair et les mots, enfin, retrouve leur encre souillée dans leur berceau, notre corps.
Je relève la tête après avoir écrit ces mots d'une traite, sans formes et sans repères. Je lis ceux que j'avais recopié il y a trois ans , sur le mur blanc de ma chambre, lors de ma première lecture de ce monstre :
"Agenouillés, ils étaient ridicules. Ils étaient fiers et beaux, et vivre était sublime".
Et vivre était sublime...