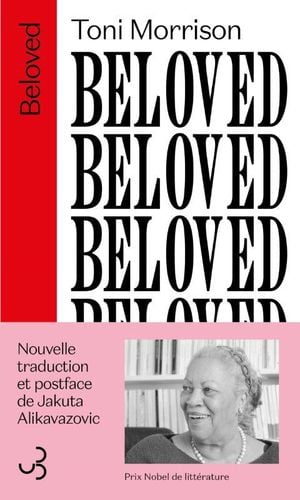A travers son cinquième roman, Toni Morrison aborde la thématique de l’esclavage aux Etats-Unis par un angle spécifique, intime, celui du vécu des personnes esclavagisées et des conséquences de l’esclavage sur leur psychée.
En termes de narration, ce roman est déstabilisant, on peine parfois à comprendre qui parle, car les systèmes narratifs de première et troisième personne alternent, parfois d’un paragraphe à l’autre. Dans la continuité, la composition du texte est particulière : le récit de la vie de Sethe, de sa fuite, du “Malheur” et celui de Paul D. ne nous sont dévoilés que dans les dernières pages, ce qui crée un effet d’attente qui permet, selon ma lecture, de restituer la difficulté et la douleur du processus mémoriel. Car ici, ce ne sont pas les faits qui importent mais la façon dont ils sont expérimentés par le sujet esclavagisé, et la romancière parvient à restituer l’horreur de leur vécu par un texte poignant et certains extraits lyriques. Le mélange entre prose et vers enrichit également le récit, lui conférant une dimension orale qui souligne l’importance de la parole et du chant pour les personnages.
Le genre de ce texte, que la traductrice désigne comme réalisme magique, explique le recours à une apparition fantomatique pour construire le récit. Si ce choix se justifie totalement dans le système narratif de l’autrice, tant il permet d’amener des thématiques importantes comme l’obsession ou le remords, ma préférence pour les systèmes réalistes perdure et cette dimension fantastique constitue une des limites du texte, selon de ma lecture.
De belles images restent en mémoire une fois le livre fermé, je pense à celle de la blague à tabac de Paul D, et contrastent avec la violence des récits de maltraitance, renforçant leur pertinence. Par ce roman, Toni Morrison donne chair à des événements historiques réels (comme précisé dans la postface) et parvient ainsi à médiatiser le processus mental infligé par l’esclavage, notamment aux femmes et aux mères.