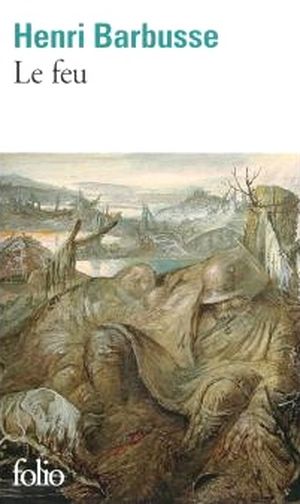En rédigeant Le Feu, Henri Barbusse parvient à projeter sa lectrice·son lecteur dans les tranchées, avec ses compagnons. Les ambitions de ce roman, nombreuses, se révèlent au fil de la lecture : retranscrire le parler réel des poilus, témoigner de leur vécu contre l’oubli qui caractérise l’humain, soit dire le réel de la Grande Guerre. Le contraste entre la prose poétique de Barbusse et les paroles de ses compagnons souligne la dureté des faits décrits : relations de fraternité liées avec des inconnus, violence des combats, des décès, désolation et destruction de la nature… L’auteur ne laisse pas de côté les enjeux sociaux et politiques de l’événement, qu’il traite avec une grande justesse, révélant la discrimination de classe responsable de l’envoi des hommes prolétaires au front, alors que les bourgeois restent à l’arrière à fantasmer sur la beauté des combats et l’esthétisation de la violence. Le dernier chapitre rompt le système narratif pour se muer en une adresse directe, dans laquelle l’auteur livre son point de vue sur la guerre et son inanité, dévoilant des idéaux communistes dès 1916, avant même la Révolution russe. Publié au début du XXème siècle, le texte témoigne aussi de biais (sexisme, racisme dans la description des tirailleurs Nord Africains) qui révèlent le rapport au monde des Poilus, et contribuent à en faire un roman intéressant par la fenêtre qu’il ouvre sur une partie de l’Histoire, vécue par des êtres incarnés.