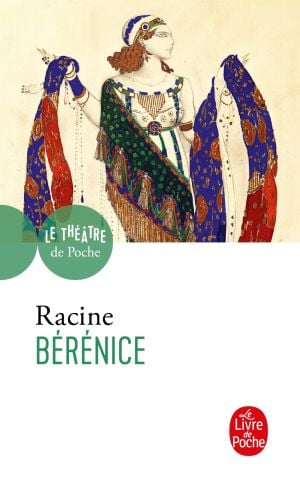Dans la préface de Bérénice, Racine envoie promener l’abbé Montfaucon de Villars, une espèce de curé frustré de ne pas avoir de talent qui se moque du nombre de « hélas » qu’on trouve dans la pièce, et répète à tout va que Bérénice n’a aucun intérêt tant il ne s’y passe rien. Il n’a pas totalement tort, après tout combien de personnes vous ont répété en mentionnant cette pièce qu’elle aurait pu être résumée en un seul acte ? Après tout il ne s’agit que d’un très, très long adieu en cinq actes.
Alors, Bérénice, une pièce inutile ? Une pièce profondément ennuyeuse tant il ne s’y passe rien ? Une pièce agaçante tant le pathos semble exagéré ?
Globalement, Racine explique à Villars qu’il n’est qu’un gros con qui n’a rien compris, "un homme qui ne pense rien" : on ne lit pas une pièce pour évaluer si oui ou non elle correspond aux codes classiques de la tragédie. On lit Bérénice pour ressentir. Pour éprouver des émotions. Pour pleurer. Pour prendre du plaisir.
Ils ont cru qu’une tragédie qui était si peu chargée d’intrigues ne pouvait être selon les règles du théâtre. Je m’informai s’ils se plaignaient qu’elle les eût ennuyés. On me dit qu’ils avouaient tous qu’elle n’ennuyait point, qu’elle les touchait même en plusieurs endroits et qu’ils la verraient encore avec plaisir. Que veulent-ils davantage ?
Dans sa préface, Racine souligne combien son but est de « plaire et émouvoir », rien de plus. Mais oserait-on réduire Bérénice à sa seule poésie élégiaque ? Non, bien sûr que non. Racine est bien plus brillant, bien plus intelligent que ça. Il serait terriblement réducteur de ne voir Bérénice que sous un angle esthétique, qui est, il faut l’admettre, splendide. Le sujet se prête merveilleusement, d’ailleurs, à cette rêverie poétique : une princesse de Palestine belle comme la nuit, un empereur romain dans toute sa gloire, la Rome majestueuse, un Antiochus amoureux de Bérénice, laquelle ignore ses sentiments, et qui s’est tu pendant des années par peur qu’elle le repousse si elle savait ce qu’il ressentait pour elle.
Ce qui m’a frappée en lisant cette tragédie, c’est l’humanité de ses personnages. On est loin des personnages victorieux, puissants, triomphants de Corneille, qui ont une maîtrise totale d’eux-mêmes et du monde :
Je suis maître de moi comme de l’univers
Je le suis, je veux l’être. Ô siècles, ô mémoire
Conservez à jamais ma dernière victoire.
Et à côté, nous avons Titus :
Maître de l’univers, je règle sa fortune ;
Je puis faire les rois, je puis les déposer :
Cependant de mon cœur je ne puis disposer.
Constatant sa maîtrise du monde, Titus n’a pas la fierté d’Auguste, car elle s’accompagne de son malheur personnel : devenant empereur, il se doit de renoncer à Bérénice. Titus en pleure, comme le constate la femme qui l’aime et qu’il aime : « Vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez ! »
En Titus s’incarne la passion amoureuse, la faillibilité de l’être et le sens du devoir à l’égard de son peuple et de ses dieux. Titus renonce à lui-même, à sa Bérénice, à l’amour, pour assumer le nouveau corps immortel qui habite dorénavant en lui : il est empereur. Lui qui n’était qu’humain, corps mortel, doit assumer la divinité de sa charge. Et dès lors que ces deux corps coexistent en lui, il se doit, en quelque sorte, de mourir à lui-même : « Mais il ne s’agit plus de vivre, il faut régner. »
Le moi amoureux doit alors être sacrifié au moi régnant : en évoquant le projet de renoncer à l’empire pour l’amour, Titus déclare :
Sont-ce là des projets de grandeur et de gloire
Qui devaient dans les cœurs consacrer ma mémoire ?
Depuis huit jours je règne ; et jusques à ce jour,
Qu’ai-je fait pour l’honneur ? J’ai tout fait pour l’amour.
J’aimerais alors mettre quelque chose au clair : vous connaissez sûrement la théorie de Barthes selon laquelle Titus n’aimait pas Bérénice, mais aimait Rome, et que c’est pour ça qu’il la quitte. Permettez-moi de remettre cela en cause: rien dans la pièce n’indique que Titus n’aime pas, ou plus Bérénice ; au contraire, il n’a jamais été plus amoureux d’elle, il l’aime comme un fou, il est déjà mort à lui-même tant il l’aime. Elle est la femme qui lui a donné envie de changer alors qu’il était encore jeune, jouisseur, décadent. Alors qu’il la voit et la rencontre pour la première fois :
Bérénice me plut. Que ne fait point un cœur
Pour plaire à ce qu’il aime, et gagner son vainqueur ?
(...) Mais le sang et les larmes
Ne me suffisaient pas pour mériter ses vœux :
J’entrepris le bonheur de mille malheureux.
On vit de toutes parts mes bontés se répandre :
Heureux ! et plus heureux que tu ne peux comprendre,
Quand je pouvais paraître à ses yeux satisfaits
Chargé de mille cœurs conquis par mes bienfaits !
Je lui dois tout Paulin. Récompense cruelle !
Tout ce que je lui dois va retomber sur elle,
Pour prix de tant de gloire et de tant de vertus,
Je lui dirai : « Partez, et ne me voyez plus. »
Bérénice lui a donné la force de changer, lui en a avant tout donné l’envie. À quoi n’est pas prêt un cœur pour conquérir celui qu’il aime... Du moment où il a aimé Bérénice, Titus s’est mis à aimer le monde, son prochain en quelque sorte. Vous me voyez venir ? Son prochain...
Pour le rappel, Racine est janséniste. C’est un homme pétri de religion, élevé chez les curés, qui a écrit l’histoire d’Esther, qui lit la Bible en grec et en latin, bref, il s’y connaît. Et ces quelques mots de Titus viennent de renverser tous ces argumentaires comme quoi Bérénice n’est que le plus illustre exemple de la poésie élégiaque du XVIIe siècle. Cette tragédie est bien plus que ça : elle est l’élévation d’un homme vers la grâce du monde par l’intermédiaire de celle qu’il aime. De fait, la réinterprétation chrétienne par Marsile Ficin de ce mouvement ascendant qu’expose Platon dans Le Banquet s’y applique parfaitement : par la fascinatio éprouvée pour la femme aimée, l’amor humanus de l’homme se transcende et se sublime en amor divinus. Bérénice initie en Titus un dépassement de lui-même, une élévation d’Eros vers Agapè, de l’amour-propre vers l’amour du prochain. Bérénice a été une révélation, une ouverture à l’amour du monde. La charge d’empereur que Titus reçoit à la mort de Vespasien est alors la confirmation que Titus ne s’appartient plus, de même qu’il n’appartient plus à Bérénice : il appartient à Rome, au monde, à l’Empire. Il ne peut plus se contenter de n’aimer qu’une femme, il lui faut aimer l’Homme, et se consacrer toute sa vie à ce dernier, et l’accession à l’Empire est la cristallisation de cette nécessité :
Mais à peine le ciel eut rappelé mon père,
Dès que ma triste main eut fermé sa paupière,
De mon aimable erreur je fus désabusé ;
Je sentis le fardeau qui m’était imposé
Je connus que bientôt, loin d’être à ce que j’aime
Il fallait, cher Paulin, renoncer à moi-même ;
Et que le choix des Dieux, contraire à mes amours,
Livrait à l’univers le reste de mes jours.
Titus ne cite pas la Rome invoquée par Barthes comme la cause de sa séparation avec la princesse de Palestine : il mentionne le choix des Dieux, qui lui ont fait le don on pourrait dire empoisonné du corps immortel de l’empereur, qui s’annonce incompatible avec l’amour exclusif qu’il porte à Bérénice : c’est pourquoi il doit renoncer à lui-même. L’obstacle n’est alors pas tant politique qu’ontologique : Titus est voué, intrinsèquement, à renoncer à ses amours humaines pour se consacrer à l’univers.
Titus a déjà pris sa décision au début de la pièce de quitter Bérénice, il n’est pas face à un dilemme, il n’est pas déchiré entre deux choix opposés, se séparer d’elle ou demeurer à ses côtés. La tragédie est cette longue attente de Bérénice, et ce combat douloureux de Titus qui doit lui annoncer qu’il renonce à elle. Bérénice lui a fait aspirer à l’absolu : en la quittant, il ne renonce pas à l’amour, mais il renonce à le vivre sur un plan humain pour le porter à son plus haut degré, qui ne s’atteint pas dans l’union, mais dans la séparation. Il la quitte pour aimer davantage. Son règne sera alors un hommage à cette femme qui a fait de lui un être meilleur, un être aspirant à l’exemplarité. L’amour s’est spiritualisé.
Il n’empêche que cela est la cause d’une grande douleur tant pour elle que pour lui :
Gémissant dans ma cour et plus exilé qu’elle, [Bérénice]
Portant jusqu’au tombeau le nom de son amant,
Mon règne ne sera qu’un long bannissement.
Une fois qu’il a révélé à Bérénice son choix, Titus ne parle plus beaucoup : sa parole tragique s’achève ; il n’a plus rien à dire. C’est alors à Bérénice de faire le sien, de quitter le rêve de son union avec celui qu’elle aime et qu’elle aimera à jamais. Elle apprend alors la douleur du renoncement, et emprunte le chemin du calvaire sur lequel cheminait déjà Titus depuis le début de la pièce :
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?
Que le jour recommence et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?
Bérénice doit concevoir l’inconcevable, et sa parole élégiaque ne se charge pas de pathos, de lourdeurs tragiques ; épurée et transpercée de souffrance, elle est néanmoins maîtrisée et à la fin confine au sublime et s’approche alors de ce que Racine appelle une « tristesse majestueuse ». Bérénice, au terme de l’acte final, embrasse sa destinée liée à celle de l’empereur : une union dans la séparation. Tous deux s’aimeront toujours, malgré la distance, malgré le corps immortel de l’empereur, malgré leur déchirure. Cet amour sublimé, spiritualisé, divinus, est cet amour auquel Antiochus ne parviendra jamais.
Antiochus, le roi de Commagène, fou amoureux de Bérénice depuis leur première rencontre, qui voile son amour d’amitié afin de pouvoir demeurer auprès d’elle, en passant pour son ami, son confident. En d’autres termes, Antiochus est dans la friendzone (que désormais dans ma classe nous appelons le « complexe d’Antiochus »). Antiochus demeurera dans cet amor humanus, à la fois amant parfait de la littérature galante, car tendre, délicat, fidèle, amoureux transi... mais aussi amant pathétique, furieux, désespéré et presque violent : il menace même Bérénice de mourir, et lui en veut d’en aimer un autre que lui, alors que lui l’aime depuis plus longtemps que Titus. Il l’accuse même d’avoir oublié qui elle était, et d’où elle venait, depuis qu’elle aime Titus, alors qu’elle n’a jamais cessé d’être une fidèle amie pour lui, et qu’elle ne lui a jamais fait espérer plus. Il décide alors de partir, ce qu’on pourrait louer : aimer, c’est aussi savoir renoncer à l’autre quand celui-ci ne veut pas de nous : « Ne donne jamais un cœur qu’on ne peut recevoir. »
Mais Antiochus a quand même la faiblesse de vouloir être plaint :
Je pars, fidèle encor quand je n’espère plus.
Au lieu de s’offenser elle pourra me plaindre.
Sa plainte élégiaque trahit combien il refuse de renoncer à Bérénice : il est incapable de se défaire d’un espoir qu’il se refuse à croire complètement vain. Il reste englué dans ses illusions qui lui laissent croire qu’un jour peut-être Bérénice lui accordera son cœur. Il est celui qui prononce le dernier « hélas ! » de la pièce, très révélateur de son état : alors que l’heure n’est plus au regret ni à la plainte, il demeure à jamais esclave de ses émotions et de ses désirs, tandis que Bérénice et Titus ont gravement accepté de se soumettre à la volonté des dieux.
Bérénice, c'est la tragédie des larmes, la tragédie élégiaque, mais aussi la tragédie de l'amour, de la déchirure, du sacrifice, de la séparation, d'une certaine violence même, du renoncement. Mais c'est également quelque part une tragédie de la grâce, de l'élévation vers quelque chose qui dépasse ses personnages. La tragédie d'un amour absolu.
Il y a une passion si dévorante qu’elle ne peut se décrire. Elle mange qui la contemple. [...] On frémit de la nommer : c’est le goût de l’absolu.