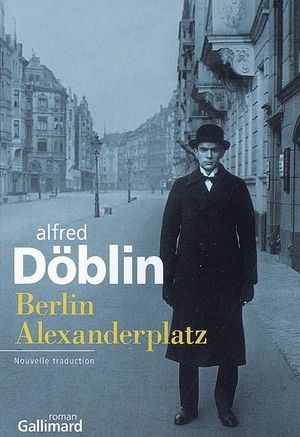Dans ce Berlin des années 20, aucune trace de hipsters à moustache. L'ambiance est plutôt Oktoberfest, un bar tous les trois mètres, bières, schnaps et cochonaille à foison. Au milieu de tout ça le fraîchement libéré Franz Biberkopf, aussi roublard que naïf, doté de bonnes intentions mais dénué de grands principes. Mi-Knut l'ourson mi-Harald Schumacher.
Döblin conte les bas-fonds, les petits métiers, les gagne-pains illégaux dans une langue de prolo accidentée, à la syntaxe freestyle, bourrée d'argot et de tics, où les dialogues et les bruits se superposent à la narration. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais ce style super vivant donne vraiment son âme au roman, comme un parler chaotique venu se caler sur ce Berlin grouillant et piégeux.
Faut prévenir, les 240 premières pages sont spéciales. L'intrigue est volontairement décousue, ça digresse sur tout et n'importe quoi, parfois par des saynètes mystérieuses d'un paragraphe ou deux, dans des contextes qui n'ont aucun lien avec le roman si ce n'est métaphorique. Certains moments réussis servent la toile de fond du roman, d'autres sont simplement fatigants. Sensation de longue intro dans laquelle on se demande parfois où l'auteur veut en venir.
Alors forcément, si je colle un 8 c'est que ça devient très bien après. Le déclic c'est l'arrivée du voyou Reinhold, véritable nemesis de Franz. Leur relation devient la colonne vertébrale du récit, celle qui va provoquer les bonnes et les mauvaises rencontres, l'arrivée des grosses emmerdes mais aussi la construction d'un entourage protecteur. De quoi faire naître des enjeux précis, vécus avec les tripes, dans cette langue cabossée qui donne aux émotions un aspect brut et authentique.