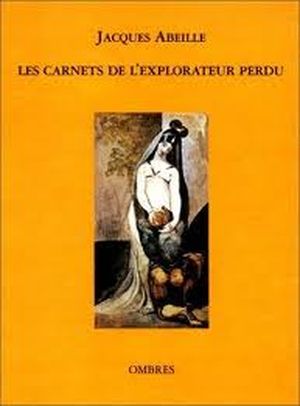Et il y a cette écriture dense et déliée, qui ressemble à du marbre liquide, qui mobilise les troupes de réserve de la syntaxe en état d’alerte, dont on ne saurait dire si elle devient classique à force d’écarts ou marginale à force de classicisme. « Si je voulais dire ce qui nous distingue, nous autres gens des hameaux, de ceux qui vivent plus bas sur les terres grasses qui bordent le fleuve tandis que nous demeurons accrochés à nos maigres pâtures et à nos lourdes demeures rencognées sous la lisière de la forêt, je parlerais des loups » (p. 41).
Les volumes du Cycle des Contrées pourront gagner de plus en plus de lecteurs, ou tomber dans un oubli complet, ils ne seront jamais ni modernes, ni vieux. En ethnologue d’un pays qui n’existe pas, Jacques Abeille mêle la légende, dans ce qu’elle a de plus archaïque, et la condition humaine dans ce qu’elle a d’universel. « Tandis que la ville se relevait et reprenait son rang, quelques savants entreprirent de réfuter ce que déjà on donnait comme une fable » (p. 9-10) : quelquefois ses légendes parlent explicitement de ses légendes – d’où peut-être la dimension atemporelle. (Dans un un registre un peu différent, c’est ce que fait aussi la Mort du roi Tsongor de Gaudé, qu’on pourrait rapprocher de certaines pages des « Cavalières ».)
Créer des mondes. Jacques Abeille, donc, n’est pas le seul à le faire. Des mondes aussi riches y compris dans ce qu’ils ne racontent pas, ces auteurs-là sont déjà plus rares. Et procéder à cela avec cet air de ne pas y toucher, je vois seulement Borges (1), là encore dans un registre un peu différent, que Jacques Abeille puisse environner. (Je parle bien de créer. Pas de recréer ou de transfigurer.)
On pourrait croire certains passages traduits d’une langue qui n’existe plus : « Celui qui commença n’avait pas de nom, car ce n’était pas la coutume encore de donner un nom aux hommes dans leur particularité, ni à aucune autre famille d’animaux, ni aux lignées des plantes, ni à rien de ce qui grouillait sur le ventre de la terre aux mille sexes. […] C’est pourquoi ils le nommèrent Inilo, ce qui, selon certains, signifie le lointain, et selon d’autres, le parent, et, selon d’autres encore, le proche » (p. 92). Il y a d’autres passages cosmogoniques de ce genre ailleurs dans « Les Enfants d’Inilo ».
Les amateurs de catalogage préciseront que les Carnets de l’explorateur perdu, tels que les éditions Le Tripode les ont réédités en 2020, reprennent le contenu du volume de 1993, à quoi s’ajoutent quelques textes publiés depuis. On y trouve donc « Les Cavalières », « Louvanne », « L’Arbre du guerrier », « Contacts de civilisation entre les Steppes et les Jardins statuaires », « Les Enfants d’Inilo » (qui incluent « L’Écriture du désert »), « La Grande Danse de la Réconciliation », la « Lettre de Terrèbre » et des « Précisions ». Ce n’est pas le plus important.
Les amateurs de tri et d’étiquetages noteront qu’une partie de ces textes ont déjà paru dans des volumes à part. Ils établiront des liens avec les autres membres de ce Cycle des Contrées désormais clos (2) mais finalement très mouvant, s’appuyant par exemple sur les derniers mots de « La Chasse perdue » : « cette terre mystérieuse où veillent des statues que nul n’honore plus » (p. 62). Ils pourront se demander qui sont les « derniers venus » dans « Contacts de civilisation entre la Steppe et les Jardins statuaires » (c’est-à-dire aussi entre d’autres livres du cycle) : j’y vois une métaphore des lecteurs, libre à d’autres d’y lire autre chose. (Étayer cette interprétation risquant d’enfler démesurément le volume de cette critique, je ne m’y aventurerais pas. D’autant qu’elle ferait peut-être bien rire l’auteur !)
Les amateurs d’histoire littéraire et autres sourciers tisseront comme pour tous les récits de Jacques Abeille des liens avec Nerval, avec Gracq, avec tout un surréalisme tardif.
Les lecteurs gloutons de fantasy les plus attentifs relèveront qu’il y a tout un jeu de narration dans ces Carnets : des témoignages recueillis par un narrateur, qui les envoie lui-même à un autre narrateur dont on ignore le nom… Mais c’est l’ombre de l’auteur et de son monde qui plane sur le tout.
(1) Il me semble aussi qu’Abeille et Borges partagent, outre certaines tournures stylistiques dans les traductions du second, l’idée d’un héroïsme désabusé, du moins qui pose problème. – On trouve encore l’idée que « la personne des auteurs se dérobe et se dissout pour ne plus laisser place qu’à une voix anonyme dont l’autorité, celle du livre même, excède les bornes de la condition de chacun pour laisser celle-ci inachevée » (p. 144). J’ignore dans quelle mesure Abeille a lu Borges.
(2) Lire à ce sujet le très triste entretien donné par Jacques Abeille à l’occasion de la publication de la Vie de l’explorateur perdu (« Je suis en train de mourir, je n’en ferai pas d’autre »).