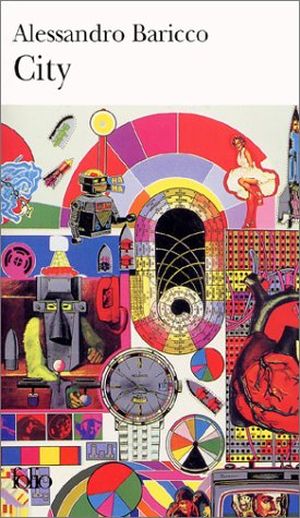Le quatrième de couverture allumé m’a incité à la lecture de City. Et puis, au fil des pages, la narration azimutée d’Alessandro Barrico m’a fait comprendre que j’allais emprunter un grand huit narratif où les actions comme les personnages dépeints allaient s’entremêler pour en retirer du sens, des sensations et des essences. City peut rappeler Queneau et son Zazie dans le métro où l’écriture automatique dicte le tempo. Cependant, le pseudo baroque de Barrico a l’ambition plus ou moins heureuse de livrer un semblant d’architecture pour faire comprendre la solitude commune des protagonistes principaux ( qu’il s’agisse de Gould, ado surdoué s’inventant des compères imaginaires ou cherchant du sens dans des compagnies bien réelles;de Shatzy Shell enchaînant les petits boulots aliénants et des ébats sans lendemain et dont le seul sens à la vie est la mise en place d’un western; ou du père de Gould l’ayant séparé de sa mère au nom d’une Raison bien accommodante) à la marge comme d’autres personnages fictifs plus secondaires ( les Frères et sœurs Dolphin du western où les boxeurs de Mondini).Vous ne pouvez pas dire que le livre est inadéquat mais le fait que l’action des uns ou des autres supplante l’ancrage dans le Temps a ses limites. J’ai aussi abordé la lecture de City par tranches de trente ou quarante pages pour ne pas perdre le fil, me faire submerger par la narration et je garde quand même la désagréable sensation d’avoir été ballotté sur toute la longueur pour ne pas vraiment me sentir concerné par ces récits emmêlés, souvent dissonants, jamais vraiment émotionnels. C’est comme si l’élan narratif se noyait dans la technicité d’ensemble de l’écriture.Je suis content d’avoir refermé City pour réaliser que ce n’était pas ma tasse de thé car lire n’est pas subir mais bel et bien profiter d’une expérience sensible qui touche et fait vibrer.