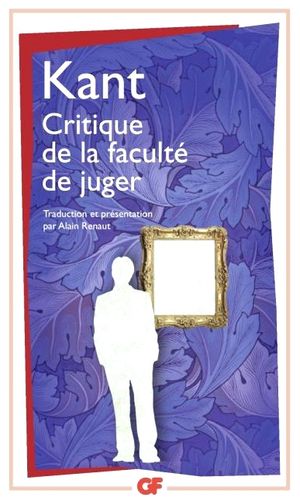Pour résumer brièvement la partie sur l'esthétique, Kant décrit le jugement de goût sur la beauté, lorsqu'il est libre et désintéressé, comme une intuition faisant appel à l'imagination et à l'entendement, mais non à la raison (car elle fait usage de concept), et portant à la contemplation.
Ce jugement de goût, pour être pur, ne doit tenir aucun compte de l'émotion, du plaisir lié aux perceptions des sens, et de d'adhésion à des concepts préétablis (des concepts peuvent être déduits de l'objet jugé lorsqu'on en fait l'expérience, mais aucun ne doit être déjà présent à l'esprit pour mesurer la beauté de l'objet selon une idée préétablie), qu'ils soient d'ordre moral (le bien) ou intellectuel (le bon et l'utile), car il s'agit de formes d'intéressement dans l'objet que l'on juge et qui lui attribuent une fin. Or la beauté libre doit plaire pour elle-même et non en rapport avec une fin objective ou subjective. Cette définition lui permet de distinguer les arts d'agrément (divertissements) des beaux-arts (arts du génie). Dans ces derniers, il ne manque pas de rappeler la nécessité des règles et des conventions pour canaliser l'imagination de l'artiste et aboutir à un objet porteur de sens. Il est donc à l'opposé des conceptions de ce qu'on nomme "art contemporain", ce qui est déjà une bonne raison de le lire !
Une spécificité de Kant tient aussi en l'universalité du jugement sur la beauté. Chacun lorsqu'il trouve un objet beau s'attend à ce qu'un autre porte le même jugement que lui, contrairement au goût des aliments (un plaisir des sens) dont on convient aisément qu'il ne soit pas partagé. Du fait que l'appréciation de la beauté fait appel à l'entendement, supposément partagé entre tous les hommes, ce jugement, bien que subjectif, devrait pouvoir concorder en chacun. Des hommes ayant atteint un degré de sensibilité similaire à force d'expériences esthétiques devraient aboutir aux même jugements, cette subjectivité étant la même pour tous.
Notons que Kant distingue la beauté naturelle de celle d'une œuvre d'art (il hiérarchise la première au-dessus de la seconde). Dans l'art, le jugement est fondamentalement téléologique ; il tient compte de ce que l’œuvre cherche à être d'après sa causalité interne, sa finalité subjective. Cette idée de finalité subjective est aussi présente dans la beauté naturelle, mais elle renvoie à la perception du supra-sensible (et en bout de course Dieu), en conséquence de quoi la sensibilité à la beauté naturelle prédisposerait à la moralité (je résume grossièrement car j'ai survolé ce passage).