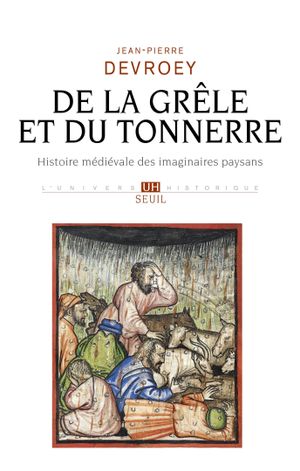Dans les mémoires paysannes qu'il marque au fer rouge, l'orage gronde, frappe, obstrue les cieux limpides, taille dans les champs des plaies béantes, puis il laisse, impassible, les éplorés maudire son outrage éternellement recommencé. Dans les archives qui portent sa trace séculaire, il parle désormais sereinement à l'historien qui sait s'adresser à lui. Il parle et dit beaucoup de choses. Il est un catalyseur, une fenêtre ouverte sur des pans mêlés d'histoire rurale, sociale, culturelle et religieuse, d'aucuns diraient dans un registre un peu désuet, et peut-être excessif, un fait d'histoire totale. Pensée magique, angoisses paysannes, christianisation des campagnes, châtiment des sorciers, rites d'expiation sont autant de catégories que La Grêle et le Tonnerre permet d'aborder sous un angle tout à fait original. Jean-Pierre Devroey en assure l'office avec cette tranquillité d'historien accompli qui, fort de sa longue et pérenne carrière, sait marier l'audace intellectuelle à une méthode éprouvée.
Son point de départ porte un nom et une fonction, Agobard, archevêque de Lyon (816-840), qui sût joindre à la crosse et à la mitre une plume assoiffée des missions pastorales du haut clergé. Son opuscule De grandine et tonitruis relate, pour les battre en brèche, de curieuses rumeurs courant jadis les campagnes du Forez, selon lesquelles sévissaient par les chemins des tempestaires « capables d'exciter la grêle toutes les fois qu'ils trouvaient bon de ruiner les biens de la terre, et qui faisaient trafic de cet art avec les habitants d'un certain pays de Magonia ». Chargés des grains gâtés par la tempête, ils s'en retournaient harnachant les nues, jouir des fruits durement gagnés par les serfs à leur marâtre nourricière. C'eût été fable pittoresque si la chose n'avait poussé les villages alentours à salarier larrons et charlatans pour défendre les cultures contre ces maléfices, et ce faisant, verser dans la poche des coquins l'argent qui, de charité consenti, coulait normalement dans l'escarcelle du prêtre pour le bien de ses dîmes. Un manque à gagner que ne devait pas négliger ce clergé du IXe siècle carolingien, si mal arrimé encore dans les vastes diocèses de Francia. Mais il n'est pas tant question ici des mages obscurs du lyonnais que de cette société qui les a vus naître et perpétués dans les vertes croyances des campagnes serviles. C'est là tout l'intérêt de cette belle étude.
Jean-Pierre Devroey s'en empare parce qu'il voit dans ces manieurs de grêle un motif récurrent des imaginaires paysans, si prompts d'ordinaire à se dérober comme l'eau entre les doigts. Bons marcheurs frioulans du XVIe siècle, sorciers du bocage normand, nubeiros d'Asturies et de Galice, prêtres conjurateurs de Provence et des Cévennes, en sont autant d'illustrations significatives. Perce à travers elles tout un ensemble de peurs et d'espérances liées toujours à la terre ingrate d'où s'arrachent à grand peine les précieuses moissons, et qu'un orage pouvait anéantir en un battement de cil, charriant avec lui des trains de calamités que les communautés ne connaissaient que trop bien. « Immergés dans l'environnement, les habitants de l'Arrière-pays avaient un perception sensible des intempéries, qui se traduisaient sur les plans matériels et idéels (…). Élaborer des fables qui donnent corps aux peurs météorologiques permettaient de les maîtriser ou de les amoindrir psychologiquement ». Le paysan chrétien du IXe siècle se racontait ces histoires non par défiance vis-à-vis de l'autorité cléricale, non pour contester l'hégémonie culturelle de l’Église, mais par nécessité matérielle. Le caractère imprévisible des orages le forçait à puiser partout où il le pouvait les instruments de sa protection, de sa sérénité d'âme, y compris dans ce fonds de culture « non-chrétienne » que d'autres se sont plu à dire païenne, celtique, gauloise, que sais-je encore.
Au siècle suivant, Réginon de Prüm et Burchard de Worms dresseront un inventaire des mauvaises croyances pour aider les prêtres à purger du commun ces chimères insolentes, mais ces listes trop sagement consignées dans les manuels de confesseur ont induit plus tard l'idée que ces folklores agraires existaient concurremment à la vérité de la foi catholique. Or ces deux systèmes coexistaient plus qu'ils ne se faisaient face, mêlés l'un à l'autre, « le chrétien et le non-chrétien », sans souci des contradictions que cette coexistence faisait naître au plan de la foi, car répétons-le, il ne s'agissait pas tant de savoir si Dieu était ou non le seul principe opérant des manifestations naturelles, orages, pluies, séismes et tempêtes, comme se plaisaient à l'écrire les théologiens du temps, mais bien, pour le paysan, de se garder le plus efficacement possible de ces déchaînements. Lorsqu'il ne trouvait pas dans les processions villageoises, le concert des cloches, les croix champêtres, la garantie suffisante de sa sauvegarde, alors naissaient au détours des collines et des halliers le chasseur de tempestaires. Il n'était point aidé en cela par le clergé sous-éduqué des paroisses rurales, qui se faisait parfois le relais de ce fond de croyances anciennes, comme le remarquait déjà Jean Delumeau. Point d'opposition frontale donc entre folklore et christianisme – il est de toute façon impossible d'en faire la balance réelle – mais « un syncrétisme par l'intermédiaire duquel les paysans et les paysannes ont cherché à perpétuer leurs manières d'habiter le monde, en investissant ou en travestissant les rites et les pratiques chrétiennes qui répondaient à leur besoin de sécurité et faisaient sens à leurs yeux ».
En faisant peser plus lourdement le poids de ses structures sur le territoire des diocèses, l’Église a de plus en plus christianisé ces rites et croyances agraires, mais le regard qu'elle portait sur la magie a profondément évolué par la suite. Au temps d'Agobard de Lyon, elle frappait de pénitence les crédules qui donnaient foi aux histoires de tempêtes invoquées, car le monisme qui était au fondement de sa doctrine empêchait d'attribuer à tout autre que Dieu le pouvoir de faire la pluie et le beau temps. Ce n'était donc pas la magie en soi qui était répréhensible aux yeux de l’Église, mais le fait d'y accorder quelque crédit que ce soit. Le développement au XIVe siècle de la démonologie renverse totalement cette perspective, puisque l'institution reconnaît désormais pleinement la réalité de la puissance démoniaque et châtie durement sa médiation ici-bas, le « pacte diabolique » qui assure dans le monde sensible ses manifestations. Aidé par quelques stéréotypes misogynes bien ancrés dans les mentalités cléricales, la figure du tempestaire carolingien cède à celle de la sorcière suppôt du diable, dont la chasse donnée jusqu'en 1682 remplira les pages les moins glorieuses de l'histoire humaine.