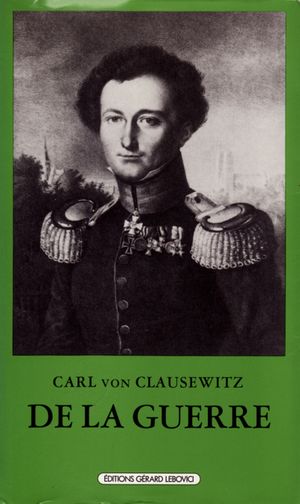Le traité, rédigé par Clausewitz après les guerres napoléoniennes, représente une référence dans la matière de la guerre, de la stratégie et la théorie de l'art militaire. Publié après sa mort en 1831, il comprend 8 parties, 8 livres allant de la nature de la guerre au plan de la guerre, en passant par une étude des forces défensives ― négatives en citant l'auteur ― et, de façon opposée, des forces attaquantes (positives donc).
La théorie doit éclairer avec une vive lumière la masse des objets, afin que l'entendement s'y retrouve plus facilement [...]. Si les idées se réunissent d'elles-mêmes en un noyau de vérité que nous appelons principe, si elles s'alignent spontanément dans un enchaînement qui forme une règle, la théorie doit l'indiquer.
La guerre est une tension constante entre deux forces, une friction, un duel, leitmotiv de l'ouvrage. La guerre est composée de violence, de hasard, tandis qu'elle est instrument politique.
L'incertitude de la belligérance, de l'attaque ― l'épée fulgurante de la vengeance selon Clausewitz ―, est approfondie par l'auteur, notant un caractère psychologique à la guerre. Ce terme tend à rendre humain un acte barbare, pourtant décrit par « la guerre totale ». En effet la psychologie de la guerre est un point central du livre, un concept original et révolutionnaire à l'époque.
La seule chose qu'on reprochera à ce traité sur l'art de la guerre sera son caractère inachevé.