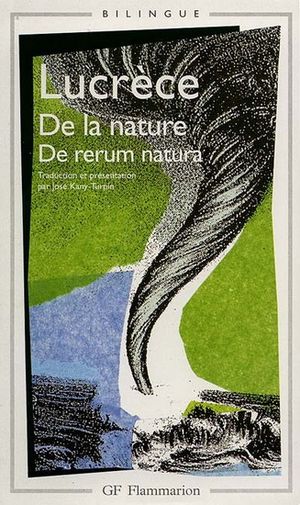J’étais sûr, d’avance, d’aimer De rerum natura (que j’ai lu en français, goûtant le latin de temps à autres, puisque cette version est bilingue). L’idée d’un poème basé sur l’observation du monde ― et par-delà les limites que les connaissance de l’époque impliquent ― me séduisait énormément. Le poème de Lucrèce est-il comparable aux chants homériques ou aux œuvres du cher Ovide ? Non, hélas ou heureusement… S’il fallait absolument trouver une expérience comparable dans des lectures précédentes, je parlerai plutôt de Dante et sa Divine Comédie. Virgile guidait Dante dans les monde au-delà de la mort ; à Memmius, Lucrèce enseigne de quoi le monde sensible est fait, au-delà de ce qu’il pouvait percevoir, avec, pour seul appui, les théories d’Épicure ou celles de Démocrite. Comme ceux de Dante, les vers de Lucrèce décrivent, raisonnent. D’autre part, De rerum natura est un poème extrêmement peu narratif, pas de personnage (pas de nom en tout cas, seulement des figurants) presque pas de mythologie. C’est du moins la première fois que je lis une œuvre antique où celle-ci joue un rôle aussi secondaire, tout au plus celui de métaphore ou pour désigner les chimères de la superstition.
Lucrèce fait gorge chaude de ces dernières, accumulant les hypothèses sensées ou absurdes, pourvu qu’elles nourrissent son imagination comme une corne d’abondance. En l’absence d’épistémologie rigoureuse ou de moyens de vérifier si ce qu’il dit est vrai ou pas, on serait tenté de dire que les idées ont autant d’intérêt les unes que les autres, si le propos global n’était pas d’une pertinence exceptionnelle. Même si tout n’est que pure spéculation, l’intention est bien de comprendre, non de grossir la terreur que les choses de la vie nous inspire. Fi, donc, des dieux tyranniques, les monstres extraordinaire et même les héros. Le réel, dans ses aspects les concrets, comme les plus factuels, est le sujet de Lucrèce aussi bien que son substrat d’images, suggérant un monde de sensations, de mouvements, de vide ou d’anéantissement. C’est comme si Lucrèce pétrissait le monde comme une matière malléable, afin de trouver sa forme vraie. Les atomes s’unissent et se désunissent, selon leurs formes, consistances, couleurs ; tout se recréé jusqu’à l’épuisement final, la fin de tout. Il en ressort à cette image, et comme juxtaposés à la Nature des choses, des tableaux de plus en plus « réaliste » de la vie humaine, ses jouissances, ses malheurs, les guerres, la maladie, mais aussi subrepticement l’empire ; ses diversions, soit pour refuser de regarder sa finitude en face, soit pour accepter ce « monde » modelé et organisé par des hommes.
Lu du 25 décembre 2022 au 17 janvier 2023.Traduit du latin par José Kany-Turpin. 467 pages - G.F. Flammarion