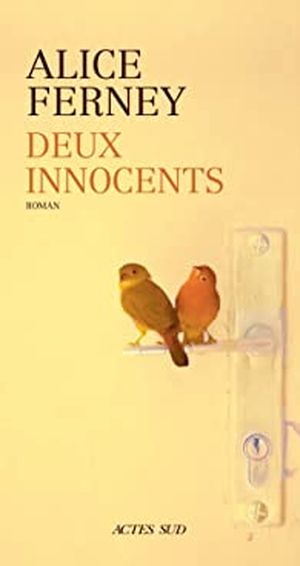Le dernier roman d’Alice Ferney est une petite merveille.
En racontant l’histoire d’une enseignante investie accusée injustement d’avoir causé le suicide d’un de ses élèves handicapé, l’auteur concentre sans provocation ni exagération les pires dérives de notre époque : la gentillesse et l’empathie soupçonnées des pires vices par ceux qui ne peuvent les comprendre ni les ressentir, enfermés qu’ils sont dans une idée de leur efficacité imposée par une société techniciste, les dérives des rapports hiérarchiques quand les supérieurs sous-estiment l’humain, les défaillances d’une justice qui crée des coupables pour satisfaire de supposées victimes parfois très coupables et enfin le décalage toujours plus grand entre ceux qui vivent encore dans une perspective chrétienne et un monde qui n’a plus rien de chrétien.
Décalage, tel est peut-être le mot important. Cette enseignante trop gentille acceptera toutes les humiliations imposées par des êtres malfaisants et participera ainsi sans le vouloir au mal, pour elle mais aussi pour son élève, et finalement, elle participera peut-être aussi au malheur d'un monde qui ne sait plus la signification de la bonté, du dévouement, de la sincérité. Car la naïveté est une faute impardonnable dans ce monde impitoyable : « L’inculpée a bien compris : qu’il ne lui prenne pas fantaisie de parler à tort et à travers de bonté, d’affection, de bras ouverts, etc. Et tant pis pour les trois noms de l’amour ! Et surtout pas de couplet chrétien. Impossible donc d’être naturelle. Mais alors ? Qui faut-il être ? Que faut-il dire ? Claire se sent dans une impasse : elle n’est personne hormis elle-même, définie justement par son naturel et son expansivité. Elle voulait s’expliquer, faire deviner ainsi la source du malentendu, restaurer la signification des gestes. Elle n’essaie pas, espérant que peut-être, mais non, l’occasion ne s’en présente pas. D’ailleurs, elle n’a plus de mots. Elle n’a plus de mots devant ceux qu’on lui sert une deuxième fois, les siens, ceux qu’elle a dits de tout son cœur. Apparemment, le cœur est un coupable. » ( Actes Sud, p. 267)
Mieux que Roth dans La tâche, je trouve, Alice Ferney arrive, au gré d’un style indirect libre très ( trop ?) présent, à nous poser les nouvelles modalités du rapport de l’individu à une société qui cache sa monstruosité derrière son efficacité, l’effondrement de ses valeurs qu’elle a sacrifiées à une certaine idée de la cohésion sociale multipliant des victimes innocentes qui ne se considèrent même pas comme des victimes alors qu’il suffit de plus en plus souvent de crier haut et fort qu’on l’est pour que tout le monde le croie.