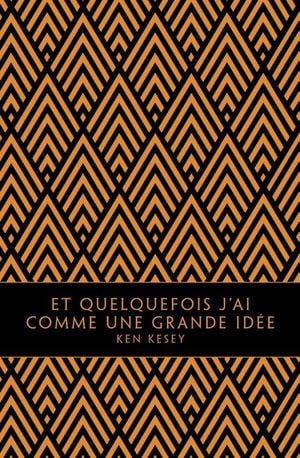Il était une fois dans le Nord-Ouest
Ce roman, c'est un peu Sergio Leone, Philip K. Dick et William Faulkner chez les bucherons. Une sorte de western moderne, au scénario jubilatoire, écrit sous trip et avec des narrateurs multiples, un kaléidoscope de personnages hauts en couleur et au caractère bien trempé, arpentant les pentes des collines de l'Oregon - ou les bars dans la vallée, c'est selon la météo ou l'humeur du moment. Le résultat est décoiffant !
Nous sommes en 1964. Ken Kesey connait déjà le succès avec son premier roman "vol au-dessus d'un nid de coucou", lorsque parait "et quelquefois j'ai comme une grande idée". Roman plus expérimental, moins traduit, et donc moins connu que son ainé, il est néanmoins considéré par certains comme l'œuvre phare du romancier, à commencer par Kesey lui-même. Il aura également la primauté de l'adaptation cinématographique, "le clan des irréductibles", porté par les charismatiques Henry Fonda et Paul Newman sortant sur les écrans quatre ans avant le film qui donnera son premier oscar à Jack Nicholson.
S'il est vrai qu'ils se consacrèrent à des genres bien différents, les "expériences" vécues par Dick et Kesey présentent d'incontestables similitudes, même si le premier les subira bien plus que le second. En 1959, Kesey, encore étudiant, se porte volontaire pour tester de nouvelles drogues. Sa découverte du LSD, encore autorisée et connue seulement de certains milieux scientifiques, est un véritable choc, lui ouvrant les yeux sur une "nouvelle vision du monde". C'est durant cette aventure psychédélique, marquée jusqu'en 1966 par des road trips dans des bus multicolores, des expérimentations sonores aussi innovantes que farfelues, et des démêlées avec la police et le FBI, qu'il écrit ses deux principaux romans ; et force est de constater qu'on y retrouve la fulgurance, le bouillonnement, que seul un agité du bocal sous acide semble capable de produire, Dick en étant sous doute la quintessence. Aujourd'hui, le génie de Kesey est largement reconnu et salué par une statue à Eugène, dans l'Oregon.
Roman plus expérimental, également, disions-nous. Kesey s'essaie en effet à l'écriture polyphonique dans son second roman, alternant les première et troisième personnes, jonglant entre les personnages sans préambule, s'inscrivant ainsi comme l'un des héritiers de la prose chère à Faulkner. Je ne saurais mieux vanter qu'Alain Damasio les vertus d'une telle forme d'écriture : "la réalité ne peut à mes yeux être dite d’un seul esprit, d’un seul axe de caméra, elle est nécessairement multiple, éclatée, proliférante. C’est le tissage des perceptions qui recompose le réel, lui restitue sa richesse." Cette mosaïque de la vision est l'une des grandes forces du roman de Kesey, un sommet du genre.
Enfin, l'histoire. Une grève qui s'enlise et pourrit peu à peu les relations entre ces bucherons bougons mais finalement bien attachants, pour faire simple. L'incursion de Kesey dans leurs pensées lui permet de les faire se regarder en chiens de faïence, de marquer régulièrement cette sorte de pause dramatique chère à Leone dans leurs affrontements. Il ne manque que la musique de Morricone pour que le tableau soit complet, et le final, de son côté, sera aussi épique et fantasque que celui de "le bon, la brute et le truand."
Monument de la Littérature du Northwest, ayant nécessité le travail de 20 personnes pendant 8 ans pour sa traduction, "et quelquefois j'ai comme une grande idée" vient enfin de paraitre en français. Il était temps, à l'approche du cinquantenaire de sa parution.