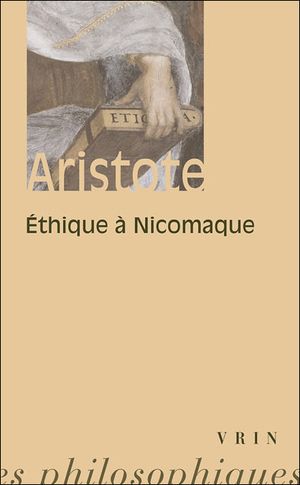Au gré de considérations théologiques, il est impossible de percevoir la signification immanente de l'éthique. Cette dégradation de la raison conduit forcément à la recherche de chimères : le bien, le bonheur. Pourtant, tel que l'aveugle touchant un objet pour en concevoir l'idée, Aristote parvient à dégager à travers la fausseté de son socle de certitudes le véritable office de l'homme : le perfectionnement. C'est notamment dans le livre X, où il compare le bonheur divin d'avec le bonheur humain, que nous entendons cette nécessité de transcendance chez l'auteur.
La clarté de l'écrit ne compense pas le vide de son propos. Il est à se questionner sur les capacités intellectuelles de celui qui estimerait compliquée la lecture d'Aristote. C'est précisément l'intelligibilité du texte qui le rend aussi lourd. Il n'y a aucune progression dans le contenu, tout y est linéaire, comment ne pas voir dans l'ouvrage le fruit d'une vulgaire compilation tant l'ensemble est dépourvu de cohérence. Lorsqu'on arrive à la fin de l'œuvre, on en vient à se demander ce qu'on a lu.
Ce qu'on retient essentiellement du livre, c'est cette entreprise de classification des vertus et des vices. Mais fondamentalement, quel est l'objectif poursuivi derrière cette ennuyeuse autant que fastidieuse besogne ? Concrètement, si une personne a besoin d'Aristote pour déterminer que la générosité est préférable à la prodigalité, elle-même préférable à l'avarice, ne faudrait-il pas interroger son état mental avant de louer le philosophe ? On comprend que son texte théorique portant sur le Bien tente maladroitement de pallier le défaut d'étude pratique sur l'atteinte de ce Bien.