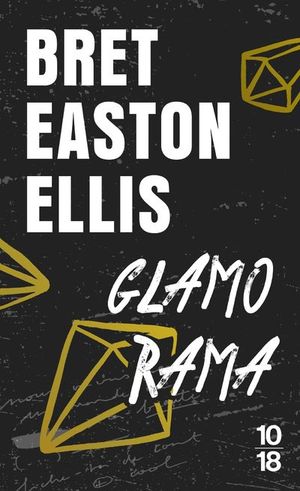L'immense voyage sur la surface des choses.
J'ai été tout de suite intrigué par la nouvelle maturité stylistique et la facilité avec laquelle Ellis adapte son langage et ses expressions au monde crépusculaire du XXème siècle. Glamorama est un monstre qui happe mais sans crocs ni venin le reste de son œuvre. J'ai très vite eu envie d'engloutir cet immense python.
Dans les fameuses cent premières pages, Easton Ellis nous trouble ainsi que son narrateur en instaurant plusieurs petites trames sans réelles gravité mais qui –on connait bien l'esprit de l'auteur- sont le motif de cette introduction... L'ouverture de la boîte de nuit avec cette faramineuse liste d'invités, un certain Baxter Priestly, une photo compromettante ou la disparition du DJ, qui reste plus ou moins dans l'ombre. Pendant ce temps, Victor se balade avec sa vespa et nous inculque de son leitmotiv qui résume ce départ ingénieux : « Plus tu es splendide, plus tu es lucide. » A part la qualité nouvelle de la forme et la minutie époustouflante des dialogues, impossible de ne pas reconnaître qu'on est dans du Ellis. On retrouve ces personnages qui barbotent lamentablement dans leur colossal « monde minuscule ».
Dans cette partie, on trouve des passages excellents, comme le dîner avec le père, qui se démarque de la constante du passage obligatoire des enfants chez leurs parents, aussi irresponsables les uns que les autres, moment lassant et inutile pour les protagonistes principaux, des œuvres de Bret, en ce sens que cette fois le père s'inquiète sur la tournure de la réussite de son fils, au lieu de se foutre d'un l'échec éventuel et de lui donner de l'argent comme dans les romans précédents. On retrouve plusieurs passages comme ça, qui rompent en douceur avec le monde Ellisien, mais j'ai tout de suite senti celui-ci comme essentiel.
La première partie se fini avec précipitation, et Ellis va innover dans Glamorama en ce sens : on va avoir une histoire, une vraie intrigue, de véritables rebondissements, et non plus une stagnation aux multiples scènes redondantes etc. non, place au grand au dingue, à l'irréalisable scénario de Glamorama.
Depuis le moment où Palakon impose le bateau pour le transport plutôt qu'un avion, il est évident que nous avons à faire à un roman lent, un roman qui progresse au rythme d'un scénario qui semble s'élaborer au fur et à mesure tout en restant d'une logique et d'une application implacable, une lenteur qui accompagne l'engourdissement et la congélation graduelle de Victor Ward en Europe.
Victor subit l'entrave de trois éléments à caractère proleptique : les confettis, les mouches, le froid. Triade très symbolique avec laquelle nous allons cohabiter pendant tout le thriller.
Pendant que Victor et le lecteur essayent de reconstruire un puzzle ultra-complexe, Ellis en rajoute en détournant constamment l'attention avec un procédé ingénieux : les équipes de tournage qui gravitent autour des protagonistes. Difficile de faire la part des choses ou de tout connecter au fur et à mesure dès lors. Ellis intègre la vie à un immense décor de cinéma et non l'inverse, et le titre de Glamorama prend son sens, la superficialité n'en est que parfaitement mise en scène.
Bon pas de spoil... Pages 478 à 481.
Après la quatrième partie, après avoir broyé son lecteur dans une tempête sanglante et flamboyante et violente et névrosante, Bret Easton Ellis nous fait souffler avec une avant-dernière partie qui démarre sereinement, dans le décor sain de la rédemption. Mais quelle rédemption ? Le malaise revient tranquillement à la charge, et la dernière partie contient les paragraphes fondamentaux du roman : le 0 et les deux derniers, qui expliquent toute la genèse de l'histoire, toute son ambigüité, son sublime paradoxe. Deux phrases s'opposent, deux mondes, deux périodes de la vie :
-« The Last Day Of Our Acquaintance. »
-Plus tu es sublime, plus tu es lucide.
Et pour accepter, expliquer cette transition du véritable au superflu : « We'll slide down the surface of things. »
Victor Johnson n'est plus rien à la fin du roman, l'énumération des chapitres redevient croissante ; Victor Ward est tout à la fermeture du feuilleton, l'homme qui connaît de nouveau, et qui s'exile dans une vision mystique du future. Mais qu'aura-t-il tiré de cette simple « instruction » ?
Bret Easton Ellis est de ces écrivains qui réécrivent à peu près toujours la même œuvre, en essayant de la perfectionner, la nuancer, la complexifier. En parfait Balzac du XXe, il impose son univers et avec Glamorama, l'élargit, le décortique, le rend incontournable. Il signe, sans hésitation, son plus grand ouvrage, le plus maîtrisé, le plus sinistrement beau.