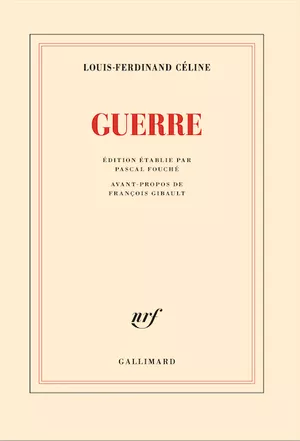On attrape la guerre comme on attrape la grippe, la gastrite, la gale, la goutte ou la gonorrhée. C’est le docteur Destouches qui parle. La guerre, c’est comme une maladie.
Comme la mienne, de tête, est perdue dans le cinéma en ce moment je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Johnny Got his gun de Dalton Trumbo. Pour moi *Guerre *c’est un peu Ferdinand got his gun. On y retrouve la même noirceur. Ça se passe aussi pendant la guerre de 14, la préférée du père Brassens. C’est l’histoire d’un soldat qui est blessé pendant cette boucherie abominable et qui se réveille dans un hôpital. Alors c’est vrai que Ferdinand est moins esquinté que le pauvre petit Jeannot américain. Il a encore ses deux bras et ses deux jambes lui. Il peut voir et parler. Entendre c’est compliqué, il y a ce vacarme incessant de la guerre qui est enfermé dans sa tête et sur lequel je reviendrai. Il y a aussi une infirmière qui joue un rôle important, mais celle de Céline, la fameuse L’Espinasse, ne fait pas vraiment dans la romance. Elle ne dessine pas des lettres sur la peau du pauvre soldat avec qui elle veut communiquer, elle s’occupe de lui et de son « roméo » de façon plus directe et bien scabreuse.
Il y a aussi des scènes qui, par leur caractère émouvant, m’ont semblé apparentées. Dans Johnny got his gun, on voit le groupe de jeunes soldats qui s’apprêtent à prendre le train avant de partir à la guerre. Ça se passe dans l’imagination de Johnny. Il y a le Christ, joué par Donald Sutherland, qui est au milieu d’eux et qui leur donne des paroles de réconfort tandis qu’il leur annonce comment ils vont mourir. Je cite de mémoire, ça doit être quelque chose comme « toi, tu vas mourir d’une balle dans la tête », « toi tu vas être écrasé sous un obus ». Et alors les soldats se désolent : « non alors, mais qu’est-ce que vont devenir ma femme et mon fils ? » C’est un moment très touchant, que j'appellerais le conciliabule des soldats. Il y a un conciliabule des soldats aussi dans *Guerre. *Cette scène où Ferdinand arrive à sauter du train et se met à errer nuitamment dans la plaine belge, éclairée par la lune. Il finit par tomber sur ses anciens compagnons de régiment. C’est une hallucination. Eux aussi sont morts. Kersuzon, Keramplech, Gargader. Il y en a un qui a les bras arrachés, un autre qui a des trous dans la tête, et ils se tiennent tous silencieux autour de Ferdinand, comme des spectres. Un vrai film d’horreur. Alors pour les réconforter Ferdinand leur raconte une histoire de meurtre sordide dans une ambiance médiévale, un peu à la Villon. À la fin, tout content de lui, il leur dit « alors, elle est pas belle mon histoire ? » et il y en a un qui s’approche de lui et qui lui dit (détail macabre et excellent) en faisant bouger sa mâchoire cassée avec ses mains : « Brigadier, on n’est pas content nous autres. C’est pas d’une histoire comme ça que nous autres on a besoin ». J’ai eu l’impression que ce passage disait quelque chose de profond à propos de l’écriture de Céline. Céline, c’est un conteur. Son métier c’est de raconter des histoires. Mais le problème est de savoir quelle est l’histoire qui convient à des morts ? De quelle histoire est-ce que des morts ont besoin ? Et des vivants ? C’est toujours comme ça. Je n’ai pas lu Mort à crédit mais j’ai entendu un entretien où Céline expliquait que si l'on voulait comprendre Mort à crédit de façon symbolique, il faudrait le voir comme des histoires qu’on raconte pour avoir le droit de mourir. C’est une sorte de mode de paiement. « Si vous racontez une bonne histoire vous avez le droit de passer… » Alors je pose la question : nous autres innocents perdus, malheureux, frileux, peureux de 2022, vivant à crédit, c’est quoi l’histoire dont on a besoin ? Une histoire pleine de bruit et de fureur ? Une histoire de guerre ?
Guerre est d’abord une histoire de bruit. Je reviens sur ce motif du bruit qui est présent tout au long du roman. La guerre est toujours présente sous la forme du bruit. Bruit extérieur, bruit intérieur. Bruit du canon qui revient sans cesse. J’ai aimé la finesse de cette notation qui ne peut venir que de quelqu’un qui a véritablement connu la guerre, quelqu’un qui est en mesure d’évoquer la guerre dans sa dimension d’expérience auditive : même sur son lit d’hôpital à Peurdu-sur-la-Lys, Ferdinand est capable de dire, jour après jour, si la ligne de front se rapproche ou s’éloigne en fonction de l’intensité des coups de canon qu’il entend au loin. Pour le bruit intérieur, pas besoin de développer, Ferdinand y revient sans cesse, tantôt c’est une tempête, tantôt un ouragan, tantôt un vrombissement, tantôt un bourdonnement. Et tant d’autres images encore. Il s’en excuse même à un moment donné, quand il dit qu’il ne peut plus trouver le sommeil :
Il fallait toujours faire l’énorme effort de ne pas céder à l’angoisse de ne plus pouvoir dormir, plus jamais à cause des bourdonnements qui eux ne finiront jamais, jamais qu’avec votre vie. Je m’excuse. J’insiste mais c’est l’air de la chanson.
Et le plus beau, c’est quand les deux sources de bruits, le bruit de l’intérieur et le bruit de l’extérieur, finissent par se rencontrer. Au bar de l’Hyperbole, il y a tout en même temps. Le piano mécanique qui tonitrue, le brouhaha des clients qui gueulent, les coups de canons qui éclatent et le tonnerre de Dieu des bourdonnements qui résonnent dans la tétère. « BRUIT CONTRE BRUIT. » La plus belle formule du roman en trois mots. C’est la guerre mondiale importée dans une boîte crânienne. Et que se passe-t-il quand les bruits se rencontrent ? Ils s’annulent. Et puis c'est le silence.
Guerre est aussi une histoire de fureur. Ce qui est remarquable dans la première partie, au réveil sur le champ de bataille, c’est la description des effets de la violence du conflit sur le corps et l’esprit de Ferdinand. C’est la description de l’état de confusion, de dislocation du personnage. Il ne sait pas où il est, où il va. Il ne sait si ce qu’il voit est vrai ou pas. Il hallucine tout le temps. Le moment où il regarde la campagne dévastée aux alentours et où il a l’impression que la terre bouge et se soulève comme si d’énormes rats avançaient en dessous, avec ses bruits qui augmentent et qui le forcent à hurler pour se faire entendre du soldat anglais qui essaie de l’aider, comme s’il était en pleine tempête, est stupéfiant. L’être humain est disloqué, démembré par la brutalité de la guerre. Il perd l’unité de son schéma corporel et spirituel et n'est plus qu’une juxtaposition de « parties » :
Je m’étais divisé en parties tout le corps. La partie mouillée, la partie qu’était saoule, la partie du bras qu’était atroce, la partie de l’oreille qu’était abominable, la partie de l’amitié pour l’Anglais qu’était bien consolante, la partie du genou qui s’en barrait comme au hasard, la partie du passé déjà qui cherchait, je m’en souviens bien, à s’accrocher au présent et qui pouvait plus – et puis alors l’avenir qui me faisait plus peur que tout le reste, enfin une drôle de partie qui voulait par-dessus les autres me raconter une histoire.
Même disloqué, on le voit, il y a toujours une partie qui reste avec la volonté de raconter une histoire. Ça peut même être une histoire drôle, car il n’y a pas que du bruit et de la fureur dans Guerre mais aussi une extraordinaire drôlerie. On ne peut pas s’empêcher de rire en lisant les passages où Ferdinand raconte sa rencontre avec le soldat anglais, son étonnement devant sa facilité à parler anglais alors qu’il a le bras presque arraché et qu’il baigne dans le sang. Et ces passages où, en pleine confusion, il mélange français et anglais dans une protestation énergique : « I AM NOT GOING, I AM GOING TO THE GUERRE DE MOUVEMENT ! » ou encore lorsque l’officier l’interroge : « where do you come from ? » et qu’il se fait, anxieux, la réflexion : « ça j’y avais pas repensé d’où que je comais from, il m’a refait peur ce salaud là ». Louis de Funès n’a pas pu lire Guerre, mais comme il est célinien son célèbre « But alors you are french. » Et en parlant d’humour, je ne dirai rien de la soirée chez les Harnache qui est, elle aussi, un morceau de bravoure hilarant. Si ce n’est un tout petit détail, vers la fin de la scène, que je n’ai remarqué qu’à la deuxième lecture, alors qu’Angèle a vidé son sac et révélé l’automutilation de Cascade, Gontran Cascade, alias Bébert, alias Julien Boisson et qu’elle l’a, de fait, condamné à mort. Madame Harnache se tourne vers lui, n’ayant manifestement rien compris à la gravité de la situation et lui propose de chanter : « je vous accompagne au piano M. *Carcasse *? » Il me semble qu’il y a quelque chose de très fin, de très célinien dans cette confusion du nom propre, comme quand Céline renomme Sartre, dans le texte intitulé « À l’agité du bocal », « Jean-Baptiste » Sartre. Signature de l’humour célinien. Tout en légèreté, presque imperceptible pour le lecteur trop pressé, teinté d'un souverain mépris et, peut-être, d’une dimension tragique. En le rebaptisant involontairement « Carcasse », Mme Harnache n’enregistre-t-elle pas le fait que Cascade est déjà un homme mort ?
On n’en finirait pas d’évoquer les passages profonds, drôles ou émouvants de Guerre. Je conclurai en disant simplement que Guerre est le texte parfait pour entrer dans l’œuvre de Céline. La meilleure introduction par sa concision, sa rapidité, par la puissance de son style. Je me souviens à l’époque, je n’avais pas pu terminer le Voyage au bout de la nuit, je m’étais arrêté au bout de deux cents pages. Béotien sanglant, je disais : « c'est bien mais alors qu'est-ce que c’est long ! Bardamu à la guerre. Bardamu en Afrique. Bardamu aux États-Unis. Bardamu médecin à Clichy. Bardamu à la plage. Bardamu à la montagne. C’est bon, on a compris ! Qu’est-ce que c’est long ! » Mais je n’avais rien compris. Je n’avais pas saisi le génie du style aérien de Céline. Tout en finesse, tout en légèreté, tout en dentelle. Par exemple quand il fait dire à Cascade, à la page 86, des paroles aussi gracieuses que : « dis encore un mot saloperie que je te carabosse ta putain de gueule de carafe ! » Gémeaux ascendant Balance. Aérien je vous dis, est-ce qu’il faut vous faire un dessin ?
Alors c’est pas Céline qu’était trop long eh face de raie, c’est moi qu’étais trop court !