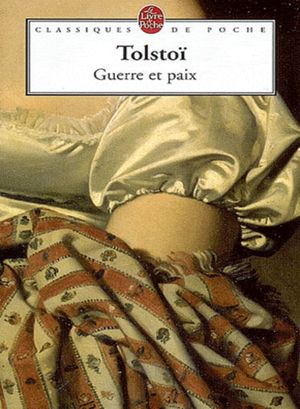Bien souvent, accepter une œuvre parmi les « classiques » revient à faire oublier comment cette œuvre, justement, n’était absolument pas classique, mais que bien au contraire elle ne correspondait à aucun des canons de son temps. Comme tant d’autres, Guerre et Paix rentre dans cette catégorie des romans qui fait fi des conventions littéraires pour devenir quelque chose d’unique, un peu comme Les Misérables de Hugo, sorti trois ans auparavant et avec lequel le roman de Tolstoï partage beaucoup de points communs.
En sortant de la lecture de ce qui reste un énorme pavé (même taille que Les Misérables, justement, dans les 1500 pages), on a l’impression d’avoir eu sous les yeux non pas un, mais plusieurs livres différents, comme si Guerre et Paix avait été conçu comme l’agrégat de divers projets. Et clairement, c’est de cela qu’il s’agit.
Guerre et Paix, c’est à la fois un roman historique, une description sociale, une œuvre philosophique et un roman partiellement autobiographique/généalogique. Il est d’ailleurs très intéressant de suivre l’évolution du projet dans l’esprit de Tolstoï, qui voulait d’abord se concentrer uniquement sur l’année 1812 (qui tient, à elle seule, la seconde moitié du roman tel qu’il existe actuellement) et qui a abordé l’écriture en faisant les portraits psychologiques de ses aïeuls ou contemporains qui serviront de modèles aux multiples protagonistes. Le but était de refaire un peu comme Les Récits de Sébastopol, texte dans lequel l’auteur, noble donc débiteur d’un temps de service à l’Etat, souvent dans le cadre de l’armée, racontait comment il avait vécu la Guerre de Crimée. On retrouve deux points communs majeurs entre les deux œuvres.
D’abord l’influence de Stendhal dans la description du personnage pris dans la tourmente de l’événement historique. Il ne s’agit pas de décrire l’événement, pourtant ultra-connu et déjà très documenté, d’un point de vue omniscient, par un narrateur en hauteur, mais de se plonger au cœur même d’un conflit qui est vu à travers la subjectivité d’un personnage. Un personnage qui, par conséquent, ne comprend rien à ce qui lui arrive, ne voit aucune stratégie d’ensemble, mais est pris dans un chaos furieux. Il ne sait pas comment agir et semble, même, ne pas contrôler ses gestes. Dans certains cas, ils deviennent même des héros malgré eux, puisqu’on leur attribue des actes qu’ils n’ont absolument pas prémédités et un héroïsme dont ils sont globalement dépourvus.
Cela ne se limite pas, bien entendu, à une simple référence à Fabrice del Dongo, mais intègre toute une réflexion sur l’histoire qui innerve l’ensemble des troisième et quatrième parties du roman (donc une bonne grosse moitié). Des pages parfois arides à lire, mais qui sont, on le ressent facilement, au cœur du projet tolstoïen. L’auteur interrompt ainsi régulièrement son récit de la guerre de 1812 (celle que les Russes nomment « la Guerre Patriotique ») pour nous faire part de ce qu’il pense au sujet des conflits et, en règle plus général, du cours de l’Histoire. Selon lui, ce ne sont pas les grands hommes qui font l’histoire, et Napoléon n’est pas plus responsable de ses actes historiques qu’Alexandre 1er (l’empereur qui régnait en Russie à l’époque). La tentative d’invasion de la Russie fait partie d’un mouvement décrété bien avant Bonaparte. Chaque événement historique apparaît, selon Tolstoï, comme la résultante non pas des décisions d’une personne influente mais comme les effets inéluctables de causes plus anciennes. Les dirigeants eux-mêmes, qui pensent avoir l’illusoire liberté de mener telle ou telle action, sont en réalité les marionnettes de mouvements de population bien plus forts qu’eux et qui les dépassent.
Au-delà de ces grands hommes qui peuplent le roman (puisque Napoléon, Alexandre, Murat, Koutouzov et quelques autres généraux et ministres sont des personnages à part entière de Guerre et Paix, ce qui ne choque pas les amateurs de roman historique), le véritable héros du livre, c’est le peuple. En cela, Guerre et Paix est typiquement tolstoïen. A l’opposé de tous les personnages nobles (car il s’agit aussi d’une description sociale de la noblesse russe, on y reviendra plus loin) qui semblent tourner en rond, déambuler à la recherche d’un quelconque intérêt à leur vie, le peuple, lui, est le seul qui paraisse parfaitement à sa place, le seul qui sache quoi faire (et qui le fait, de surcroît), le seul qui soit utile, et même le seul qui fasse l’histoire. Un des points névralgiques de Guerre et Paix, c’est lorsque Pierre, intellectuel et noble, emprisonné par les Français, rencontre le modeste Platon Karataev. Enormément de choses se jouent à ce moment-là… Ce thème reste profondément attaché à Tolstoï lui-même, noble qui abandonnera la vie privilégiée à la cour pour se retirer sur son domaine et côtoyer les paysans qui, selon lui, lui apportaient beaucoup plus que tous les comtes et princes…
Le second point commun important avec Les récits de Sébastopol, c’est la réflexion (qui, là aussi, se retrouve dans d’autres œuvres de l’écrivain) sur la mort et la prise de conscience de la mort. Guerre et Paix aurait pu, sur bien des aspects, s’intituler La Vie et la Mort, tant les deux aspects sont entremêlés dès les premiers chapitres. Le bal chez Annette Scherer puis la fête de soûlerie à laquelle participe Pierre alternent avec la mort du père de Pierre. Et ce sera comme cela tout au long du roman. Les scènes de conflit sont dans le même temps fourmillantes d’une vie chaotique, et remplies de morts. Et cette dualité aboutit à deux scènes essentielles, parmi les plus marquantes du roman. Dans la première, Andréï, mortellement blessé à Borodino mais traînant son agonie qui le ramène auprès de Natacha, se décide enfin à mourir après avoir atteint une certaine sérénité. L’approche de la mort permet d’atteindre alors une réalité supérieure. Dans l’autre scène, qui est peut-être celle qui m’a le plus marqué dans le roman, Pierre, emprisonné par les Français qui ont cru voir en lui un des responsables de l’incendie qui ravage Moscou, est amené avec d’autres prisonniers vers le peloton d’exécution. Prise de conscience brutale de l’imminence de la mort s’il en est…
« Comment donc peuvent-ils penser à autre chose qu’à la mort ? », se demande Pierre en voyant les soldats se diriger vers le front, en sachant bien qu’une bonne partie d’entre eux n’en reviendra pas (ce qui prouve que, bien avant la fameuse nuit d’Arzamas et la terreur qu’éprouva l’écrivain à la prise de conscience de sa propre mort, le sujet était déjà bien présent dans la pensée tolstoïenne). Le tour de force du romancier, c’est de faire en sorte que cette mort se rattache à la vie, qu’elle en devienne une célébration de la vie. Il a fallu au prince Andréi d’être au seuil de la mort pour savoir comment vivre.
Finalement, dans le moribond, ne pourrait-on situer la noblesse russe telle qu’elle est décrite par Tolstoï ? La critique qu’il fait de sa propre classe sociale est assez terrible. La noblesse de Guerre et Paix est incompétente et inutile. Elle ne produit rien. Même le peut qu’elle croit pouvoir faire (diriger les troupes, puisque, à l’instar de Tolstoï lui-même, les nobles étaient quasiment d’office des officiers supérieurs), l’écrivain leur en enlève la gloire. Ainsi, il décrit les opérations militaires de 1812 comme une suite d’échecs et d’erreurs d’appréciation qui ont réussi, par hasard, à chasser les Français. Si la guerre fut un succès, ce n’est en rien à cause des décisions prises par le haut commandement. D’ailleurs, la description des embrouilles qui se déroulaient autour du général Koutouzov est savoureuse mais surtout en dit long sur les conflits de pouvoir de ce temps.
Au-delà de l’armée elle-même, c’est tout le fonctionnement de la Russie qui est attaqué (doucement aussi, il ne faut pas exagérer : l’empereur qui règne au moment de la sortie du roman est le neveu de celui qui régnait à l’époque décrite, il ne faudrait pas le froisser non plus…). Les ministres qui se succèdent selon le bon vouloir du tsar, les politiques étranges, les modes passagères, les intrigues de cours…
Tout au long du roman, l’aristocratie semble souffrir de deux maux : être éloignée des véritables préoccupations du « vrai peuple » (ce qui est un thème qui hantera toute la vie de Tosltoï, au point qu’il abandonnera la vie de cours pour vivre « près » de ses paysans et même manier la charrue à leurs côtés) et être dans l’oisiveté. Une oisiveté qui est le point de souffrance commun de Pierre e Andréï, qui tout au long du roman se demandent ce qu’ils doivent faire. Quelle est leur place exacte dans cette grande mécanique de l’Etat, de l’Europe même (Pierre est un européiste convaincu, un admirateur de Napoléon même au début du roman) et de l’ensemble de l’univers (voir la conversion de Pierre à la franc-maçonnerie). Cette place, ils vont la chercher dans le grandiose (réformer le fonctionnement de l’armée, introduire plus d’humanité dans le gouvernement des hommes) alors que c’est vers l’humilité qu’il faut se tourner pour trouver une véritable raison de vivre, nous dit Tolstoï.
Il y aurait encore, bien entendu, énormément de choses à dire sur ce roman titanesque : son rapport à la Russie elle-même (mes profs citaient des passages du roman comme exemples typiques d’actions ou de caractère russes) ; l’extraordinaire poésie et le mysticisme qui l’habitent ; le fait que Tolstoï a finalement peu apprécié le roman, qu’il a remanié plusieurs fois, etc. Ce qui importe, c’est que Guerre et Paix est une œuvre monumentale et unique, un de ces romans ne ressemblant à aucun autre, d’une richesse inépuisable et qui peut se savourer aussi bien pour son intelligence que pour les émotions qui s’en dégagent.