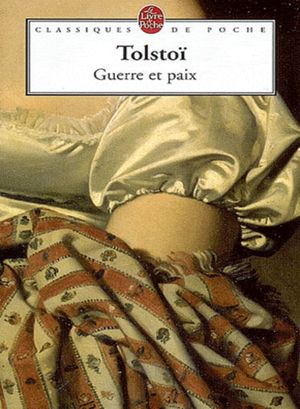J’ai récemment eu l’occasion de survoler un article quant à la mélancolie (si ce n’est même la tristesse) qu’éprouvent certaines personnes en terminant un livre. D’après mes souvenirs, ce ne fut qu’à une seule et unique occasion que j’ai pu partager ce sentiment, il y a de cela plusieurs années, en terminant Malevil (que je ne pourrai jamais suffisamment recommander). En ce qui concerne le présent cas, j’ai fait face à une condition sensiblement distincte, une espèce d’état moins navrant mais faisant bien davantage songer à une sorte d’insurmontable mur. Je crois en somme qu’il était question d’une certaine forme de déni, d’un refus radical de constater que le roman devait se clore et de me voir contraint par cet état de fait ayant eu pour immédiate conséquence de faire du parcours de l’épilogue une tâche passablement ardue. Je puis même dire, d’une certaine façon, que s’agitait en moi un réel ressentiment, ou plutôt, en vue d’être parfaitement explicite, que l’ampleur de ce monument était telle que la possibilité de me montrer apte à en venir à bout me paraissait suffisamment invraisemblable pour assimiler l’idée qu’en un certain sens cette fin, que je pensais ne jamais lire, n’existait pas. Et pourtant, page après page, je suis parvenu à destination.
Ce fut d’ailleurs tout autant inattendu. On m’avait assuré vis-à-vis de la littérature russe que l’ampleur de ses ouvrages était imputable à la lenteur de ses récits, à la profusion à l’envi de détails au sein d’interminables passages descriptifs et à l’usage abusif de digressions généralement indues. À cela, je puis répondre au moins qu’à propos de Guerre et Paix cette idée ne s’avère en aucun cas et ne pourrait même être davantage erronée car on a sans conteste affaire à une œuvre particulièrement dense et bien remplie. Si je m’inscrivais dans un panégyrique, je pourrais même aller jusqu’à formuler l’idée qu’il puisse être un roman complet car Tolstoï allie dans sa composition différentes dimensions. À l’épopée historique que chacun suppose à l’aune du prestige de son titre s’ajoutent et s’entremêlent un roman psychologique, un feuilleton social, un récit nationaliste (1), un traité philosophique et un carnet métaphysique. C’est cela donc, avant tout, qui explique son envergure et la sensation qu’il m’a été donné de subir en le terminant : je n’avais jamais vu telle fresque et il m’était bien difficile d’admettre dès lors qu’elle puisse s’achever.
De la sorte, la dimension la plus évidente, la première qui fut citée, est relative à la destinée de l’Empire russe durant quinze années considérablement pénétrées par l’épopée napoléonienne. Néanmoins, l’auteur n’en demeure pas là en s’attachant à dépeindre ces événements à échelle humaine. C’est donc qu’interviennent d’innombrables personnalités à la base des intrigues psychologiques que l’on retrouve au sein de cette somme artistique. L’on assiste en conséquence à l’intimité du sort de trois lignées aristocratiques et aux déboires de belligérants de tous niveaux (du débonnaire Koutousov (2) au simple homme de troupe qu’est Platon Karataïev). De toutes ces personnalités, de leurs manipulations et des rebondissements qui en découlent, émerge en ce cas une véritable analyse sociale de la condition aristocratique russe à l’époque. Cependant Tolstoï allie cette élite au peuple de telle sorte que puisse se modeler les fondations du réveil antinapoléonien et c’est donc là qu’intervient le souffle nationaliste. Guerre et Paix se révèle aussi comme un roman philosophique concernant pour sa part diverses considérations historiques. En ce sens, l’auteur utilise les événements de son œuvre de manière à porter de multiples jugements sur les actions des hommes et sur les analyses (voire parfois le rôle) des historiens (3). Mais pour encore aller au-delà, Tolstoï ajoute de la puissance à son livre en traitant des problèmes fondamentaux de la métaphysique. Car en suivant les pérégrinations de Pierre Bézoukhov, assurant certainement le rôle du personnage le plus important (à défaut qu’il puisse y avoir un protagoniste dans ce livre), le plus célèbre des auteurs russes met en scène l’alliance entre la philosophie et la métaphysique afin de s’attacher à la quête élémentaire du bonheur…
L’absence de toute douleur, la satisfaction de tous les besoins et, ce qui en est la conséquence, la liberté dans le choix de ses occupations, c’est-à-dire de son genre de vie, paraissaient maintenant à Pierre le bonheur certain et suprême de l’homme.
[...]
Ce but de la vie, qu’il cherchait, n’avais pas seulement cessé d’exister pour lui pour la minute présente ; il sentait qu’il n’y avait pas de but, qu’il ne pouvait pas y en avoir. Et c’était cette absence de but qui lui procurait cette conscience pleine et joyeuse de sa liberté qui faisait alors son bonheur.
… Bonheur que l’on retrouve aussi, et tant mieux, dans la lecture de ce formidable roman.
Notes :
(1) Roman nationaliste ou patriotique ? Quiconque n’étant pas nationaliste peut définir ce concept par l’adage bien connu affirmant que « le patriotisme correspond à l’amour des siens tandis que le nationalisme équivaut à la haine des autres. » Si l’on s’en tient à cette définition, alors Guerre et Paix est effectivement un roman nationaliste. Pour s’en convaincre, il suffit de repérer tous les passages où Tolstoï s’emporte sur la bêtise et la barbarie des Français, ou même de considérer l’exemple suivant :
Pfuel était un de ces êtres qu’une confiance désespérée en leurs idées peut mener jusqu’au martyre, et qu’on ne rencontre guère qu’en Allemagne, car seuls les Allemands fondent leur assurance sur une idée abstraite, la science, c’est-à-dire la prétendue connaissance de la vérité absolue. Le Français est sûr de lui parce qu’il s’imagine exercer, soit par son esprit soit par son physique, une séduction irrésistible, tant sur les hommes que sur les femmes. L’Anglais est sûr de lui parce qu’il se croit le citoyen de l’État le mieux policé du monde ; en qualité d’Anglais, il sait que tout ce qu’il fait est indiscutablement bien fait. L’Italien est sûr de lui parce que sa nature facilement émotive lui fait oublier et lui-même et les autres. […] La suffisance de l’Allemand est la plus obstinée et la plus odieuse de toutes, car il se figure connaître la vérité, autrement dit la science qu’il a lui-même fabriquée, mais qu’il tient pour la vérité absolue.
De son côté, un nationaliste dirait de cette même notion qu’elle correspond à l’idéologie voulant que la nation soit la réponse aux problèmes traversant son peuple. De cette façon, Guerre et Paix est également à considérer en tant que roman nationaliste car c’est, d’après Tolstoï, l’esprit de la nation russe qui a vaincu Napoléon (les autres facteurs étant, à ses yeux, négligeables).
(2) Je retranscris ici la description, plutôt amusante, du général Koutousov :
Son énorme corps enveloppé dans une longue tunique, avec son dos voûté, sa tête blanche découverte, son œil sans regard noyé dans son visage flasque, il arriva de son allure plongeante et balancée et s’arrêta juste derrière le prêtre.
(3) C’est à mon avis le seul aspect un peu faible du livre, m’empêchant même de lui attribuer les dix points qu’il mériterait sans cela. Occasionnellement, Tolstoï se contredit dans ses analyses et se montre à maintes reprises ingénu (son nationalisme est, finalement, assez niais).