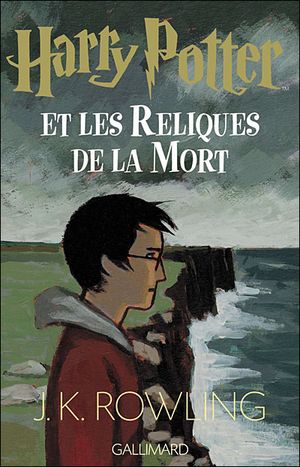Encore plus rempli de deus ex machina que les six premiers volumes, Harry Potter et les Reliques de la Mort m’a paru s’en sortir presque mieux pour autant, notamment parce qu’il emprunte à l’épopée et à la tragédie. (Je laisse de côté l’épilogue : je qualifierai pudiquement de regrettable cette sorte de service après-vente Harry Potter – ce Darty Harry ?)
Les six premiers volumes étaient certes marqués par le danger ; le septième, et enfin, l’est par la fragilité, notamment parce que Poudlard n’est plus un refuge et que Dumbledore est à présent en position couchée. La survie du trio, plus que jamais, ne tient qu’à un fil, et les premiers morts tombent dès après le départ de Privet Drive. Cette première grande scène, qui succède immédiatement à la liste des combattants présents, donne tout de suite une coloration épique au roman (le vol de pairs d’Harry par-dessus les champs monte dans les nuages, c’est ça).
Elle introduit, par ailleurs, le nomadisme auquel se livrera le trio héroïque, qui dès le départ ne peut plus renoncer. Et cela pimente tout de même l’ensemble, quand un héros ne peut pas faire machine Harry-ère. Il y a quelque chose de tragique dans cette dernière aventure : une forme de destin qu’Hermione souligne elle-même : « On vient avec toi. La décision a été prise il y a des mois – des années, en fait » (p. 120). Que « la décision » soit aussi celle de l’auteure, que « on » ou « toi » puissent aussi désigner le lecteur, est une de ces petites richesses, ici méta-littéraire, qu’on trouve çà et là dans les Reliques de la Mort.
Il me semble que ce nomadisme est aussi un trait épique – cf. cet interminable moment du dernier volume du Seigneur des anneaux, où les champions n’ont plus de lièvre, et se retrouvent seuls. (Solitude du trio dans l’univers, solitude du héros dans le trio. Je crois que la solitude, par contraste et peut-être paradoxalement, est encore un trait de l’épopée.)
L’autre véritable grande scène, symétriquement, se passe au chapitre 34. À une marche de quelques minutes dans la forêt succède un duel, qui n’en sera pas vraiment un, entre le parasite Voldemort et son hôte Harry – à moins que ce soit l’inverse. On y découvre – enfin ! – le style indirect libre : « Pourquoi n’avait-il jamais su apprécier ce miracle que constituait son être, ce cerveau, ces nerfs, ce cœur qui bondissait dans sa poitrine ? Tout cela allait disparaître… » (p. 807).
Ce chapitre 34 est, littérairement, l’un des plus aboutis. D’une part, il emprunte quelques motifs mythologiques toujours efficaces. On peut, par exemple, lire la fausse mort de Harry (et tout le chapitre 35) comme une reprise de la descente aux enfers qu’accomplissent Ulysse, Orphée ou Hercule.
Du reste, et cette fois c’est quelque chose de plus singulier, il n’y Ha rry-en dans ce chapitre qui ne soit l’écho d’une des quatre mille et quelque pages qui ont précédé. Au lecteur innocent qui se demanderait, à ce moment-là du récit, si Harry va survivre, le narrateur fournit au moins un indice : Voldemort est comparé à « un enfant qui comptait jusqu’à cent en jouant à cache-cache » (p. 818-819) puis à « un enfant en proie à la curiosité, se demandant ce qui arriverait s’il poussait les choses plus loin. » (p. 820).
Vous souvenez-vous à quel moment Voldemort se présentait sous les traits d’un enfant – d’un genre de monstrueux fœtus, si on veut être précis ? Dans le duel final de la Coupe de Feu. Avant sa véritable renaissance, qui ne se produit que grâce à la servilité de Pettigrow. Je lis ces deux comparaisons comme l’annonce de sa régression. (C’est assez logique aussi si on considère que Voldemort et Harry s’équilibrent : Harry devient adulte, il ne peut pas être celui qui redevient enfant.)
Là où Harry incarne l’avenir, Voldemort se fera finalement détruire par son passé – par la crainte qu’il a entretenue même chez ses alliés, par le désir de vengeance qu’il a fait naître chez Neville, par le Horcruxe involontaire qu’il a créé p-Har ry-cochet seize ans et demi plus tôt.
Paradoxalement, malgré son dragon, ses transplanages à gogo et sa quête d’objets légendaires, ce septième volume est peut-être celui qui entretient le plus étroitement des liens avec le réel. « – Bien sûr que tout ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n’est pas réel ? » (p. 843), déclare Dumbledore – ce qui me semble parfaitement s’appliquer à la fiction en général, au merveilleux en particulier.
Comme toute tragédie, Harry Potter et les Reliques de la Mort a son coryphée, Peeves commentant l’action, et comme pas mal de tragédies modernes, elle exhibe son caractère tragique : quand Peeves chante « On les a eus, / Vaincus, battus, / Le p’tit Potter est un héros, / Voldy nourrit les asticots, / Ils ont tous été écrasés, / Maintenant on peut rigoler ! / – Voilà qui exprime bien l’ampleur et la tragédie de l’événement, vous ne trouvez pas ? dit Ron » (p. 870-871).
Naturellement, relever ce que ce roman a d’épique et de tragique met moins en lumière la puissance du roman que celle de l’épopée et de la tragédie.