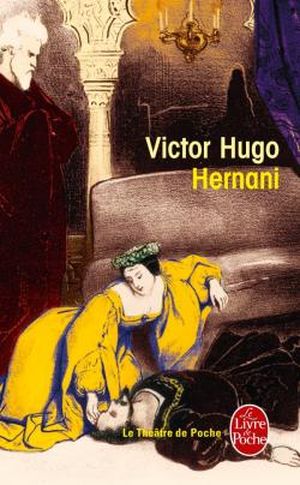On peut quand même trouver un petit côté terroriste – au sens figuré ! – à Hernani : rétrospectivement, et après la bataille, ne pas aimer la pièce revient à se placer du côté des « genoux », des réactionnaires, bref, des bourgeois. Trop souvent, émettre l’hypothèse qu’on puisse y trouver des choses ratées implique soit de se référer à des règles littéraires plus ou moins contraignantes dont le respect n’a jamais rien garanti en termes de qualité, soit de quitter le champ de la littérature pour aller galoper dans ceux de l’histoire, de la psychologie ou, pire, de la morale (1). Toutes ces options, du reste, ne sont pas incompatibles entre elles. (Et ces remarques ont sans doute à voir avec le « Victor Hugo, hélas ! » d’André Gide.)
De fait, à l’aune du drame romantique – la liberté, « l’escalier / Dérobé », le grotesque et le sublime et tout le tintouin… – dont l’enseignement nous rebat les oreilles comme si elle n’était pas autre chose, la pièce, hélas, m’a semblé fade. Libre à chacun de penser que le comble du grotesque consiste à faire entrer un roi dans une armoire ; est-ce suffisant ? Même Robert Hossein, dans sa très épaisse mise en scène, s’est senti obligé d’y remédier – en ajoutant à la distribution un nain muet, oui…
Quant au sublime… Les passages de la pièce qui me paraissent les meilleurs – le monologue de la fin de l’acte I, par exemple, ou la scène des portraits – n’ont rien à voir avec le sublime. Faut-il se dire que le sublime ne se commande pas ? « Si noir que soit le deuil qui s’épand sur ma vie, / Je suis un homme heureux et je veux qu’on m’envie ! / Car vous m’avez aimé ! car vous me l’avez dit ! / Car vous avez tout bas béni mon front maudit » (Hernani à doña Sol, II, 3), c’est très beau ; mais comme Hugo fait aveuglément confiance aux mots, il décrète le sublime sans le montrer. Et c’est pour de tels passages qu’il faudrait une mise en scène à fois très naturelle et très premier degré, qui réussisse à y faire croire le public (3).
Ce qui reste alors d’Hernani, c’est une histoire d’amour contrarié, comme cent mille autres histoires d’amour. Résumé par don Ricardo, ça donne ceci : « Trois galants, un bandit que l’échafaud réclame, / Puis un duc, puis un roi, d’un même cœur de femme / Font le siège à la fois » (V, 1). De fait, Hernani et doña Sol s’aiment d’un amour pur. Don Ruy Gomez aime doña Sol d’« un amour sévère, / Profond, solide, sûr, paternel, amical » (III, 1) que leur différence d’âge présente immédiatement comme source de problèmes. Quant à don Carlos, il aime à peine doña Sol : il cherche avant tout à la conquérir exactement comme on étend son pouvoir sur un continent.
Et on en arrive à ce qui grince le plus dans la mécanique d’Hernani : doña Sol. Elle aime Hernani, elle passe une bonne moitié de ses répliques à le lui jurer, elle observe ce qui se passe autour d’elle, elle ruse un peu… Mais elle n’agit pratiquement pas. Elle n’a qu’un seul double dans la pièce : Hernani, là où les autres personnages principaux sont mutuellement pris dans un jeu d’attraction / répulsion qui les fait mouvoir. Que cela fasse d’elle un excellent fantasme masculin, dans l’intrigue ou hors scène, ça me paraît évident (4). D’ici à en faire un personnage principal solide, c’est bien plus discutable.
Et au bout du compte, ce qui m’a le plus retenu dans la pièce, c’est la peinture du pouvoir (5). Car Hernani est aussi l’histoire d’un noble déchu qui refuse de partager son bien – désolé, doña Sol… – avec un noble de la vieille Espagne et avec un roi qui deviendra empereur. Pendant ce temps, la vieille doña Josefa se contente de quelques piécettes. Y a-t-il besoin de moderniser ces nobles accrochés à leur naissance, ces conjurés vivant par et pour le pouvoir exclusivement, ces courtisans abdiquant toute fierté d’hommes pour « quelque titre creux, quelque hochet qui brille » (I, 4) ?
(1) Il me semble que le subtil Stendhal ne dit pas autre chose quand il écrit dans Racine et Shakespeare : « Racine ne croyait pas que l’on pût faire la tragédie autrement. S’il vivait de nos jours, et qu’il osât suivre les règles nouvelles, il ferait cent fois mieux qu’Iphigénie. »
(2) Du reste, si cette mise en scène me paraît fidèle au texte, c’est surtout – et uniquement ? – dans la mesure où le grotesque n’y est pas toujours voulu.
(3) Que l’idée de naturel soit étrangère à Hernani peut poser difficulté (« M. Victor Hugo ne rencontrera jamais un trait de naturel que par hasard », dixit Balzac…), mais c’est sans doute plus intéressant pour un metteur en scène – et plus véritablement novateur – que de monter Phèdre en costumes 1950 ou de transposer Cyrano dans un hôpital psychiatrique. Quant à la mise en scène de Robert Hossein, là encore, elle est trop épaisse pour cela, trop soucieuse de reconstitution historique, d’autant qu’à l’exception de Jean-François Rémi qui interprète le vieux duc, les comédiens ne brillent pas – mention spéciale pour le duo d’amoureux.
(4) Doña Sol, Roxane : sur ce point comme sur d’autres, on peut rapprocher Hernani de Cyrano de Bergerac. Mais si l’héroïne de Rostand me paraît ratée, c’est sans commune mesure avec celle de Hugo. Au moins la première est-elle tiraillée entre des attractions contraires – Cyrano / Christian, amour / réclusion… –, alors que la seconde est, plus encore que son amant, « une force qui va » (III, 4), mais qui va dans une seule direction.
(5) Ce qui est drôle, c’est que le thème du pouvoir est commun à Hernani et à plus d’une tragédie classique ! Il fait aussi partie de ce qui distingue la pièce de Hugo de deux autres auxquelles on la compare quelquefois : Roméo et Juliette et Cyrano.