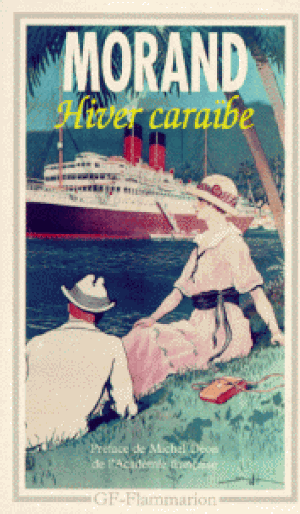Bon, parlons tout de suite de ce qui ne va pas.
En novembre 1927, Paul Moral embarque sur un paquebot de la CGT (Compagnie Générale des Transatlantiques) de Bordeaux vers les Caraïbes. Il tient avec lui ce carnet de voyage, qui court jusqu'à la fin de l'année. Il emporte avec lui un certain nombre de livres, dont le torchon de Gobineau (Essai sur l'inégalité des races humaines). L'auteur avoue en cours d'ouvrage qu'il adhère aux théories de Gobineau, avec quelques réserves.
De fait, la question des "races" revient régulièrement dans les entrées du journal. Je ne me formalise pas de l'utilisation de "nègre" ou "nègresse", courant à l'époque. En revanche les notations sur la manière dont les Caribéens sont plus beaux quand ils font des métiers physiques que s'ils essaient de singer l'Occidental ; la fascination-répulsion pour les métis ; l'éloge de la politique de verrouillage migratoire des Etats-Unis à l'époque
("L'Amérique nous montre comment on assainit, comment on défend une race : n'oublions pas cet exemple [...] Toute la vie française est question d'équilibre entre le Midi et le Nord. Or, depuis un siècle, cet équilibre est rompu. Nous avons besoin de sang celte, de sang saxon et germanique, de sang celtique") :
Tout cela, aujourd'hui, est absolument accablant. Et je ne parle pas de l'exotisme érotico-colonial, présent à chaque escale.
Et pourtant, il faut reconnaître une certaine lucidité à l'auteur. Bon, comme tout décliniste, il est persuadé d'être le dernier témoin de la civilisation avant qu'elle ne s'écroule. Morand est conscient de l'orage qui vient
("J'aurai joui en pleine conscience du monde qui finit, j'aurais vu les derniers beaux pays, reçu les derniers saluts de races encore respectueuses. Blanc, je me promène dans les mondes jaunes et noir comme un seigneur qui reçoit les hommages des paysans à la fin du XVIIIe").
Il est également très sensible au patrimoine artistique des territoires qu'il traverse : il rencontre des intellectuels haïtiens et les encourage à ne pas copier Paris ; il écrit de longues pages sur le patrimoine aztèque dont il déplore l'annihilation par les conquistadors ; il a des remarques critiques sur la colonisation (et d'autres complètement béates, comme tout employé du Quai d'Orsay).
Au-delà de cette question, il faut reconnaître à Morand un talent pour brosser en quelques mots des impressions de voyage, des tableaux (dont on peut parfois se demander s'ils sont vrais).
Pour suivre un peu son parcours, il fait arrêt en Guadeloupe et Martinique, puis à Trinité et Tobago (où, comme dans les autres territoires anglais qu'il traverse, il est frappé du côté guindé anglais qui infuse), à Curaçao, décrit comme un emporium ouvert au monde où absolument tout se trafique ; à Haïti, où il est témoin de l'occupation américaine mais aussi du foisonnement littéraire et de la beauté de l'île (que donnerais-je pour pouvoir y aller un jour) ; à la Jamaïque, mieux exploitée qu'Haïti mais plus sage), à Cuba, où Santiago est une sorte de Monte Carlo pour Américains en goguettes. De là, Morand passe à Vera Cruz et remonte au Mexique, avant de passer aux Etats-Unis (l'ouvrage se conclue sur l'arrivée face au Pacifique).
Ce que j'aime le plus, ce sont ces notations de voyage au rythme haché, très dynamique, dans lesquelles Morand place parfois de belles fulgurances.
"Zone tempérée. Les tunnels s'espacent. Désormais nous ceinturons la montagne par des ponts en fer à cheval. La nuit tombe. Voici Cordoba".
Je pourrais ainsi multiplier les exemples, en particulier pour ce qui concerne les paysages et la météo. Morand est un peintre.
Un ouvrage formellement beau, au contenu parfois nauséabond.