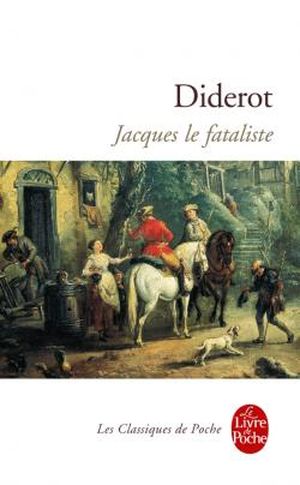Il y avait bien l'Astrée d'Honoré d'Urfé, ou Clélie, de Madame de Scudéry. Mais, en ce siècle des Lumières, le roman peinait encore à s'affirmer comme genre viable. Difficile aujourd'hui pour nous, qui en avons fait la chair primordiale de notre littérature, de l'envisager. C'est en défense de ce genre en lequel il perçoit une forte capacité potentielle à représenter l'Homme et sa morale que Diderot publie Jacques le Fataliste.
Sorte de conte philosophique qui suit les déambulations d'un maître et de son valet à travers champs, l'œuvre développe une mise en relief d'un certain nombre d'idées philosophiques, va à la rencontre de quelques Hommes, se penche sur leurs aventures en tachant d'en donner une estampe qui leur rende leur vie, et, de là, développe une réflexion artistique en décalage par rapport aux canons du temps. Mais où va l'intrigue ? Nul ne le sait, ni les personnages (Jacques, son maître et le narrateur), ni le lecteur – d'ailleurs, qui pourrait bien savoir où ils iraient, quand il peut plaire au Ciel d'abattre un déluge sur les deux voyageurs, ou à Jacques d'aller tâter de la solidité de son crâne contre un linteau qui manquerait de l'enfouir six pieds sous terre ?
Et c'est tout le propos de Jacques le Fataliste. Sa structure en branches d'étoile, qui se projette dans le récit d'un passant, pour revenir aux amours de Jacques, et repartir vers un autre voyageur rencontré, suit ce qui se veut être la "réalité". Le narrateur la prône sans cesse : « Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le prendrait pour une fable. ». Et cela pour une cause : il récuse le vieux roman, « chimérique et frivole », celui de plusieurs milliers de pages, où les rebondissements s'enchaînent à qui mieux mieux, mais où rien d'imprévu ne peut arriver. Diderot arrête l'action au moment du pathétique, s'immisce dans le récit, émet quelques opinions, mais surtout, montre comment les choses auraient pu tourner autrement dans une histoire inventée pour ravir son lecteur – cette alternative qu'il envoie valdinguer avec la plus grande désinvolture, nous assénant plutôt une histoire inopinée, dont on se serait à l'évidence bien passé.
Jacques n'est pas un roman. Il en revêt par instants les codes, mais c'est pour mieux les brocarder. Aussi ses personnages ne sont-ils jamais que des pantins articulés que le philosophe manipule à l'envi pour mettre à l'épreuve sa thèse philosophique. Face au maître qui se conçoit comme libre, Jacques maintient, en de grands mots qu'il tient de son capitaine, que tout événement « est écrit là-haut, sur le grand rouleau », et refuse donc à l'Homme toute liberté. Comme dans Candide, l'idée est mise en face des faits, éprouvée dans des situations plus ahurissantes les unes que les autres, une, dix, puis trente fois. D'abord on en rit, et on en évalue la portée philosophique ; mais bien vite, on s'ennuie, on sait paradoxalement où Diderot va en venir : à bien peu de choses, et surtout à une fin leste et dégourdie, à l'image de l'impasse dans laquelle le fatalisme de Jacques ne cesse de tomber.
Il m'a semblé que l'œuvre avait, avant même que j'y goûte, perdu de beaucoup de sa saveur. La faute au nombre d'extraits choisis dans mes cours de littérature qui me l'avaient forgé, dans mon imaginaire, comme une sorte de Queneau du XVIIIè siècle ? Ou bien à de véritables longueurs que comporterait le livre ?
L'ombre du philosophe plâne partout : dans les conversations, on l'entend, ironique, jouant tous les rôles à la fois, et menant du bout de sa baguette ses personnages sur le plateau de son raisonnement. "La vérité", certes, mais une vérité sélectionnée pour éprouver une thèse donnée.
Pour autant, certaines histoires sont franchement drôles, et, par petites pointes, ouvrent vers des images fortes, et des interrogations intéressantes – ce que je n'avais pas trouvé dans Candide. L'histoire des premiers émois de Jacques tandis qu'il vivait auprès de Bigre son parrain et de Bigre son ami est une grosse farce, et brillamment écrite à l'image de l'Odyssée de Jacques et de son maître se filant dans des absurdités aussi poilantes que profondes. Des figures attachantes sont dépeintes avec vigueur, et quelques mots bien placés vous arracheront, c'est certain, un sourire.