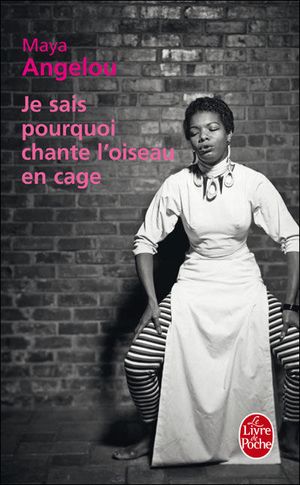Dans le premier tome de son oeuvre autobiographique, Maya Angelou retrace son enfance passée entre le Sud des États-Unis et la Californie. En relatant sa vie de jeune fille noire dans les États-Unis des années 1940-1950, l'autrice donne à voir l'ampleur de la violence spécifique qu'elle subit : le racisme d'abord, et toute la colère qu'il provoque chez la narratrice, mais aussi la violence domestique des adultes envers les enfants, grandement liée à la religion, ainsi que l'inceste infligé par son beau-père et l'abandon des parents. Le récit de ces différentes oppressions, ponctué de commentaires rétrospectifs inhérents au genre autobiographique, donne à ce texte une dimension collective et en fait une oeuvre essentielle à la compréhension de la misogynoir dans le contexte étatsunien. D'un point de vue littéraire, le récit est prenant et embarque la lectrice, avide de découvrir l'évolution de la jeune Maya face à ce contexte excessivement oppressif. La violence des événements décrits contraste avec l'importante esthétique formelle du roman qui dévoile le style marquant de son autrice, et cette mise en relief n'affirme que davantage la pertinence du texte.
Le seul écueil politique réside dans une grossophobie mobilisée à plusieurs reprises sans être questionnée, liée comme souvent à la représentation des classes/individus dominants à cette époque.
Cette lecture appelle néanmoins la découverte du volume suivant de l'oeuvre autobiographique de Maya Angelou.