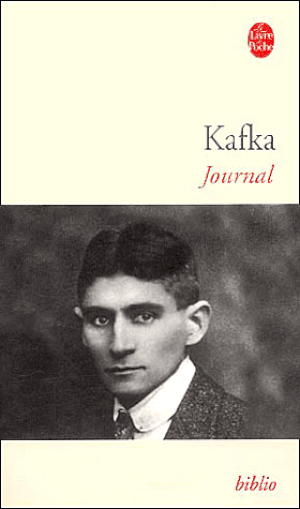C’est si peu : de 27 à 40 ans, soit treize années de Journal, et 600 précieuses pages. Rien d’autre que quelques fragments épars, disparates, qui s’attachent timidement à sauver l’essentiel. Chez Kafka, le Journal n’est pas une pratique rigoureuse mais douloureuse. Il est question de lutte, de faiblesse, de déception. Et la véritable héroïne, l’écriture, ne cesse de se refuser, de s’éloigner.
Le parcours de l’auteur - sa fulgurance et son immobilité - n’est pas sans rappeler celui de Proust. L’univers familial étouffant qu’il ne quittera jamais a quelque chose de paradoxal et de fascinant. Imaginer Kafka accomplir de vaines tâches administratives, travail qu’il subit pour agréer son père, est impensable. S’il souffre de ce gâchis, il le reproduira pourtant à l’infini. Tout semble vécu et accepté avec passivité et angoisse. Les réunions figées dans le salon le soir, autour de jeux de cartes, bercent le quotidien en empêchant toute création. La silhouette surprotectrice de la mère plane sur la maison entière, et calme son hypocondrie tenace. Ces attaches parasitaires s’infiltrent jusque dans le bureau, s’insinuent derrière les mots, et ne lui laissent aucun répit. Les fiançailles avortées avec F. sont l’unique rebondissement de cette existence monotone, et là encore, c’est l’abandon et l’indifférence qui sont les plus forts.
Englouti dans cette temporalité homogène, recluse, le Journal est le symbole du renoncement à la vie même. Il annonce le sacrifice des découvertes, des expériences, des intensités – pour la solitude et le labeur. Il est le récit d’un grand combat interne : celui qui mènera à l’écriture. Dans le plus grand désordre, les années avancent, irrégulières, fragiles. L’épuisement nerveux de Kafka s’aggrave, son abnégation se radicalise. Il se construit un monde onirique et inquiétant, peuplé de visions angoissées, proche de ses romans. Et sa seule espérance, dans cet absolu vide factuel et sentimental, est celle de la littérature. Il la ressasse sans cesse, pour s’encourager, et se jeter plus loin, plus profond, dans l’écriture.
Le Journal de Kafka est l’exemple parfait de l’échec éclatant d’une vie, et de la réussite littéraire indiscutable. Au fond, une forme d’équilibre rare.
Extrait :
« Ce qui égare souvent dans les journaux, les conversations, au bureau, c’est la vie débordante du langage ; ensuite, c’est l’espoir, suscité par une faiblesse momentanée, qu’on va connaître dans un instant une illumination d’autant plus violente que soudaine ; ou encore, uniquement une forte confiance en soi, ou une simple nonchalance, ou une grande impression du présent que l’on veut à tout prix décharger sur l’avenir ; ou encore la supposition qu’un sincère enthousiasme vécu dans le présent justifierait toutes les incohérences de l’avenir ; ou encore le plaisir que vous procurent des phrases dont le milieu est soulevé par un ou deux chocs et qui vous ouvrent graduellement la bouche jusqu’à lui faire atteindre sa plus grande dimension, même si elles vous la ferment ensuite beaucoup trop vite et en vous la tordant ; ou encore l’indice d’une possibilité de jugement catégorique fondé sur la clarté ; ou encore l’effort qu’on fait pour donner de l’entrain à un discours qui, en réalité, touche à sa fin ; ou encore une envie de quitter le sujet en toute hâte, ventre à terre s’il le faut ; ou encore un désespoir qui cherche une solution au problème de sa respiration difficile ; ou encore le désir passionné d’une lumière sans ombres – tout ceci peut vous égarer au point de vous faire dire des phrases comme celle-ci : « Le livre que je viens de finir est plus beau que tous ceux que j’ai lus jusqu’à présent » ou bien « est d’une beauté que je n’ai encore trouvée dans aucun livre ».
(traduit de l’allemand par Marthe Robert)