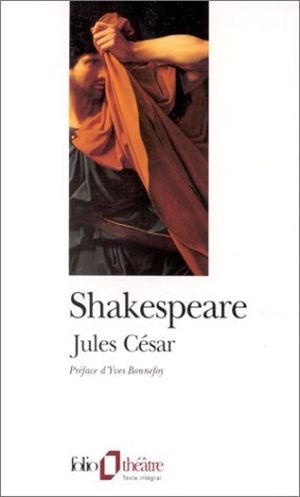Oeuvre de transition pour William Shakespeare, qui vient de terminer son cycle historique avec « Henry V », « Jules César » hésite entre un classicisme d'apparat, basée sur l'étude de la chute des rois, et l'introspection philosophique, teintée du baroque des profondeurs et d'une certaine idée du chaos cosmique. Dit comme ça, ça envoie du bois, hein ? Sauf que j'ai dit « hésite » et pas « lie harmonieusement ».
Suivant avec une assez grande exactitude la réalité historique, surtout via Plutarque et sa « Vie des hommes illustres », Shakespeare offre une vision particulièrement claire du complot opéré contre Jules et de la guerre civile qui en découla. En chemin, il a juste oublié de s'attarder sur les motivations de Brutus, symbole absolu de ce complot, ou plus exactement de les expliciter comme le spectateur (on est au théâtre, je vais donc éviter de dire 'lecteur') est en droit de l'attendre. Il est dit que César aime Brutus et que Brutus aime César. C'est beau. Mais on apprend aussi que Brutus, fidèle à ses conceptions philosophiques, ne peut s'empêcher de haïr le pouvoir absolu de César qui, dit-on, convoite la royauté. Après une réflexion de sept secondes, Brutus décide donc que César doit mourir. Mais il l'aime, hein ?
Tous les éléments de la tragédie sont là, appuyés, de plus, par la vérité historique, et on ne pouvait qu'espérer un déchirement de Brutus, une longue réflexion qui mènerait celui-ci au plus difficile de tous les actes humains: la soumission des passions, le sacrifice de l'être aimé (César le considère comme son fils !) à un idéal qui transcende la personne pour toucher à l'universel (au nom de la liberté, César ne doit pas détruire la République !). Mais, dans les faits, Brutus prend sa décision en une dizaine de vers. Pour ce qui est de ressentir son abnégation, son sacrifice insupportable, on repassera. Impossible de prendre au sérieux le conspirateur ni les nobles phrases qu'il prendra la peine de construire par la suite.
Bien sûr, le Brutus de cette tragédie n'a rien d'un lunatique. Le spectateur comprend parfaitement qu'il pense depuis bien longtemps à la possibilité de cet assassinat. Mais nous sommes tenu à l'écart de ce dilemme intérieur. De la guerre intime que Brutus livre à Brutus, nous ne saurons pas grand chose, du moins dans la première moitié de la pièce. Shakespeare préfère concentrer ses effets sur le déchainement de la nature (qui annonce l'orage d'Hamlet) et l'apparition de signes apocalyptiques qui prophétisent la chute de César. Et d'appuyer tellement dessus qu'on en confine au grotesque ! Vouloir donner une épaisseur « fantastique » à un fait historique tout ce qu'il y a de plus politique, ça demande un brin de subtilité en sus. César, esquissé, se moque d'apprendre que des soldats de feu combattent dans les cieux, que les devins lui disent qu'il va crever et que des lions se promènent en ville. Du coup, l'on ne sait jamais vraiment s'il est juste un crétin orgueilleux ou s'il recherche tacitement la mort qui le libérerait de la peur perpétuelle du complot. Cette seconde option, historiquement proposée, notamment, par Suétone, aurait donné à ce César une ampleur tragique pour le coup véritablement shakespearienne, puisque l'oeuvre du Barde est traversée par l'idée du suicide au moins depuis « Roméo et Juliette ».
Non, ici, César ne semble ni particulièrement mélancolique, ni spécialement orgueilleux. Peut-être est-il simplement stupide. Et Brutus semble vouloir l'imiter en s'enfermant dans des contradictions qui nous fait douter de sa soi-disant sagesse: « César est l'homme le plus vertueux que je connaisse mais je sais qu'il va devenir un tyran. A MORT ! » C'est ça, calme-toi...
Heureusement, la seconde moitié de l'ouvrage est sans conteste bien meilleure. L'acte IV contient le plus beau moment de toute la pièce et peut-être même la plus belle scène que j'ai lu de Shakespeare jusqu'à présent. Vous avez dit paradoxal ? Une dispute dantesque, suivie d'un incroyable moment onirique où toutes les contradictions de Brutus éclatent et se résolvent en même temps. Dieu que c'est beau ! Diable que cela arrive tard ! Le final, de plus, est épique et couronne cette tragédie d'une grâce frangée de frustration (pourquoi ce début aussi bancal ?). Qu'avons nous réellement lu ? Un condensé de stéréotypes mal agencés fondre peu à peu dans une extase baroque. Un procédé alchimique qui prépare aux jouissances de l'écriture d'un Shakespeare qui atteint à la maturité et à la recherche de l'éternel dans la douleur d'être soi.
N.B.: Comme d'habitude, lu dans sa version Folio, traduction élégante de Bonnefoy, également auteur d'une préface qui, cette fois, s'égare un peu dans l'enculage de mouche même si elle nous sert quelques pistes de réflexion intéressantes.
Seconde lecture
Même si tout ce que j'ai dit plus haut reste globalement vrai, j'assimile (et accepte) mieux aujourd'hui les nécessités de condensation théâtrale. Du coup, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la lecture et cette pièce devient l'une de mes préférées, justement pour tous les non-dits qui forcent le lecteur/spectateur à imaginer le hors-champ et l'inconscient des personnages.