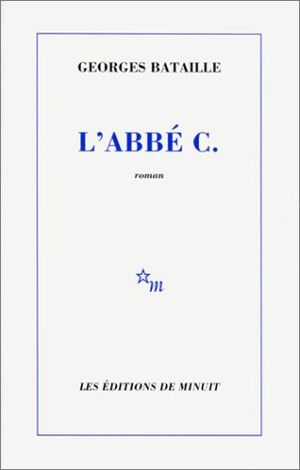L'Abbé C. est un récit à trois voix publié par Bataille peu après la guerre. Il met en scène, dans un télescopage de témoignages successifs, la fin de la relation entre un industriel, Charles C., et son frère jumeau, Robert, un prêtre, alors que les deux hommes entretiennent une forme de lien d'attraction répulsion avec la même femme, Eponine.
Cet ABC de Bataille, malgré sa singularité exhibée, est en fait assez représentatif d'une démarche littéraire qui aura fait les beaux jours de Minuit et des sémiologues au début des années 50. Le langage, d'où le titre à mon avis, crée un espace plus ou moins séparé du réel dans lequel une orgie de signes contradictoires et non figuratifs forment la toile pour le lecteur qui doit retrouver la clef de l'énigme codée – le roman met beaucoup en scène l'idée d'un mystère à percer derrière la gémellité perverse des C., au sens premier du terme (Bataille ne fait pas tant un roman sadien qu'un roman qui inverse et retourne constamment les valeurs), et de leurs actes en apparence peu explicables.
L'association de cette grande abstraction conceptuelle dans la manière que les personnages ont de projeter leur sentiment avec une imagerie bourgeoise assez éculée m'échappe pas mal. On peut vouloir voir énormément derrière ce que propose Bataille dans cette machine à brouiller, mais finalement on a tout de même affaire à la vieille histoire du curé qui enfourne, simplement rédigée de la manière la plus opaque du monde.
La folie solaire qui semble s'emparer de ces personnages de fiévreux perdus a tout de même quelque chose d'attractif, sur le plan purement poétique, mais cela fonctionne paradoxalement mieux dans les rapports qu'échangent le bref narrateur premier avec Charles C., en ouverture et en fermeture du roman, qu'avec le double, retourné mais identique, que doit former le jumeau.
J'ai peut-être l'esprit un peu paresseux en ce moment, mais le biscornu est-il si nécessaire ? Bof tout de même.