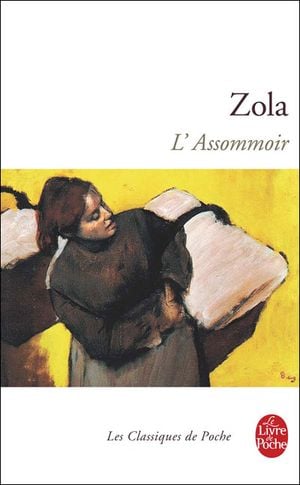Gervaise a quitté son Midi avec Auguste Lantier, un gredin qui décampe après avoir mangé toutes leurs économies. Elle se retrouve seule, dans un bouge près de la barrière Poissonnière, avec deux enfants, Etienne et Claude à nourrir. Elle devient blanchisseuse, et finit par céder aux avances de Coupeau, un zingueur. Le couple ne boit pas et économise, ils déménagent dans une petite maison dont il partage l'étage avec un honnête ouvrier de fonderie, Goujet. Ils arrivent à amasser 500 francs, et une petite, Nana, leur naît. Mais Coupeau fait une grave chute qui l'immobilise plusieurs mois, chute qui mange toutes leurs économies. Gervaise rêvait avec ces 500 francs de louer une boutique libérée pour lancer son affaire. Goujet, secrètement amoureux d'elle, les lui avance.
Gervaise s'installe rue de la Goutte d'or, en devanture d'un vaste immeuble où habitent la soeur de Coupeau et son époux, les Lorilleux, qui étouffent de rage en voyant sa réussite. La boutique marche bien, mais Coupeau, remis de ses blessures, n'a plus goût au travail et remplace le travail par la bibine. Gervaise joue la bonne patronne et se fait complaisante, elle organise un festin qui signe son apogée. Mais elle recroise Virginie, la soeur de la roulure qui lui avait piqué Lantier, et justement Lantier fait son retour dans le quartier, et contre toute attente devient cul et chemise avec Coupeau. Lantier, habillé comme un bourgeois, et qui donne l'illusion de l'entrepreneur, accepte lorsque le mari insiste pour le prendre comme locataire. Il devient un second maître de maison, et même le seul à mesure que la déchéance de Coupeau dans l'alcool se fait plus criante. Gervaise, de plus en plus hébétée, descend peu à peu vers le ruisseau. Elle contracte des dettes, cocufie son mari avec Lantier, perd ses clients car son travail est de moins en moins soigné, et doit renoncer à sa boutique, que récupère Virginie, qui ouvre à la place une boutique de confiserie où Lantier s'installe à demeure. Elle se replie donc dans une boîte à chaussure avec Nana, qui devient une petite roulure, et Coupeau, que l'alcool rend violent, puis fou. Elle fait même le ménage, humiliée, dans la boutique de Virginie. Leurs dernières possessions partent au Mont-de-Piété, Nana s'enfuit. Un soir, affamée, Gervaise essaie de se prostituer mais tombe sur Goujet, qui lui offre à manger. Elle assiste, dans un hôpital, aux derniers jours de Coupeau, atteint de délirium tremens et étudié par des médecins. Elle-même finit par prendre la place du père Bru dans un recoin de la cage d'escalier. Lorsqu'on retrouve son cadavre, le croque-mort, à côté duquel elle vivait, lui dit "Va, t'es heureuse. Fais dodo, ma belle !".
Je comprends que l'on s'énerve que ce livre ait fait partie des classiques qui traumatisaient les lycéens. C'est en effet un livre d'une violence sociale très dure, je pense qu'il n'y a que La terre qui soit allé aussi loin dans l'ordure.
On retrouve par moments le goût de Zola pour les descriptions de bâtiments à coloration impressionniste. Je pense à la description du lavoir où a lieu la rixe avec Virginie, aux descriptions initiale et finale de L'assommoir, ce bar où vont s'abrutir à l'alcool frelaté les ouvriers, qui sont ici présentés comme des victimes, qui s'animalisent de plus en plus. Mais aussi, dans les derniers chapitres, ces brèves incursions de Gervaise déchue dans le Paris haussmannien en train de sortir de terre, qui lui donne envie de fuir. Ha, et bien sûr la forge où travaille Goujet.
Pour autant, ce n'est pas le Zola le plus dépaysant, au contraire. Les recherches de l'auteur ont surtout porté, je pense, sur le langage des faubourgs, cet argot sensuel, parfois cru jusqu'à l'animalité, qui est l'environnement sonore naturel des personnages. En dehors de cela, le livre repose sur une idée simple, celle de la descente aux enfers ineluctable que suscitent l'alcool et l'abrutissement qui vous réduit à l'état d'estomac. Vision bourgeoise, abondamment partagée à l'époque, mais qui n'a rien de moralisante chez Zola, parfaitement conscient que la dangerosité du travail et la précarité de la paie sont une fatalité dont la société s'accommode trop facilement. Cela dit, l'ouvrage ne se centre pas sur le monde du travail proprement dit, comme dans Germinal, mais sur la rue, ou plutôt les pas de porte et les cours intérieures des logements ouvriers aux cages d'escalier tentaculaires.
Le livre comporte d'ailleurs beaucoup de passages en discours indirect libre. Zola reconstitue ces tirades de concierge médisante, de belle-soeur acariâtre, ces excuses d'ivrogne pour ne pas aller au travail aujourd'hui. Il donne autant qu'il le peut la parole à ces oubliés de l'histoire, et comme toujours c'est douloureusement crédible.
Et Zola va loin dans l'ordure. Saleté physique, avec les ruisseaux noirâtres des rues. Saleté morale, engendrée par la promiscuité, qui dénature les liens familiaux. Saleté verbale, qui enlaidit tout. On ne peut pas accuser l'auteur de s'y complaire, car comme souvent, c'est l'architecture narrative qui prime. Ici, cette architecture est celle d'un chemin de croix. Un chemin de croix dont Zola ne nous passe aucune station, et si l'on pouvait faire un reproche au livre, c'est d'avoir autant étiré l'agonie de Gervaise, qui dit elle-même, dans l'avant-dernier chapitre :
Ah non ! Par exemple, la misère ne tuait pas assez vite !
C'est exactement ce que pense le lecteur. Et bon, il y a quelques passages vraiment choquants. L'accouchement sur le paillasson, et le "Ce n'est rien. Elle se vide" dit en mangeant avec dans la salle à côté le cadavre suintant de Mme Coupeau mère.
Parmi les scènes marquantes, je veux retenir celle de la noce : comme il pleut, les ouvriers, tout intimidés, décident de se réfugier au Louvre et commencent par admirer les parquets. Idée qui pourrait être très niaise, traitée par un autre que Zola.
L'assommoir, c'est le coeur de la dénonciation de la misère dans l'oeuvre de Zola. C'est une oeuvre choquante, qui vous marque profondément. A côté, Les misérables de Hugo, c'est un suppo et au lit.