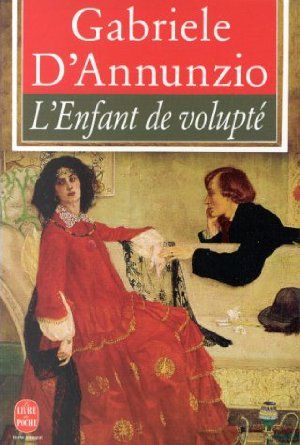Par quel miracle éditorial le titre original Il Piacere (Le plaisir) s’est-il transformé en L’enfant de volupté, je l’ignore. Ce titre de la version française est évidemment mauvais tant l’original est ironiquement bon : le Plaisir fort recherché ne sera jamais trouvé, ni avec les corps brûlants, ni véritablement avec l’art, une jouissance sourde tout au plus, peut-être, mais de Plaisir vrai(*), point.
Andrea Sperelli hésite entre vie contemplative et vie mondaine « il avait en lui quelque chose de Don Juan et de Chérubin » : il est un Des Esseintes en version romaine, et au contraire du personnage huysmansien, en version non avachie. Amateur praticien d’Art et de Femme, d’apparence bien vivante donc, Andrea Sperelli est un esthète radical et shooté aux hormones mâles dans l’ère du vide. Des palais Farnèse, du Quirinal et du Latran, aux villas Borghèse, Celimontana et Médicis, aux fontaines et aux églises (aux amoureux des atmosphère romaines je promets de sublimes immersions par D’Annunzio), Andrea Sperelli vit paradoxalement cloîtré dans son nihilisme fin de siècle, en proie à un décadentisme qui ne trouvera pas d’issue (pléonasme), ni dans l’Art, ni dans la Femme. Quatre livres, et autant de translations amoureuses vers la Femme et vers l’Art : d’abord vers la sensualité brute et l’érotisme - pour l’Art ça sera le tactile, l’immédiateté dionysiaque ; une deuxième vers le sentiment et le discours amoureux, la volonté de comprendre et de maitriser - pour l’Art ça sera l’intellectualisation, l’apollonien ; puis vers un télescopage douloureux des deux modes précédents et enfin la dernière tentation vers leur impossible synthèse : au bout du chemin il n’y aura rien qu’un néant de vacuité insondable.
Au-delà de la trame décadentiste un peu scolaire se dégage de cette lecture notre architecture humaine en bouillonnements et juxtapositions de volontés toutes vouées à l’échec puisque contradictoires et illusoires. D’Annunzio est même parfois tristement proche du « gag », notre nature n’atteignant sa vérité que dans le jeu des lumières diffuses et dans celui de l’abstraction des formes, qu’elle laisse planer en soupçons, mais jamais dans le fermement tenu.
Il Piacere est un roman (assez) érudit et décadent qui n’est pas sans rappeler le film éthéré de Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, film que j’ai eu à l’esprit, bien malgré moi, pendant toute la lecture. On pourra trouver - faites donc - le rapprochement tiré par les cheveux, mais c’est ainsi, la mondanité essoufflée, la déchéance, l’inaccessible beauté posées dans Il Piacere se voient en miroir dans La Grande Bellezza, à une autre époque : les bons romans sont de puissants évocateurs, au contraire de la mauvaise soupe généralement servie sur nos étals de boutiquiers contemporains. Les deux pièces, le roman comme le film, m’inspirent un retour à Rome, mais ça sera avec un regard cette fois sans doute différent, quand ça se fera. La littérature sert à ça.
Speculum voluptatis, Gabriele
(*) Si tant est que ce soit possible, il faudrait définir ce que serait un authentique plaisir : pas le courage de m’y coller.