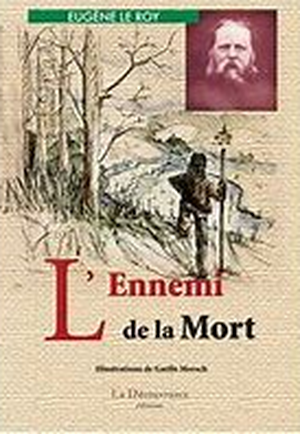Fervent républicain, Eugène Le Roy (1836-1907) a mis clairement ses idéaux dans le personnage de Daniel Charbonnière, héros de ce roman paru quelques années après sa mort: cet héritier des Lumières a une foi fervente dans l'éducation et le progrès. Revenu dans sa contrée natale au début de la Restauration, après des études de médecine, Daniel aimerait améliorer la vie des autochtones, notamment en faisant assécher les étangs responsables du paludisme qui cause des ravages chez les pauvres. Mais ce projet, loin de susciter l'intérêt, lui vaut au contraire méfiance et hostilité dans ce Périgord reculé où la Révolution n'a pas changé grand-chose. Paradoxalement, ce n'est pas qu'il soit athée (cela n'est jamais formulé mais est clair à la lecture) qui le rend spontanément suspect, mais ce sont ses origines protestantes.
Eugène Le Roy n'est pas tendre dans sa peinture d'une paysannerie dont la misère n'a d'égale que l'ignorance, profondément bornée, superstitieuse, suspicieuse, ingrate, cupide, parfois violente. Mais il est encore plus sévère avec les notables, qui, eux, n'ont pas l'excuse de l'ignorance: hautains et intouchables malgré leur médiocrité, ils se moquent que leurs paysans manquent de tout tant qu'ils peuvent mener leur train de vie et leurs intrigues mesquines, et continuer à trousser leurs chambrières ! Le Roy fait clairement de Daniel une figure christique: le docteur soigne gratuitement les pauvres, il est bon, courageux, généreux, désintéressé, dépourvu de rancune, mais il ne récolte en retour que médisance, mépris, méchanceté, bêtise satisfaite, bassesses, spoliations, injustices, jusqu'à devenir un véritable paria à cause d'individus semblant échappés de chez Maupassant ou Zola ! Rien ne lui est épargné, et le malheur frappe également ses rares proches.
On reste estomaqué en assistant à cette déchéance qui va de mal en pis: Eugène Le Roy, au soir de sa vie, était-il à ce point désabusé pour imaginer une destinée aussi triste pour un personnage aussi exemplaire ? Vous l'avez compris: ce roman, typique d'une époque où les luttes étaient encore réelles pour imposer la république et l'égalité, est nettement didactique et manichéen, et ce côté systématique est la faiblesse du livre. Heureusement, il a aussi bien des qualités qui font qu'il mérite encore d'être lu: ce texte a valeur de témoignage (pour sa description de la vie d'alors, mais également, comme nous l'avons déjà vu, pour le contexte de son élaboration); malgré sa noirceur, la lumière n'y est jamais totalement absente (Daniel reste toujours courageux et philosophe malgré le sort qui s'acharne); c'est un récit bien mené, vivant, souvent touchant; enfin, il y a cette belle langue, tenant parfois de la prose poétique et enrichie de mots du patois périgourdin (malheureusement pas traduits dans l'édition que je possède).