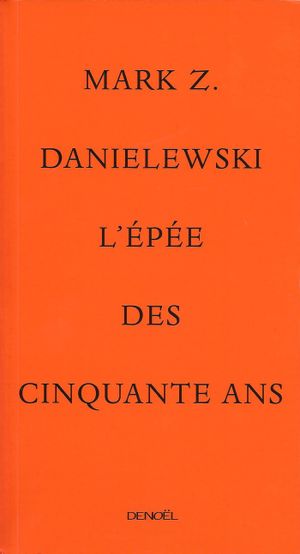S’il fallait résumer l’Épée des Cinquante Ans : une femme se rend à une fête, à laquelle est aussi conviée la nouvelle femme de son ex-mari. Plutôt que de rester à siroter sa haine et son cocktail, elle se rend dans la pièce des enfants – cinq orphelins, chaperonnés par une « Assistante Sociale » (?!). Un conteur, porteur d’une valise à cinq fermoirs, apparaît alors, qui raconte l’aventure dont il fut autrefois le héros. Le tout en trois cents pages, dont une moitié est blanche ou presque, et un certain nombre ne porte que quelques mots. (À ce propos, une remarque sur les critiques que j’ai lues çà et là et qui déploraient cette forme, allant parfois jusqu’à parler d’escroquerie. D’une part, ce n’est pas la longueur qui importe ; qu’un texte compte quatorze vers ou trois mille pages n’influe théoriquement en rien sur sa richesse : si 2666 de Bolaño est meilleur ou moins bon que « L’Horloge » de Baudelaire, ce n’est pas *parce qu’*il est plus long. D’autre part – et chez Danielewski c’est encore plus vrai, s’agissant d’une littérature aux frontières des arts graphiques –, reprocher à un auteur une mise en page parcimonieuse reviendrait à reprocher à un peintre une toile trop grande ou trop petite. Or le format fait partie de l’œuvre. (Le prix de vente, non, certes, mais c’est un autre débat. Bref.))
Puisque aussi la comparaison semble inévitable, la Maison des feuilles et l’Épée des Cinquante Ans exploitent toutes deux un goût du paradoxe (moins foncier certes dans l’Épée…) : à la maison « plus grande dedans que dehors » du premier récit fait écho cette « ombre projetée par rien “si ce n’est “les ténèbres elles-mêmes » (p. 64) du deuxième. Dans les deux textes aussi, les – excellents – traducteurs (respectivement Claro et Héloïse Esquié) et les typographes ont dû s’amuser. Il y a indéniablement une patte Danielewski – j’attends de lire Ô révolutions.
On notera aussi que si la Maison des feuilles collait un coquard au cinéma et passait à tabac la littérature de science-fiction, dans l’Épée des Cinquante Ans c’est la littérature pour enfants qui encaisse les coups. Mettons qu’il existe plusieurs types de « livres pour enfants ». Certains s’adressent à tous leurs lecteurs adultes aussi bien qu’enfants, avec une possibilité de varier et d’approfondir plus ou moins l’analyse : c’est le cas des contes de Perrault, Grimm, Andersen, de Peter Pan ou de Pinocchio. D’autres parlent aux enfants en les considérant comme des adultes en miniature : par exemple Alice au Pays des Merveilles. D’autres, à l’inverse, s’adressent à la part enfantine des lecteurs adultes : Harry Potter, le Monde de Narnia, etc. Quant au livre de Danielewski, il semble clairement se placer ailleurs – hors de portée des enfants ? des adultes ? – alors qu’il reprend la plupart des codes des « livres pour enfants » : univers merveilleux, quête initiatique, récurrence d’une structure ternaire, illustrations – par ailleurs soignées… Seulement, l’écriture de l’Épée des Cinquante Ans tend clairement vers la poésie en prose : allez faire goûter de la poésie en prose à un gosse !
Mais ce qui m’a le plus marqué dans l’Épée des Cinquante Ans, c’est la manipulation. Un passage du récit oblige le lecteur à tourner le livre dans le sens de la largeur pendant quelques pages, et ainsi à se mettre dans la peau des personnages qui défont un à un les fermoirs d’une valise. Le passage se termine par une double page noire. Et quand la lecture reprend dans le sens normal, c’est une protestation des personnages : « Hé ! […] C’est vide ! » (p. 236). Bien sûr que c’est vide, cher lecteur ! À quoi est-ce que tu t’attendais ? Tu pensais qu’un vrai conteur fantôme allait sortir de la reliure ? Tu t’es cru comme dans Jumanji, avec les rhinocéros ?… Hé bien… pour ma part… oui… – ça ne m’aurait pas étonné que quelque chose de merveilleux se produisît. Peu importe qu’on impute ceci au talent de Danielewski ou au pouvoir de la fiction.