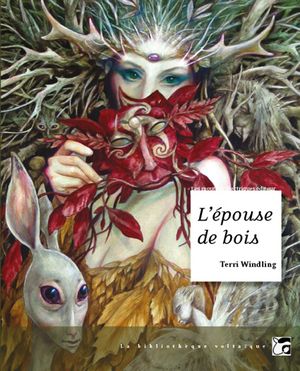L’épouse de bois laisse et ne laisse pas une impression mitigée. Non que l’ensemble soit uniformément tiède, sinon que le merveilleux, dans tous les sens du terme, côtoie la fadeur – en minorité, heureusement.
Mais revenons en arrière. Le livre a souffert de sa réputation de perfection qu’il s’est déjà forgé sur SensCritique. À peine l’a-t-on ouvert que les soixante premières pages au moins se révèlent pénibles, terriblement banales, et parviennent difficilement à éveiller l’intérêt. À ce moment, je me suis demandé si j’avais des goûts à ce point opposés à certains de mes éclaireurs, par ailleurs régulièrement très éclairés, et j’ai persévéré.
La suite monte doucement en puissance ; or, je ne parviens pas encore à déterminer si c’est trop doucement ou juste ce qu’il faut – je m’explique plus loin. Le style, au début moyennement inspiré, se pare de plus en plus souvent d’atours affriolants ; la structure gagne en intérêt ; le récit s’aventure de plus en plus au creux des possibles ; chaque personnage s’emmitoufle dans de belles épaisseurs. Bref, le lecteur s’amuse de plus en plus – et Terri Windling sans doute aussi.
Enfin, la moitié du roman dépassée depuis peu, le voilà qui explose, qui peint à grands coups de couleurs vives, qui pétille d’inventivité, qui se met au diapason des poètes qui le peuplent, qui expose véritablement toute sa puissance et la toute-puissance de son monde. Il aura fallu deux cents cinquante pages pour en arriver là, mais l’intensité ainsi obtenue ne s’effiloche pas, seulement battue en brèche dans le dispensable chapitre onze.
Le rythme du récit, l’évolution des images, comme le style de l’écriture apparaissent donc à première vue inégaux. Pourtant, ils évoluent tous ensemble. Il n’y a pas de hasard : ils reflètent l’existence de Maggie, l’héroïne. Au début poétesse repentie, à la vie hagarde, habitant Los Angeles, seule en ne parvenant pas vraiment à oublier un ex envahissant, elle s’exile dans les montagnes désertiques de Tucson, où un poète qu’elle admirait et avec qui elle entretenait une correspondance lui a légué sa maison après avoir disparu dans des circonstances pour le moins louches. Peu à peu, la voilà qui abandonne les certitudes de la ville et se laisse pénétrer par la poésie des monts Rincons – et voilà que Terri Windling enlève style et récit (c’est le bon moment, il me semble, pour féliciter le traducteur Stéphan Lambadaris, même si je serais curieux de voir la version originale). La maîtrise est donc indéniable, mais je suis bien obligé de lui imputer mon manque d’amusement initial.
Tout au long du bouquin, et entre autres sujets, Windling soulève régulièrement trois thèmes forts.
L’écologie évidemment, alors que la nature, cette formidable nature dans laquelle le roman plante toutes ses racines et qui permet la résurrection de Maggie, se fait dévorer par les promoteurs immobiliers année après année ; alors que les emblématiques coyotes sont pourchassés comme des nuisances, haïs pour ce qu’ils ne sont pas par des associations et un gouvernement cyniques – une vengeance inique et sans cause, provoquant par ailleurs de nombreuses victimes collatérales. Cette sensibilité écologique est le fondement de l’œuvre, son socle, son liant, son identité, son message et son cri.
L’art sous toutes ses formes, ensuite : au sein du roman, poésie, peinture et musique notamment se font caresser avec amour derrière les oreilles, abandonnant encore quelques lignes à la sculpture et à ce qu’on pourrait appeler des arts sous-estimés, que certains personnages ne considèrent pas comme tels au grand dam de Maggie. L’épouse de bois rétablit cette vérité : c’est la vie qui est art.
Une forme de féminisme enfin, quoique de façon plus ténue, notamment quand il est question d’Anna Naverra, peintre de génie et épouse du poète mort.
Au terme de cette critique, je pourrais aisément considérer que l’œuvre frôle cette perfection que plusieurs éclaireurs me promettaient. Mais si je ne peux tout à fait le nier en restant objectif, la subjectivité qu’impose toute lecture a raison de ce jugement : j’aurais aimé prendre mon pied dès le début.
(En revanche, je distribue un énorme carton rouge à Orbit books. L’édition de poche est truffée de fautes grosses comme un soleil que je n’avais encore jamais vues dans un livre.)