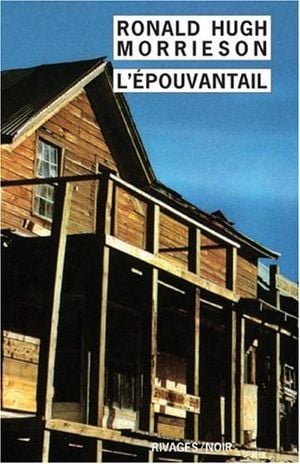« J’espère ne pas être l’un de ces bougres que l’on découvre après
leur mort. »
Ronald Hugh Morrieson ne fait pas partie des auteurs dont le nom brille au firmament de la littérature mondiale. On peut même parier, sans grand risque, qu’il reste un inconnu, y compris dans le milieu du roman policier.
Né en Nouvelle-Zélande en 1922 et mort en 1972, le bonhomme n’a pratiquement jamais quitté la petite ville de Hawera sur l’île du Nord. Écrivain sur le tard, à 37 ans, il travaille sur un premier manuscrit oscillant entre récit policier et étude de mœurs dans une petite communauté néo-zélandaise. Publié, le livre connaît un grand succès en Australie. Cependant, il est boudé dans son propre pays. Il faut dire que Morrieson n’est pas très tendre avec ses compatriotes.
Fort de ce succès, l’auteur publie un second titre, Came on Friday, une nouvelle fois bien accueilli par la critique. Morrieson profite alors du peu notoriété dont il jouit pour assister à un congrès d’écrivains et recevoir quelques compliments de ses pairs. Mais, les nuages s’accumulent au-dessus de sa caboche. Sa mère meurt et ses deux manuscrits suivants sont refusés. Déjà porté sur la boisson, il s’enfonce davantage dans l’alcoolisme, effectuant plusieurs séjours à l’hôpital. Il finit par mourir en 1972.
Auteur de quatre romans, dont deux parus à titre posthume, Morrieson attire l’attention du cinéma après son décès. L’Épouvantail est adapté, avec John Carradine, de même que Came on Friday et Pallet on the Floor. Morrieson rejoint ainsi la longue liste des écrivains redécouverts après leur mort.
« C’est au cours de la même semaine que nos poules furent volées et
que Daphné Moran eut la gorge tranchée. »
Roman à l’ambiance rustique, L’Épouvantail s’apparente au polar rural américain. L’époque, les années 1930, n’est évidemment pas pour rien dans cette impression.
Narrée par un témoin de l’affaire, encore enfant au moment des événements, l’histoire prend la forme d’un compte-rendu, volontiers exhaustif, mais dont l’auteur s’excuse par avance d’avoir dû combler les lacunes à l’aide de son imagination et des on-dits.
Là encore, le procédé rappelle le meilleur de la littérature américaine. On pense à Joe R. Lansdale, à Harper Lee, à Charles Williams et bien d’autres… De fait, Morrieson lorgne un tantinet du côté du roman d’apprentissage. Toutefois, le récit semble relever davantage de l’étude de mœurs, voire de la chronique, celles des habitants de Klynham, ville de province où habite le narrateur Neddy, aka Edward Clifton Pointdexter, membre d’une famille de bons à rien, selon ses dires.
Que dire Klynham ? Si cette paisible bourgade n’est pas le trou du cul de la Nouvelle-Zélande, ses apparences ont de quoi leurrer le proctologue le plus avisé. Une grand-rue parcourue par quelques canassons se déplaçant clopin-clopant, un éclairage réduit à la portion congrue attirant des papillons gros comme des chauves-souris. La communauté ne brille guère pour son importance aux yeux de Ned. C’est pourtant la ville natale de sa famille, les Pointdexter, dont la réputation de traîne-savates et d’alcooliques semble faire l’unanimité.
L’oncle de Neddy, Athol, argue d’un prétendu handicap pour ne faire aucune des activités attendues de la part d’un homme honnête. Il passe ses journées à se saouler avec le croque-mort, seul notable encore prospère dans le patelin malgré la dépression économique. Son père, Daniel Herbert Poindexter, récupère des vieilleries pour les revendre. Plus souvent en train de cuver son alcool ou de réparer la guimbarde lui servant pour ses tournées, il a eu bien du mal à effacer l’inscription transformant les initiales de son prénom en Dépotoir Hétéroclite Pointdexter sur le hangar où sont stockées ses trouvailles. Heureusement, Ned peut compter sur sa mère, maîtresse femme, et sur sa sœur aînée de 16 ans, Prudence, que tous à Klynham et ailleurs, couvent du regard. Sur ce dernier point, Ned lui-même n’est pas très à l’aise. Plus d’une fois, il s’est surpris à la reluquer en douce, imaginant des activités moites en sa compagnie. Heureusement, il a le béguin pour Joséphine McClinton, en particulier pour ses mollets nus qu’il aperçoit régulièrement lorsqu’elle pousse sur les pédales de sa bicyclette pour se rendre à sa leçon de piano.
La vie de Ned aurait pu s’écouler tranquillement, entre coups fourrés avec son copain Les, virée au ciné, pour y voir les films d’aventures de Tom Mix ou Dolores Del Rio, et longues promenades à vélo par monts et par vaux. Ce serait oublier la voyoucratie adolescente de Klynham, dignement représentée par la bande de Lynch, avec laquelle Ned s’est mis dans de sales draps. Et puis, il y a ce type, cet étranger au visage de gargouille, tout en jambe et en bras, se baladant avec un long couteau dans la poche. Le bougre n’hésite pas à le sortir pour faire des tours impressionnants, genre le mettre dans son gosier et le ressortir aussi sec. Ned n’est pas très rassuré de le voir s’acoquiner avec l’oncle Athol car il a dans les yeux quelque chose d’inquiétant.
Sur fond de chronique, de crime et d’enquête policière, Morrieson nous dépeint une petite ville peuplée d’habitants au moins aussi excentriques qu’attachants. Convoquant le ban et l’arrière-ban de ses compatriotes, il dresse un portrait grinçant de la Nouvelle-Zélande des années 1930. Avec nonchalance, un humour ravageur et une finesse incontestable, il prend son temps, tissant sa toile pour mieux envoûter le lecteur.
D’une plume à la gouaille généreuse, il fait se côtoyer le grotesque et l’horreur pure, le drame et un humour truculent, sans jamais se départir d’un brin de roublardise. Certes, L’Épouvantail ne brille pas pour son rythme échevelé ou son suspense haletant. Il ne souffre pas toutefois de ces personnages stéréotypés et lisses que l’on retrouve trop souvent, ni de l’application besogneuse des mêmes recettes, ressassées ad nauseam par bon nombre de faiseurs de best sellers.
Bref, il enchante, effraie et émerveille. Trois qualités précieuses et recherchées chez un conteur.
Source