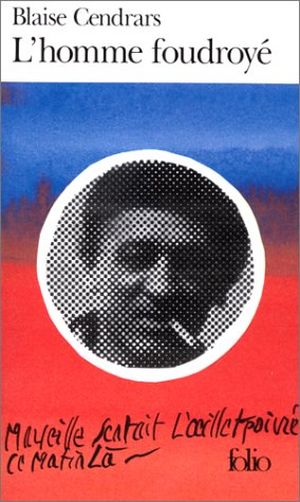L’Homme Foudroyé de Cendrars est une œuvre aux ambitions complexes. C'est en effet le premier volume d'une tétralogie de « Mémoires qui sont des Mémoires sans être des Mémoires », dixit l'auteur. Dans Sous le signe de François Villon, il précise : « Si je parle beaucoup de moi, croyez-le, c'est pour pénétrer le plus avant possible dans la conscience du poète, ce miroir magique et la seule représentation du monde, des hommes et de l'univers. Il ne s'agit donc pas seulement de moi dans ce "Je". »
Blaise Cendrars représente souvent le monde comme explosant littéralement sous sa plume, pour reprendre vie ensuite. La pensée aurait cet effet de transformation du monde à l’image du poète, donnant à celui-ci quelques caractéristiques de l’ordre du démiurge. Le monde devient littéralement ce que l’imaginaire en fait…
Nous allons voir que le démiurge, en vérité, est dans L’homme foudroyé pris au piège de sa propre création, car celle-ci s’incarne au même niveau de réalité que lui, et il s’y retrouve selon les circonstances soit plongé soit confronté, en général les deux à la fois.
L’homme foudroyé est un roman qui pénètre assurément dans la conscience du poète, au moyen d’un ensemble de récits parfois fantastiques, aux frontières du vraisemblable, où l’imaginaire fait toujours concurrence au réel et à la posture autobiographique.
L’IMAGINAIRE EN TENSION AVEC LE RÉEL
En effet, pénétrer dans la conscience du poète n'est pas une mince affaire, car c’est une conscience qui « va vite », nous dit Cendrars, c'est une pensée qui se condense, qui travaille le réel d'abord, le décompose, puis frappe soudain comme l'éclair pour tout reconstruire. Cette image de la pensée s'apparente à l'électrolyse, dans sa manière électrique de transformer la matière. Et l’adjectif foudroyé du titre, qui pouvait déjà prendre diverses significations au sein de l’œuvre (foudroyé par la guerre, foudroyé par l'amour, foudroyé par Dieu…) admet une nouvelle interprétation, celle de l'homme devenu foudre.
« à quoi peut-on comparer la vitesse sinon à la poussée lente de la pensée qui progresse sur un plan métaphysique, pénétrant, isolant, analysant, décomposant tout, réduisant le monde à un petit tas de cendres aérodynamisées (les angles s’usent au vent de l’esprit !) et reconstruisant magiquement l’univers par une formule fulgurante qui claque entre deux guillemets (comme on bat un record entre deux mises au point), cette illumination qui redonne vie : Le monde est ma représentation. » HF, p446
Et cela arrive régulièrement chez Cendrars, que la pensée du poète se manifeste sur le monde comme quelque chose qui claque, comme une détonation.
D'où une tension forte, et fondamentale chez Cendrars, entre l’imaginaire et le réel.
Parce que la force de cette déconstruction-reconstruction, cette opération ultime et déjà en soit invraisemblable d’électrolyse explosive, permet une reconstruction qui obéira en partie à l’imaginaire du poète. Le monde devient sa représentation, et cela se traduit de bien des manières, mais déjà par un dépassement des contraintes spatio-temporels.
Lorsque Blaise Cendrars parle de cette opération de la pensée, il s’imagine sur une route imaginaire qu’il appelle N10 :
« ce qu’il y a d’admirable dans l’automobile, et ce que ne donne pas l’avion, c’est que la route, aussi triomphale soit-elle, ne s’écarte pas des hommes, se faufile au milieu d’eux, relie leurs villes à leurs villages, et que la N 10 en particulier, de Notre-Dame au Paraguay, d’un bout à l’autre ne cesse pas d’être quotidienne, c’est-à-dire utile, pratique, terre à terre, encombrée d’obstacles et pleine d’imprévus. La grâce de la vitesse. Je passais. » HF, p. 447
Ce passage contient un bel exemple de la tension imaginaire/réel chez Blaise Cendrars. Il y revendique un rapport terre à terre au monde, tout en s’affranchissant des contraintes du réel, notamment ici de l’espace. Dans le nouveau monde qu’il nous présente, il peut exister une route qui relie Notre-Dame au Paraguay, une route dont le poète cherche cela dit à nous faire accepter toute la réalité.
Imaginaire et réel doivent se côtoyer de manière ambiguë, comme le mouvement doit côtoyer ce qui est statique, pour donner l'impression de vitesse. L’imaginaire du poète ne peut être « vite » qu'au contact du plancher des vaches, ou des éléments du ciel, et régulièrement l’œuvre de Blaise Cendrars nous rappelle la vanité d’être poète en cabine fermée.
« Interrogez un aviateur qui plafonne quotidiennement à 4000 m d’altitude et demandez-lui ce que ça sent là-haut ? Indubitablement il vous répondra que cela ne sent rien du tout. Et si vous insistez, il ajoutera, dégoûté : "Ça sent l’essence !" et il haussera les épaules. Jamais il ne vous dira comme le fera le moindre guide, le moindre porteur de la vallée de Chamonix, qui fréquente les mêmes altitudes que l’homme-oiseau (tous les chasseurs ont du nez) : "Là-haut ? Mais ça sent l'ozone." […]
C’est exact, cela sent l'ozone, c’est-à-dire la foudre, comme j’ai pu le contrôler au sommet du Mont-Blanc. » HF, p.58
L’odorat est un sens qui donne des effets de réel, un sens à travers lequel on peut donner des détails singuliers sur le monde, donner un effet de matière,
« Marseille sentait l’oseille poivrée ce matin-là »
Tout en étant un sens qui peut sembler construit sur l'imaginaire.
Cendrars invoque ici l’odorat pour créer cet effet de réel, tout en disant deux pages avant : « Je me suis souvent demandé quelle est la part de l’imagination dans la définition d’un parfum, et les industriels de la parfumerie d’aujourd’hui ont dû se poser la même question à en juger par l’habillage, le flaconnage dont ils parent leurs produits et les étiquettes suggestives, je dirais même mallarméennes, dont ils les nomment. »
Et on est en droit de se demander, par exemple, si Blaise Cendrars est vraiment monté au sommet du Mont-Blanc, et par là même de se demander s’il y a de la vérité dans ce qu’il dit sur l’odeur d’ozone que l’on y trouve.
Différentes manières de mentir, par ailleurs, chez Blaise Cendrars :
_prochronie (des événements peuvent en influencer d’autres qui leur sont chronologiquement antérieures),
_références nombreuses à des textes dont on peut douter de l'existence (« emprunt sans preuve, citation à vide, trace de lecture inconnue… » nous dit Claude Leroy),
_allusions à des voyages qu'il n'a jamais fait,
_etc…))
Et il appuie généralement l’effet de réel, pour convaincre, en usant de notes en bas de page qui se donnent des airs de documentation.
À un tel niveau d’application, on ne peut plus vraiment parler de mensonge, mais plutôt d’invention. Le poète assume le pouvoir et l'ambition de donner l’aspect de la vérité à son imaginaire.
À la page 62, Cendrars retranscrit la IIIe leçon de l’office composé pour la fête de l’invention de sainte Madeleine :
« Sa langue, cet organe de la vérité, surpasse le Liban par sa feuille, sa fleur, son fruit, et la verdeur (qui y paraît) est (comme) la plume du Saint-Esprit.
Dichtung und Warheit, écrivait Goethe.
Le rêve et la vie, répondait Gérard de Nerval »
On peut douter de l’existence même de cette leçon, bien entendu.
On voit comme il joue avec les parenthèses sur le ressenti et la comparaison pour ne laisser finalement que le péremptoire verbe être. Ce qu’il y a sur la langue ne propose plus seulement une interprétation, ce qu’il y a sur la langue « est ». Ce qui « parait » est. Ce que le poète a dans la tête dépasse même le réel.
On va voir maintenant que Cendrars multiplie dans son œuvre les personnages artiste, et si les poètes possèdent des pouvoirs d'incarnation, chacun risque d'être confronté à sa propre création, qui va s'incarner au même niveau de réalité que lui et potentiellement l'absorber, le posséder, le démasquer, ou du moins le confronter.
LES FABLES MÉTALLITÉRAIRES : L' « HOMME DEVENU FOUDRE » FOUDROYÉ
Cette propension de l'imaginaire à envahir une réalité prétendument autobiographique va amener le double Blaise Cendrars à interagir directement avec cette imaginaire. Des personnages vont apparaître autour du poète Blaise Cendrars, ou autour d'autres personnages poètes, dans des circonstances parfois invraisemblables, et donner l'impression de pouvoir posséder le poète, ou de le percer à jour, ou inversement de dépendre fortement de lui.
On obtient alors des scènes complexes où les personnages gravitent les uns autour des autres dans ce qui semble être des chorégraphies métalliteraires, où entre en jeu des relations d'aliénation, proches parfois de la possession ou de la destruction.
Il y a un passage dans l’œuvre, celui de l’abécédaire de Paquita, qui vient de manière énigmatique expliciter ces mécanismes.
Mais je trouve qu’il serait intéressant que je vous parle d’abord de deux fables, celle de Gustave Lerouge dans le détail, et celle du Vieux-Port de manière survolée, pour vous montrer de manière déjà littérale les mécanismes qui se mettent en place, pour que le passage « explicatif » fasse, ensuite, un minimum sens..
Les deux histoires dans cet ordre sont intéressantes, car si l’histoire de Gustave Le Rouge, la première, raconte l’histoire d’un piège fantastique qui se referme, la seconde, celle du Vieux-Port, présente aussi la tentative de Cendrars d’en réchapper.
Je rappelle tout de même que, si je suis obligé pour la compréhension des fables d’explorer un minimum ce qu’on pourrait appeler la conscience du poète, ce qui m’intéresse surtout c’est les mécanismes et les motifs narratifs qui permettent cette exploration.
LA FABLE DE GUSTAVE LEROUGE
Blaise Cendrars nous présente son ami écrivain Gustave Lerouge. Quelqu’un de doué dans son art qui a notamment écrit un grand « roman d’aventure scientifico-policière », un écrivain qui refuse de signer les chefs d'œuvre qu'il écrit, qui refuse les rémunérations trop importantes, qui se défend des compliments, ou des propositions d’adaptations cinématographiques que lui fait Blaise Cendrars, qui refuse même qu’on le qualifie de poète, jusqu’à s’arranger pour « ne pas faire style, dire des faits, des faits, rien que des faits », comme s'il voulait « châtrer le verbe » nous dit Blaise Cendrars. Cendrars associe cette timidité maladive à un orgueil monstrueux (P244), qui motive autant son écriture dans un désir de reconnaissance (il a quand même l’ambition d’entrer dans Les Nouvelles littéraires, p253) que cette humilité de provocation jusqu’à la destruction de soi.
« Mystère de l’homme, aberration de l’homme de lettres, cet homme de génie que la timidité rendait humble avait le génie féroce de la destruction, de la destruction de soi qu’il poussait jusqu’au sadisme dans sa vie privée. » P249
Cette phrase annonce une mise en abyme à venir, la confrontation du poète à son propre imaginaire littéraire, puisque l’on comprend là que son sadisme envers sa poésie compose aussi le lieu de sa vie privée. La mise en abîme : mécanisme essentiel de la fable métalittéraire, mécanisme intempestif (qui surgit de manière surprenante).
Autre annonce du caractère intempestif de cet imaginaire, Cendrars nous dit P249 : « Mais avant de revenir à ce chapitre si curieux pour la psychologie de l’écrivain sur les artifices qu’il employait pour se mettre en transe et écrire, je voudrais raconter dans quelles circonstances mélodramatiques, et surtout bouffonnes, je fis la connaissance de cet homme ». Or, le chapitre de cette première rencontre va constituer le reste du récit, et se confond donc avec la suite annoncée du chapitre « si curieux pour la psychologie de l’écrivain ». Les deux ambitions, celle d’un chapitre mélodramatique et celle d’un chapitre psychologique vont se confondre jusqu'à un climax de dispute conjugale, la conscience du poète et la réalité du roman vont se superposer en partie, en une fable métalittéraire qui commence avec le chapitre qui s'appelle « Un chinois ! ».
Première mise en abyme effective, en effet, lorsque un ami de Blaise Cendrars, le Père François, embarque notre héros en voiture dans une course folle pour aller réclamer de l’argent au chinois.
« Un chinois ! Justement paraissait le dernier roman à épisodes de Gustave Lerouge : Sië-Thao ou La Fille du pêcheur de perles du Fleuve Bleu, la plus délicieuse chinoiserie et la plus truculente shanghaïerie qu’il m’ait été donné de lire sur une idylle exotique et les aventures des trafiquants d’opium. » P276
La mise en abîme s'accentue, lorsque l’on découvre, après avoir déjà échangé quelques coups de fouets, que le chinois… : « Ce chinois à qui nous devions casser la figure pour je ne sais quelle motif – obscure jalousie du Père François, litige de mitoyenneté ou simple lubie d’ivrogne - n’était personne d’autre que Gustave Le Rouge » P274
À savoir que cette confusion du père François, qui croyait partir s’attaquer à un chinois, est tout à fait invraisemblable, qu’elle ne tient qu'au chapeau que porte sur le moment Gustave Lerouge. Or de quelle manière comptaient-ils casser la figure au chinois ? En le fouettant, de la même manière que Lerouge semble sadique envers sa propre littérature. Dans la fable littéraire, la mise en abyme, bien sûr, fait sens.
Alors Lerouge intercepte le fouet, et leur explique comment il faut l'utiliser. Puis il les invite chez lui, et Blaise Cendrars nous présente la femme de Lerouge qui possède une balafre, une trace de fouet que lui a un jour infligé son mari. « Amour et Littérature », nous dit Cendrars. Manière d’expliciter ce qui est en jeu, la relation de l’écrivain au désir.
Entrons plus en détail dans la description du couple qui se termine par ce fameux « Amour et littérature ». Nous assistons à ce qui semble être une véritable scène de transe autant qu'une scène de dispute, où semble se jouer un amalgame des désirs (sentimentaux, littéraires…) : « Mystère des couples. Incantation et hypnotisme, qu'est-ce qui les tient, les unit, les confond, les rive l'un à l'autre ces deux damnés solitaires qui ne peuvent procréer que monstres : ses livres, à lui et à elle, ses scandales ; les uns et les autres n'étant que débordements de l’imagination d’un homme de lettres ou du derrière d’une écuyère ; lui, l’intellectuel, s’évertuant diaboliquement à glacer sa frénésie de femme fatale, et, elle, la sensuelle, avec une malice satanique, tâchant d’assouvir l’homme par le prestige de ses perversités de vieilles rouée expérimentée. Il y avait également une question de race entre eux. Mais qui était dupe de l’autre, ou victime, ou bourreau, et lequel des deux entrainait l’autre, posait pour lui et trompait ? Amour et littérature. »… P281
Le fouet dans ce récit est une déclinaison d’un motif important dans tout L'homme foudroyé, et dont nous avons déjà parlé : c’est le motif du foudroiement, qui peut prendre diverses formes et un vaste champ d’interprétation et sur lequel il est intéressant je pense de s’arrêter.
Il faut retenir que cette scène, comme annoncée, s’intéresse à un processus très curieux pour la psychologie du poète, à celui de la transe et au sein d'elle à l'acte d'écriture. Il y a une association inévitable chez Lerouge entre l’acte d’écriture qui « claque entre deux guillemets » et l'utilisation du fouet ; entre l'acte d'écriture en général chez Cendrars et divers actes qui claquent, ou qui brûlent, qui en général semblent porter atteinte à l’intégrité du réel, et notamment à l'intégrité physique des personnages.
Si l’on veut réduire la scène de la dispute conjugale à une psychologie générale du poète, admettons pour l'occasion le mécanisme suivant : l’acte de sublimation sous le jour de la libido
(à contre-courant de Cendrars lui-même qui nous dit page 190 : « Voyez l’exemple du Christ qui vit dans la mort et qui défie toute la charlatanerie de la confusion et des refoulements. Car le Christ c’est l’AMOUR et non la libido. Il a triomphé de SATAN. »
Jouons à satan alors, parlons de la libido du poète.
=> L’homme serait chargé de désirs qui menacent d'être douloureux d’être mal assouvis, et l’homme trouve dans une pratique personnelle, notamment artistique, le moyen d’assouvir ce désir de manière détournée, éventuellement plus abordable et plus durable.
En théorie, car en pratique, il est possible que l’artiste se retrouve à devoir répéter l’acte de sublimation pour contenir le désir qui revient.
C'est donc une psychomachie qui est en jeu dans cette dispute conjugale, une bataille mentale entre les diverses forces qui animent la conscience du poète,
une bataille entre le désir et l'esprit ; le désir qui inspire l’esprit littéraire, et l'esprit littéraire qui, inspiré par le désir, fait chez Lerouge acte contre le désir, dans une perspective de sublimation austère suite à laquelle il espère garder le désir sous contrôle.
Le fouet ici conditionne le rapport de Lerouge à sa femme, mais c’est aussi un motif du foudroiement caractéristiques de ce personnage écrivain, en lien avec la posture sadique qu'il a envers son écriture, avec sa manière dans l’écriture de « châtrer » le verbe.
Posture sadique mais "délicate", un autre motif de foudroiement est sa manière appliquée de transformer les lis en fleurs noirs : « l’homme allait de fleurs en fleurs, se penchait sur chaque lis armé d’une grosse loupe à manche, puis avec un doigté délicat et beaucoup, beaucoup de dextérité il injectait à la base de chaque calice à l’aide d’une seringue Pravaz un liquide incolore qu’il puisait dans de petites ampoules décapitées au fur et à mesure qu’il se déplaçait le long de la rangée de lys virginaux et, immédiatement, chaque calice devenait d’un bleu intense pour, au bout d’un moment, tourner au noir. » P270
On remarque donc que divers motifs du foudroiement peut venir caractériser une même pratique littéraire.
La femme de Lerouge, quand à elle, donne les signes de ce qui le pousse à écrire : orgueil, avidité, désir de reconnaissance, le goût du scandale… Mais aussitôt on pourrait élargir à la passe d’armes entre le Père François et Lerouge, à cette confrontation en vérité de deux orgueils de deux écrivains, Cendrars et Lerouge, qui se fouettent mutuellement dans la manière respective qu'a chacun de défendre sa propre pratique littéraire contre celle de l'autre.
Si on accepte de voir le Père François comme un double de Cendrars, ne voit-on pas que, si le fouet sert à Lerouge dans sa littérature pour canaliser son propre désir de reconnaissance et son goût du scandale, le fouet sert à Cendrars, de son coté, à « châtrer » la pratique de Lerouge (notamment lorsqu’il découpe des bouts de texte de Lerouge pour leur donner une valeur poétique et pour prouver à Lerouge que celui-ci a un véritable talent de poète) ?
((artifice réellement publié dans Kodak
https://remue.net/010-Cendrars-Blaise-Documentaire))
Cendrars plus largement, selon sa conception du foudroiement, peut-il faire autrement que de mutiler les poètes dont il décide d’explorer la conscience, la sienne y compris, comme il foudroie tout ce qui passe sous sa plume ?
« C’est tout juste si les cendres que je remue contiennent des décristallisations de l’image (réduite ou synthétique ?) des êtres vivants et impurs qu’elles ont constituée avant l’intervention de la flamme. […] Regardez comme ils vivaient. Je vais tâcher de les faire revivre pour vous. J’écris. Lisez. Je ne puis faire plus. Je n’en sais pas plus. Et, moi-même, je suis foudroyé. » HF, P. 277
Il n'est pas surprenant alors que dans une fable où il aborde le motif du foudroiement sous l’aspect du fouet, il se retrouve à un moment avec le fouet dans la main… Lorsqu'un poète écrit sur les poètes, il n’est pas étonnant que des effets de mises en abyme et de coïncidences s’installent.
Voilà ce que j'avais à dire pour cette fable. Mon idée ici est moins de discuter le caractère sadique de l’acte poétique de Lerouge, que de montrer les différents mécanismes et motifs en jeu dans les fables de Cendrars, qui permettent de pénétrer dans la conscience du poète. Le motif du fouet représente un mode particulier de foudroiement, il y en a d’autres. D'autres moments dans L'homme foudroyé où l’intégrité du décor ou d’un personnage semble menacée ou déjà compromise. Il est intéressant alors, dans ces moments, de chercher quelque part un ou une artiste ou un double de l'artiste (souvent l’artiste dans ce roman est un homme, lui-même mutilé, ou physiquement déformé, car le poète se foudroie avec le reste) à l’origine probable du dégât ou du danger, et se poser des questions sur ses objets de désir, et son rapport à ces objets de désir, pour distinguer un éventuel et approximatif squelette de la fable, pour pénétrer à terme de manière métaphorique dans la conscience artistique du poète en question.
Il faut se rappeler que Cendrars se détache du concept réducteur de libido. L’ambition de Cendrars n'est pas de constituer le squelette, mais plutôt, par l’invention, la texture, le jeu et le style, de le faire revivre autant que possible. D’où la présence si forte du motif de la Résurrection (le Christ, Lazare…) lorsque Cendrars évoque sa propre poésie. La résurrection fait partie du foudroiement…
Les mécanismes littéraires en jeu, dans ses récits, poussent au fantastique : la mise en abyme, les coïncidences de motifs…. : il y a un effet de résonnance entre les personnages et les différents niveaux de lecture, des dédoublements et des incarnations allégoriques, dans une danse hypnotique qui en devient violente, car il y a des relations à la fois d'oppositions, d’aliénations et de dominations qui se confondent, dans autant de mises en abyme et de coïncidences jusqu’à frôler l’invraisemblable.
LE VIEUX-PORT
C'est ici l'histoire d'un piège métalittéraire qui se referme sur Blaise Cendrars et auquel il tente d'échapper. Il rentre d’Afrique à Marseille, et de nombreux personnages apparaissent pour le solliciter, alors il se laisse embarquer dans une soirée folle.
Le voilà dans un bar étrange, le Nain Jaune, « un bar secret » dit-il, auquel on accède par des tunnels et des corridors à multiples embranchements avec des portes de bronze et de cristal.
« L'ivresse aidant, j'avais l'impression d'être installé à l'intérieur d'un bouchon de carafe et Félix, Victor, les hommes lointains qui gravitaient autour d'eux, la Tite, la Berthe, dont j'entendais mourir le rire mélodieux, la patronne en face de moi, cette étrange femme qui s'exerçait à pratiquer je ne sais quel art magique, tous et toutes me paraissaient irisés, revêtus des couleurs de l'arc-en-ciel et plus absurdes que les personnages d'une fantasmagorie.
Cependant, une idée fixe me hantait.
Je voulais savoir comment j'étais arrivé là, placé en pleine lumière dans ce fauteuil focal, au centre d'un jeu de miroirs et de lentilles qui me dépouillaient de ma personnalité.
Quelle mixture m'avait-on fait boire pour me réduire à cet état évanescent ?
Et comme sous le chloroforme je fis un effort désespéré pour retrouver dans ma mémoire le fil qui m'avait égaré dans ce labyrinthe éblouissant. » HF, p.108
Ici la mondanité se fait le lieu d'un piège métalittéraire. Cet état évanescent qu'il nous décrit ressemble à celui du monde censé se dissoudre et se reconstruire sous la foudre du poète.
Les personnages sont présentés comme ceux d’une fantasmagorie, et on pourrait parler par exemple de Diane La Panne, ou La Mythomane, qui semble incarner des enjeux du récit lui-même.
Ce récit est ensuite une tentative d'échapper à cette mondanité étrange et opiacée. Blaise Cendrars se réfugie dans les calanques à la Redonne, à la recherche d'inspiration. Mais aussitôt qu’il se remet à écrire la mondanité le rejoint. Alors il retourne à Marseille pour une fin d'intrigue quasi cauchemardesque dans une multiplication complexe des personnages et une complexification de l'intrigue.
Et il existe tout un tas d’autres fables qui vont ainsi explorer la conscience du poète, des fables qui se côtoient se mélangent se superposent au sein des six grands récits qui composent L'homme foudroyé.
Des fables comme
LA FABLE DE LA PEAU DE L'OURS
ET D'AUTRES PASSAGES PARFOIS MOINS ÉVIDENTS
On le voit, entre en jeu dans ces récits des complexifications de l'intrigue par la multiplication des personnages et des effets de mise en abyme. Ce sont comme des danses infernales parfois, qui ressemblent aux fables telles que les conçoit Robbe-Grillet pour se donner les moyens d'explorer le réel.
« [un récit qui va] tromper [le lecteur] au moyen de leurres dont la machinerie sera […] complexe […] dans la transparente étrangeté d’un piège à multiple détente [...] Il me reste à organiser des fables, qui ne seront pas plus des métaphores du réel que des analogons. »
Ces passages chez Cendrars semblent introduire des clés de compréhension de la psychologie du poète. Certains passages de l'œuvre laissent entendre cela, et proposent même des mécanismes dans la mise en place de « couples » métalittéraires.
(et nous retrouvons les mécanismes de la mise en abyme, et les motifs du désir et du double, du cœur et de l’esprit…)
Un de ces extraits est celui de l’abécédaire aztèque. Plutôt énigmatique, qui semble aborder la manière de Cendrars de complexifier délibérément jusqu'à l’invraisemblable ses intrigues, notamment par la multiplication des personnages, dans des chorégraphies pleines d'échos et de mises en abîme, aux frontières de l'hallucination ou du merveilleux.
Les schémas de l’abécédaire aztèque
Ci-dessous un extrait où Blaise Cendrars décrit ce qu’il voit dans un ouvrage (dont on peut bien sûr douter de l’existence) consacrer à l’abécédaire aztèque (ou du moins à l’abécédaire aztèque tel que Blaise Cendrars veut nous le présenter).
« Tel est le principe fondamental de l’abécédaire aztèque dans lequel Paquita avait appris à lire, chaque lettre étant à l’image d’une grotte et finissant par être surpeuplée car le buste initial n'est jamais seul mais s’accompagne de son double et de son plus proche voisin (la trinité de l’homme : le corps, l’esprit et le cœur), également figurés en buste, si bien que chaque grotte s'adjoint des grottes adjacentes (comme une grande ville ses banlieues), ce qui complique terriblement l’écriture, chaque buste satellite étant à son tour spécifié par une caverne secondaire dont il est le personnage central, où il évolue à son tour en compagnie de son double propre et de son plus proche voisin à lui et par rapport aux éléments permanents qui encadrent la nature, et ainsi de proche en proche et d’image en image, à l’infini, le microcosme se mire dans le macrocosme et, dans un mouvement contraire, le macrocosme dans le microcosme, et ce jusqu’à la notion de Dieu, et c’est pourquoi chaque lettre de cette écriture est appelée une ville sainte et le livre entier Le Livre Sacré des Villes Saintes de la Lagune, coté dans le jargon des savants américanistes : Codex du Yucatan. La calligraphie maya est un des plus anciens systèmes d’écriture du globe et quand on déroule ce papyrus on a réellement devant les yeux le Miroir de l’Univers. Vouloir le déchiffrer c’est vouloir s’hypnotiser, et le lire, le manger. Manger le livre, cette plus haute opération de la magie blanche. Après, on est Dieu. Ou fou, ô Paquita ! » HF, p. 385
Il y a clairement ici un message métalittéraire. Il retrouve dans la complexité de cette abécédaire la complexité de ses propres fables. Et il y observe d’ailleurs des mécanismes et des thèmes que l’on retrouvera tout au long de l’œuvre : « le buste initial n'est jamais seul mais s’accompagne de son double et de son plus proche voisin (la trinité de l’homme : le corps, l’esprit et le cœur), également figurés en buste, si bien que chaque grotte s'adjoint des grottes adjacentes (comme une grande ville ses banlieues), ce qui complique terriblement l’écriture, chaque buste satellite étant à son tour spécifié par une caverne secondaire dont il est le personnage central, où il évolue à son tour en compagnie de son double propre et de son plus proche voisin à lui »,
C'est ainsi que dans L'homme foudroyé, Cendrars se met en scène, comme un double de lui-même, et commence ses histoires souvent avec un ami, son plus proche voisin. Mais aussitôt le double, le personnage Cendrars, devient le buste principale, et émerge bientôt, dans plusieurs histoires, un personnage artiste qui va se faire le double du personnage principal, ou qui va lui-même prendre la vedette, et se voir alors affublé soi-même d’un double, ou d'un plus proche voisin, comme si l’on s’enfonçait dans des grottes. Souvent alors, le plus proche voisin de ces personnages artistes se trouvent être la femme de l'artiste, à laquelle le personnage principal Cendrars s'attache d’une manière qui le perturbe, ou se trouvent être un autre poète en décalage artistique avec Cendrars ou son double.
Tout ceci quand les choses restent relativement simples. Parfois (comme dans le Vieux-Port), les plus proches voisins se multiplient comme autant de satellites autour du buste principal ou de son double. On assiste à un débarquement dans l’intrigue d'amis ou d'amantes, ou une multiplication de prétendants à une femme (dans sa fable par exemple qui se passe dans une société matrilinéaire gitane), et aussitôt les choses prennent des tournures hypnotiques ou énigmatiques, limites insondables.
Ainsi, chez Cendrars, la fable fantastique va se construire autour de personnages et de motifs, des objets motifs, le fouet, la seringue, la voiture, les poupées, et de personnages comme des motifs, des motifs de l'inspiration, de l’aliénation, de l'obsession, de la possession, de la destruction… qui interagissent de manière parfois hypnotiques les uns avec les autres, quitte à confondre nos repères narratifs et spatio-temporels. Le texte porte une réalité qui lui est propre, un réseau de thèmes qui obéit à des mécanismes particuliers, une réalité poétique qui s’affranchit en partie des contraintes du réel, des règles de vraisemblances sur l’espace et le temps. On chahute les règles de la matière pour mieux rendre compte de la pensée et de sa vitesse fulgurante, et donc de la conscience du poète (tout en palimpseste).