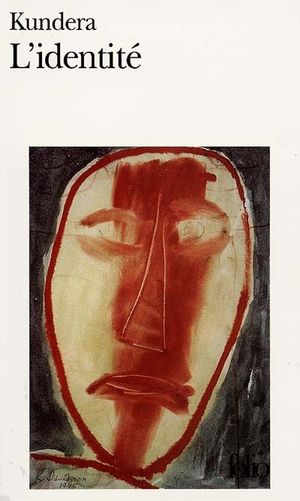Aucun amour ne survit au mutisme.
C'est en suivant cette vérité, Kundera nous la fait apparaître comme indubitable, que Chantal s'éprend d'un sentiment de liberté lorsqu'elle reçoit la lettre élogieuse d'un inconnu. Elle entretient avec Jean-Marc, son compagnon, un amour de confort qui la rassure et la protège, fermement tenue par un quotidien saveur douce-amère. Leur passion a perdu de son éclat, de sa lumière et de son éloquence. Grâce à quelques mots, qu'elle s'empresse de dissimuler sous une pile de soutiens-gorge (n'est-ce pas le plus joli symbole pour représenter la renaissance de la femme à travers la séduction), elle oublie la fâcheuse phrase prononcée à son mari, par quoi tout a commencé : "les hommes ne me regardent plus."
L'identité parle avec onirisme d'une double identité constante. Celle que l'on donne aux autres, celle que l'on garde pour soi, celle construite grâce au passé et celle qui ne tient que par les vestiges de ce dernier, celle par qui l'autre tombe amoureux, qui devient celle par qui il désenchante quelques années plus tard. A travers ce mystérieux CDB, Chantal va renaître de ses cendres, fierté et honte vont se mélanger, la frustration de ne pas connaître cet individu et de lui donner tant d'importance, simplement parce qu'il a posé les yeux sur elle. L'identité est un roman riche de par son aspect fortement introspectif et son double point de vue, qui offre très souvent l'idée que se fait Chantal puis l'idée que se fait Jean-Marc d'une même scène. Loin d'étayer un antagonisme homme-femme primaire, ce parti pris permet de comprendre les agissements de chacun, leurs désillusions communes ou au contraire ce qui les différencie. Malgré des passages un peu plus inintéressants que d'autres (on a déjà tellement écrit sur la perte de repères après les années d'amour, même si ce n'est pas l'unique sujet du récit), le livre se dévore quasiment d'une traite.
Mes premiers pas chez Kundera sont tout de même entachés d'un net sentiment de déception, même si j'ai apprécié toute la seconde partie du livre, mieux écrite et plus transgressive, imagée, hardie, tortueuse, où les allégories de l'abstrait rappellent le réel désarticulé de Kafka. Si l'idée de tirer les passages de méditation en longueur et de faire avancer le récit par le biais des pensées plus que par celui des rebondissements, comme a pu le faire magnifiquement Woolf, pousse à s'interroger et implique le lecteur, je suis circonspect quant au premier tiers du livre, dans un style claudiquant, certes en français parfait, où les temps se mélangent, où Kundera semble marteler le bon sens - petit temps d'adaptation dans la découverte de l'univers de l'écrivain. Cela se tasse, petit à petit, pour finalement révéler toute l'ampleur d'une réflexion aiguisée sur l'amour, le temps, la mort et le petit théâtre des illusions perdues. A approfondir, avec très certainement L'insoutenable légèreté de l'être.