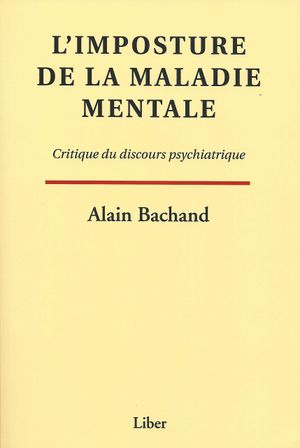L’antipsychiatrie repose sur une doctrine énoncée dès le début du livre : « nous partons du principe [que les comportements appelés maladies mentales] ne s’expliquent pas plus par une pathologie que ceux de la vie quotidienne ». C’est à partir de ce dogme que l’auteur va dérouler une argumentation dénuée de toute dialectique qui vise à le prouver. C’est donc dans une démarche idéologique et non scientifique que se situe l’antipsychiatrie.
L’essentiel du discours antipsychiatrique est d’écarter le plus possible la psychiatrie du champ des autres disciplines médicales.
La conception de l’antipsychiatrie est que si des désordres psychologiques relèvent d’une anomalie biologique alors il s’agirait d’une maladie physique et non mentale. Or, il est évident que le comportement, les émotions et les pensées sont des manifestations ayant un support matériel : le cerveau. Dire que l’identification d’une anomalie biologique à la maladie mentale l’exclurait du champ de la psychiatrie relève d’une conception dualiste de l’esprit humain. De plus, il ne cesse de répéter que les maladies psychiatriques n’ont aucun substrat biologique en dépit de toutes les recherches qui viennent prouver le contraire. Craint-il qu’on puisse mettre en doute son affirmation en se renseignant ? Cet argumentaire vise ainsi à isoler la psychiatrie du champ de la médecine en prétendant de manière fallacieuse qu’il n’y aurait aucun substrat biologique (anatomique ou fonctionnel) dans cette discipline.
C’est faire preuve de simplisme que de réduire maladie à son processus anatomopathologique. Bien avant l’existence des moyens techniques nécessaires à l’identification des causes des maladies, la médecine a existé pour soulager la souffrance. Avec les progrès de la science, identifier la cause de la souffrance – diagnostiquer une maladie – et ensuite développer un moyen pour la soulager – la thérapeutique –, est devenue plus aisé. Les disciplines se sont de plus en plus appuyées sur la science pour comprendre l’origine des symptômes. Pourtant l’objectif poursuivi reste le même : soulager la souffrance humaine. La psychiatrie existe pour soulager la souffrance psychique en s’appuyant sur le lien médecin malade. Dans le même temps, concevoir les disciplines comme la cardiologie ou la cancérologie comme une simple somme de processus pathologiques relève d’une vision réductrice qu’on pourrait qualifier d’antihumaniste.
La pensée antipsychiatrique avance également un autre argument qui serait le suivant : puisqu’il ne faudrait pas de compétence particulière pour identifier les symptômes (par exemple le discours incohérent ou le délire dans la schizophrénie), c’est que le traitement de ce symptôme ne relève pas de la médecine. Par analogie, cela reviendrait à dire que, puisque tout le monde peut reconnaître une difficulté à respirer, le pneumologue n’est pas un vrai médecin.
Pour appuyer son propos, le discours antipsychiatrique s’appuie sur des techniques rhétoriques trompeuses et parfaitement calculées.
- Il utilise un discours volontairement péjoratif pour modifier la perception de certaines choses : par exemple le fait de dénommer les traitements psychotropes des « drogues » plutôt que par le terme de « substances », qui serait neutre et sans jugement.
- Il utilise également des définitions floues ou incomplètes pour ensuite conduire leur argutie : par exemple il donne une définition simpliste du délire en ignorant (ou feignant d’ignorer) que ce qui fait le délire ce n’est pas le contenu du discours mais le degré de croyance du sujet.
- Il s’appuie sur le sophisme de l’homme de paille pour argumenter. La plupart des chapitres qui traitent de troubles spécifiques font le plus souvent étalage de l’ignorance de l’auteur, de leur incompréhension des principes de la psychiatrie, et de leur mauvaise foi.
- Cette manière de répéter à longueur de chapitre les mêmes idées repose sur le principe qu’un mensonge répété suffisamment de fois devient une réalité.
- Enfin, il n’échappe pas à la contradiction : il affirme d’une part que la psychiatrie ne tient pas compte du contexte social des individus pour retenir un diagnostic, et d’autre part que quand celle-ci en tient compte alors ce n’est pas médical, mais du social ! Face je gagne, pile tu perds !
Il semble que pour l’antipsychiatrie, la maladie existe en vase clos et n’a donc aucun déterminant social. Ainsi, on fait fi des comportements déterminés socialement (prise de risque, comportements) ou de la fréquence des maladies selon les milieux socio-économiques. De la même manière, on ignore complètement les conséquences sociales inhérentes à toutes les maladies ce que la langue anglaise qualifie de « sickness » et qui ne touche pas que la psychiatrie. Faut-il redire ici que les théories en médecine empruntent leurs concepts autant de l’anatomie, de la physiologie que de la sociologie.
Finalement, le fait même que l’antipsychiatrie s’arc-boute sur sa position absolutiste l’empêche de produire une critique constructive et même tout simplement pertinente des concepts psychiatriques. Pour ma part je considère que leur discours n’est pas recevable et nécessite d’être réfuté dans son ensemble du fait même de sa méthode de constitution.