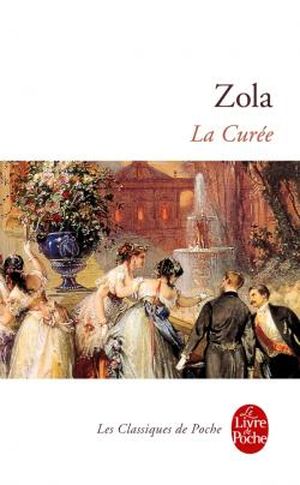Deuxième tome de la saga familiale des Rougon-Macquart, Dallas du Second Empire, La Curée joue en parallèle sur deux tableaux simultanés.
Le premier tableau présente les aventures du petit Aristide Saccard - alias Aristide Rougon, qui a quitté Plassans où ses parents ont fait fortune (cf. oh surprise La Fortune des Rougon) pour Paris, ville d'or dont il compte bien ramasser les pièces sonnantes et trébuchantes. Posté en haut de Montmartre, il surplombe la capitale avec un regard de bête féroce, prêt à déchirer ses jupes d'ingénue pour lui piquer son porte-monnaie.
Afin d'assouvir sa soif maladive de richesse, Aristide commence par changer son nom : de Rougon, trop provincial, il change pour Saccard, qui annonce les "sacs d'or" qu'il ne doute pas d'amasser. Cela au prix d'une vie de magouilles et de manipulations, dans laquelle il se lance avec une foi éperdue en son talent et une passion immense pour le jeu.
Aristide est un homme sans principes, pour qui rien ne compte hormis l'or. C'est donc avec un talent certain qu'il va doucement trouver sa place dans le Paris du Second Empire, monde petit bourgeois de spéculation, triomphant avec la demi-destruction de la vieille capitale au moment des grands travaux haussmanniens. Aristide est né pour cette époque sans cœur, pour ce cercle d'avides gouvernés par l'amour de l'or, ramassis d'ordures manipulatrices et avares, hypnotisées par l'éclat d'un louis ou le bruit d'une pièce frottée contre une autre. Aristide est le roi de ces bêtes écœurantes qui se pressent et s'écrasent autour d'un banquet de bal mis à sac par leurs appétits, qui incarne la curée de Paris, déchirée en petits bouts par les intérêts de chacun.
C'est parce qu'il est un homme sans principe qu'Aristide triomphe, dans le monde zolien. C'est un opportuniste, un joueur prêt à égorger sa propre mère pour mettre une nouvelle mise sur la table lorsqu'il ne lui reste déjà plus que sa chemise, un culbuto qui se redresse toujours plus vite à chaque revers de fortune.
Éminemment antipathique, Aristide suscite tout de même une forme d'admiration ; vieux jeune premier balzacien montant à Paris pour faire sa conquête, il ne se laisse jamais abattre et sait user autant du malheur de ses ennemis que de la naïveté de sa propre femme pour accomplir son rêve de richesse plus violent encore que chez un certain canard multi-milliardaire.
Parlons de sa femme justement. Les amours de Renée, superbe jeune femme, séduisante et excentrique, constituent le deuxième tableau de La Curée. Un amour en particulier, et pas n'importe lequel : celui qu'elle entretient en cachette avec son beau-fils Maxime, le fils d'Aristide Saccard. Amour incestueux, né d'une complicité forgée de frivolités sur plusieurs années, et d'une tendance partagée à se laisser emporter par une lâcheté naturelle. Maxime, garçon presque androgyne, se laisse vivre au grès des caprices de Renée et de sa propre nonchalance presque maladive. Fils d'Aristide secoué par la fièvre de l'or et d'Angèle, pauvre femme sans volonté et sans passion, il est un fruit déjà pourri sur l'arbre des Rougon-Macquart, qui se balance négligemment et tombera comme les autres dans la boue des tares.
L'amour contre-nature de Renée et de Maxime est un manège de bois, qui tourne de la passion la plus brûlante dans des draps de soie rose et des rires indolents, à des douleurs propres à chacun. Là où Maxime ne finit par subir passivement que l'étouffement et la monotonie d'être avec la même femme trop longtemps, Renée souffre véritablement du crime qu'elle commet. Possessive envers son garçon, son homme, sa chose, elle est aussi dégoûtée par sa faute, qu'elle porte tantôt comme un bijou secret sur sa poitrine à demi-nue, tantôt comme une plaie ouverte sur son âme désolée.
Victime des hommes et de ses passions, beauté agaçante et digne de pitié, Renée est un personnage-pari de Zola. A ce jeu du quitte ou double, l'auteur se sort honorablement, et malgré une fin peut-être trop rapide parvient à mêler deux lectures dans un seul livre, celle de l'amour passion et celle de l'amour de l'or, qui s'entremêlent pour dévoiler la lente agonie de la première au profit de la seconde.