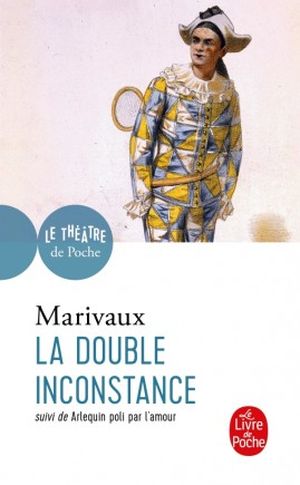On a longtemps réduit le théâtre de Marivaux au seul thème de l’amour naissant que des personnages souvent jeunes, tout à la découverte de leurs premiers émois, expriment en un élégant badinage aussi léger qu’une plume. La Double Inconstance est aux antipodes de ce cliché, puisqu’il est ici question, tout au contraire, de la mise à mort d’un amour. L’exécution sera certes subtile, elle n’en est pas moins aiguisée et ses effets irrémédiables.
En ce début de dix-huitième siècle – la pièce est créée en 1723, à la fin de la Régence – la noblesse semble vouloir corrompre tout ce qu’elle touche. C’est ainsi qu’un Prince et ses sbires vont ourdir la mort d’un amour " bourgeois" (au sens premier du terme : les habitants d’une bourgade). Le pis, c’est qu’ils y réussiront sans trop de problème.
Les sentiments qu’il s’agit de mettre à mal sont ceux de la jeune Silvia pour son promis Sganarelle. C’est que cette inclinaison fâcheuse contrecarre le projet du Prince d’épouser la jolie paysanne. A cet effet, il fait enlever la jeune fille ainsi que son fiancé et charge ses hommes de main de tout mettre en œuvre pour rompre l’amour qui unit les deux tourtereaux. Les roueries des courtisans, leurs manières policées, leur fausse civilité, les manipulations auxquelles ils se livrent auront raison de la candeur et de la sincérité de ces jeunes gens du peuple, tout autant révoltés par le despotisme que révèle cette séquestration arbitraire que par l’insolent étalage de richesses auxquelles ils ne sont guère habitués et dont au fond ils font peu de cas.
Mais à défaut d’un prix, tout homme (et toute femme) a un point faible : la bonne chère, la coquetterie, la vanité, la jalousie. Ce talon d’Achille sera exploité avec adresse, cynisme et un brin de perversité par le Prince – qui se fait passer pour un simple officier de sa garde – ainsi que par ses conseillers Flaminia et Trivelin. Même s’ils tombent parfois, eux aussi, sous le charme de ceux qu’ils manipulent comme des marionnettes, on ne peut s’empêcher de penser que pour parvenir à leurs fins, ces intrigants peu scrupuleux n’hésitent pas à corrompre l’objet de leur désir et que leur comportement n’est pas très éloigné de celui des libertins.
Car si, en définitive, comme dans toute comédie qui se respecte, chacun finit par trouver son compte dans la configuration nouvelle des couples amoureux, c’est au prix de la disparition de la fraîcheur et de l’innocence qui se présentent ici comme l’apanage du petit peuple. Sous l’élégant marivaudage qui met aux prises des gens de condition épousant des paysan(ne)s, le dramaturge se livre en réalité à une peinture plutôt pessimiste d’une société dans laquelle on ne peut s’élever sans s’avilir.